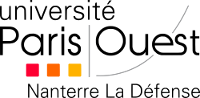Quel peuple n’a pas été séduit par le rêve américain, la promesse d’une vie meilleure sur une terre accueillante, où il serait possible de tout recommencer ? Celui du "pays du soleil levant" ne déroge pas à la règle : au début du XXe siècle, de nombreux travailleurs japonais ont traversé le Pacifique pour se rendre aux Etats-Unis. Ils furent bientôt suivis par de très jeunes femmes cultivant leurs propres rêves de félicité. Ces dernières étaient loin d’imaginer le chemin de croix qu’allait devenir leur existence. L’Américaine Julie Otsuka, fait œuvre de leur histoire : son dernier roman, Certaines n’avaient jamais vu la mer, couronné cette année par le Prix Fémina du roman étranger, évoque ces vies volées. À travers un récit touchant fait de mots simples, élégamment tressés, Otsuka se fait la mémorialiste d’un destin collectif brisé.
Quel peuple n’a pas été séduit par le rêve américain, la promesse d’une vie meilleure sur une terre accueillante, où il serait possible de tout recommencer ? Celui du "pays du soleil levant" ne déroge pas à la règle : au début du XXe siècle, de nombreux travailleurs japonais ont traversé le Pacifique pour se rendre aux Etats-Unis. Ils furent bientôt suivis par de très jeunes femmes cultivant leurs propres rêves de félicité. Ces dernières étaient loin d’imaginer le chemin de croix qu’allait devenir leur existence. L’Américaine Julie Otsuka, fait œuvre de leur histoire : son dernier roman, Certaines n’avaient jamais vu la mer, couronné cette année par le Prix Fémina du roman étranger, évoque ces vies volées. À travers un récit touchant fait de mots simples, élégamment tressés, Otsuka se fait la mémorialiste d’un destin collectif brisé.
Le roman s’ouvre sur le récit d’une traversée. Entassées dans la cabine du navire qui les conduit aux Etats-Unis, des jeunes femmes originaires des quatre coins du Japon partagent leurs appréhensions. Elles s’appellent Misuzu, Chiye, Fumoko, Setsuko ou Kiyono, certaines viennent de villages de pêcheurs, d’autres sont descendues de leurs montagnes pour la première fois et n’ont jamais vu la mer ; elles sont citadines ou paysannes ; les plus jeunes ont quatorze ans, les plus âgées ne le sont pas de beaucoup plus d’années. Leurs points communs : de longs cheveux noirs, des pieds plats et une photo, celle que leur a transmise la marieuse de leur village ou de leur quartier, celle de l’homme qu’elles n’ont jamais vu et dont elles sont pourtant déjà l’épouse. Elles interrogent des passagers sur ce pays d’hommes géants, couverts de poils et mangeurs de viande, où l’on lit les livres de la fin jusqu’au début et où le contraire de blanc n’est pas rouge mais noir. Elles se plongent dans leur guide, Bienvenue mesdemoiselles japonaises ! Elles se rassurent : après tout, elles savent se taire, composer des poèmes de dix-sept syllabes et servir le thé. Ce sont des femmes accomplies.
À la descente du bateau, la réalité hirsute vient à leur rencontre. Les hommes des photos ont vieilli de vingt ans. Ils ne sont pas banquiers ni propriétaires d’hôtels mais paysans ou blanchisseurs. Ils ont pour palais une tente, une grange ou un champ à la belle étoile. La nuit de noce est un prolongement du viol de leurs espérances. Très vite, les jeunes femmes sont jetées au champ, où elles passent quatorze heures par jour à déraciner les mauvaises herbes. Certaines sont enlevées, d’autres s’enfuient et finissent par se prostituer. Celles qui demeurent en ville trouvent une place de bonne. Leur vie un peu moins dure, quand elles ne doivent pas subir les assiduités de leur maître. Les Japonaises entrent dans la catégorie des invisibles. Elles comprennent vite que "la seule manière de résister, c’est de ne pas résister". Déracinées, elles oublient peu à peu leur identité et perdent le contact avec leur famille. Elles ne parlent pas anglais pour autant et vivent à l’écart de la société américaine. Après plusieurs années passées loin de leur terre natale et plus loin encore de leur rêve américain, elles subissent la pire aliénation qui soit à travers leurs enfants, seul point d’ancrage possible sur cette terre étrangère : « Je me sens comme une canne qui a couvé les œufs d’une oie. ». Nés aux Etats-Unis, les enfants oublient en grandissant la langue de leurs parents, se moquent de leurs dieux et de leurs coutumes, se choisissent un nouveau nom, plus américain, et aiment le riz noyé dans du ketchup. Pourtant, lorsque les Etats-Unis entrent en guerre contre le Japon en 1942, eux aussi deviennent des étrangers, des rebuts stigmatisés à leur tour menacés par l'exil et l’oubli…
Le génie stylistique d’Otsuka consiste à raconter l’histoire de ces femmes en leur rendant la parole, tout en imaginant qu'elles ne font qu’une : l’utilisation du « nous » pour les évoquer collectivement et individuellement vient souligner la pulvérisation de l’identité singulière, l’effacement du « je ». Chaque expérience unique, chaque morceau de vie isolé n’est là que pour témoigner de leur destin à toutes. Ubiquité sublime de la Fortune des Japonaises d’Amérique dont Otsuka construit pierre par pierre la statue de jade, mémoire vivante des ces effacées.
Juliette Lambron
Certaines n’avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Traduit de l’anglais par Carine Chichereau. Editions Phébus ; 15 euros.
 Quel peuple n’a pas été séduit par le rêve américain, la promesse d’une vie meilleure sur une terre accueillante, où il serait possible de tout recommencer ? Celui du "pays du soleil levant" ne déroge pas à la règle : au début du XXe siècle, de nombreux travailleurs japonais ont traversé le Pacifique pour se rendre aux Etats-Unis. Ils furent bientôt suivis par de très jeunes femmes cultivant leurs propres rêves de félicité. Ces dernières étaient loin d’imaginer le chemin de croix qu’allait devenir leur existence. L’Américaine Julie Otsuka, fait œuvre de leur histoire : son dernier roman, Certaines n’avaient jamais vu la mer, couronné cette année par le Prix Fémina du roman étranger, évoque ces vies volées. À travers un récit touchant fait de mots simples, élégamment tressés, Otsuka se fait la mémorialiste d’un destin collectif brisé.
Quel peuple n’a pas été séduit par le rêve américain, la promesse d’une vie meilleure sur une terre accueillante, où il serait possible de tout recommencer ? Celui du "pays du soleil levant" ne déroge pas à la règle : au début du XXe siècle, de nombreux travailleurs japonais ont traversé le Pacifique pour se rendre aux Etats-Unis. Ils furent bientôt suivis par de très jeunes femmes cultivant leurs propres rêves de félicité. Ces dernières étaient loin d’imaginer le chemin de croix qu’allait devenir leur existence. L’Américaine Julie Otsuka, fait œuvre de leur histoire : son dernier roman, Certaines n’avaient jamais vu la mer, couronné cette année par le Prix Fémina du roman étranger, évoque ces vies volées. À travers un récit touchant fait de mots simples, élégamment tressés, Otsuka se fait la mémorialiste d’un destin collectif brisé.