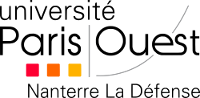Identité, pirandellisme et Tarahumaras ou Le Masque à terre
mar, 12/11/2012 - 14:26
.jpg) Quelques semaines avant le festival Nanterre sur Scène, nous avons rencontré Louise Roux, actrice et auteure de la pièce, afin d'en apprendre un peu plus sur l'étrange traversée qu'elle nous propose d'effectuer...
Quelques semaines avant le festival Nanterre sur Scène, nous avons rencontré Louise Roux, actrice et auteure de la pièce, afin d'en apprendre un peu plus sur l'étrange traversée qu'elle nous propose d'effectuer...
MCEI : Comment ce projet est-il né, quelles étaient vos motivations ?
Louise Roux : J’ai trouvé et acheté ce masque dans un petit magasin perdu en plein cœur du Guatemala. C’est en l’essayant que je me suis dit qu’un jour, j’aimerais travailler avec lui. Comme il est très particulier, je n’ai pas réussi à l’intégrer dans les pièces que je jouais dans le cadre de mon école de théâtre. Et puis il y a un an et demi, j’ai commencé à travailler seule. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à réfléchir sur la notion de masque : qu’est-ce qu’un masque ? que révèle-t-il ? Je me suis alors lancée dans une série d’improvisations autour de ce masque.
L.R. : C’est vraiment un masque particulier, derrière lequel on ne peut pas parler. C’est un masque de rituel, un masque d’homme, qui a un sourire étrange. On m’a dit que c’était probablement un diable. J’avais envie de donner vie à ce masque, tout en gardant sa fonction initiale qui est celle du rituel. Pour moi, ce masque représentait la possibilité de révéler les pulsions inconscientes. Souvent dans la vie ou dans des situations qui nous paraissent « normales », nous portons un masque. Le fait de porter ce masque de théâtre permet d’exprimer des choses complètement différentes par le corps : ce qui est réel, inconscient, ou ce que l’on cache habituellement. Il y a effectivement un paradoxe. Ici c’est bien le masque qui révèle ce que je cache. Quand j’enlève ce masque de théâtre, c’est alors mon masque social ou mon masque de séduction qui apparaît.
L.R. : Le titre de la pièce est en fait le titre de la conférence sur laquelle s’ouvre la pièce. Les Tarahumaras font référence à Antonin Artaud et au Mexique, où j’ai passé beaucoup de temps, et au Guatemala, où j’ai trouvé le masque. Pirandello a beaucoup travaillé sur la notion d’identité, ses écrits m’ont inspirée.
L.R. : Oui et non. C’est vrai qu’il y a beaucoup de références… Le début de la pièce est clairement une conférence universitaire, dans laquelle il y a de nombreuses références à Pirandello, ainsi qu’à des philosophes qui ont traité de la notion de masque. Mais ce qu’on cherche dans la pièce, c’est justement à opposer ce contexte extrêmement rationnel de la conférence au côté totalement inconscient qui vient par la suite. Les sens et la raison se brouillent. Dès lors, quelles que soient nos connaissances, elles deviennent inutiles. C’est justement cela que l’on cherche : détruire en partie les structures logiques de la pensée et interroger l’inconscient. Finalement pour apprécier le spectacle, il faut laisser de côté sa rationalité.
L.R. : Au tout début du projet, quand j’essayais de réfléchir à la notion de masque et d’identité, j’ai eu envie d’essayer de traiter les différents états de conscience. J’ai constaté qu’il était souvent très difficile d’être en présence d’une personne sans qu’interfèrent des pensées, ou des réflexions personnelles qui analysent la situation. Ces personnages représentent donc en quelque sorte ces différentes voix qui interviennent dans nos têtes et qui brouillent les pistes… ou non… J’ai donc interrogé ces états de conscience distincts par différentes pratiques artistiques : le yoga est une discipline qui amène à prendre de la distance par rapport aux choses de la vie, la danse permet, elle, d’exprimer des choses plus organiques, plus inconscientes… à l’opposé donc, de ce qu’est Lili Bloome, une personne rigoureuse et rationnelle.
L.R. : J’ai surtout écrit la pièce à partir d’improvisations, et de discussions sur le plateau ; puis les choses se sont progressivement mises en place de façon plus arrêtée. Paradoxalement, la deuxième partie de la pièce, où l’on est beaucoup plus dans la folie, est celle où les choses sont le plus fixées. Par ailleurs le son, les lumières et la mise en scène ne changent pas. Ils sont comme un fil conducteur. Mais c’est vrai que le spectacle varie beaucoup d’une représentation à l’autre : ce sont l’ambiance et les spectateurs qui font que le processus est à chaque fois différent.
L.R. : L’espace, au début de la pièce, est vraiment celui d’une salle de conférence. Cet espace est complètement bouleversé dans la deuxième partie. Dans cette seconde partie, je pose des feuilles blanches sur le plateau et je m’en sers pour tracer un chemin. A partir de là, chacun est libre d’interpréter à sa manière : cela pourrait très bien représenter le chemin du processus que le personnage parcourt, ou les circuits neuronaux du cerveau. C’est grâce à la lumière, essentiellement, que nous sommes parvenus à créer une atmosphère onirique. C’est elle qui nous fait pénétrer dans l’univers du souvenir et de l’inconscient.
L.R. : Le son intervient dans la deuxième partie. Hugo Kostrezewa a utilisé ses créations sonores originales et a travaillé à partir du spectacle. Il a inséré des bruits réels de papier froissé, de livres, de salles de conférence afin de créer une ambiance un peu dérangeante, angoissante, et de mieux plonger le spectateur dans l’univers étrange de la folie. Il a également travaillé à partir d’infrabasses, ces sons que l’on ne distingue pas forcément mais qui montent petit à petit, ce qui fait que l’on se demande d’où vient le bruit. Ils aident à la dramaturgie.
L.R. : Oui, j’ai eu envie d’explorer de nouvelles choses. Je n’arrivais pas à trouver un terrain de jeu satisfaisant et c’est pour cela que j’ai commencé à travailler toute seule, parce que je voulais tenter cette expérience. Il y avait quelque chose qui me troublait dans le théâtre traditionnel, comme une impression qu’on ne pouvait pas être « vrai ». C’est aussi parce que j’étais à un moment de ma vie où je me questionnais beaucoup sur cette notion de masque social que l’on revêt au quotidien, comme si, finalement, la vie était un théâtre. J’avais envie de tomber le masque…
L.R. : C’est très jouissif et très difficile en même temps. Au début je ne travaillais pas dans l’objectif d’une représentation. J’ai travaillé seule, pendant presque un an, en m’enregistrant sur des improvisations. Puis des amis chorégraphes et dramaturges ont rejoint le projet ; il s’est construit au fur et à mesure, mais je ne pensais pas encore à la représentation et je n’en parlais pas car c’était encore trop personnel. La première représentation s’est finalement très bien passée, et c’est ce qui m’a permis de prendre de la distance par rapport au projet. Le fait de le jouer aujourd’hui est assez particulier, dans le sens où je mets beaucoup de moi dans cette pièce, mais en même temps je ne parle pas de ma vie privée. Par ailleurs, il faut aussi que je sois « apte » à jouer ce processus en public. Ce n’est pas toujours évident d’avoir envie de se dévoiler, de montrer ses émotions plusieurs soirs de suite. C’est une forme de générosité qui n’est pas évidente à partager.
L.R. : Oui, j’aimerais vraiment faire une suite. Il y a des choses en cours. J’ai ramené un autre masque du Guatemala, un masque de femme cette fois-ci…
Propos recueillis par Juliette Lambron et Lucie Lelong