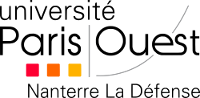À la lisière du périphérique
ven, 10/14/2016 - 22:05
J’attends le long de la palissade en bois. Aucune tête familière, elles étaient arrivées une heure plus tôt et avaient déjà pénétré l’antre. Autour de moi, d’excentriques énergumènes, aux traits excités ou fatigués, plantés en une file minutieuse, à peine mouvante, si ce n’est quelque jambe impatiente tapant du pied sur le bitume. Une fille arrive dans sa combinaison à croisillons, à ses côtés un homme aux cheveux à moitié rasés, dans ses chaussettes hautes, son short noir, le torse nu. Presque personne ne parle. Seules des vibrations de basses parviennent à nos oreilles, lourdes et envoûtantes. On côtoie les palettes et matelas éventrés de la rue, habitations sauvages de familles roumaines. Leurs tympans vrombissent au même son, mais eux restent indifférents. Ça avance. Nos pas déterminés enjambent les débris, une enfant, la main tendue, vous dit : « vous êtes très jolie », puis à celles qui arrivent derrière aussi. Mais ici, ce n’est pas vraiment Paris, alors les regards ne cherchent pas à absoudre leur culpabilité dans un horizon muet, ils s’assument, d’un don ou d’un non. Dans ce décor industriel en déshérence, nulle gêne, tout est brut. A mesure qu’on s’approche, l’étrange silence ambient est ponctué du rythme de la musique, et, de l’autre côté, du passage des voitures sur l’autoroute.
J’arrive devant le rideau noir, le vigile pose. Ouverture des sacs. « Allez-y ». Je passe enfin de l’autre côté de ce mur factice. Devant mes yeux, un spectacle improbable. Dans l’effervescence générale, les corps se balancent, satellites en orbite autour d’eux-mêmes. Les échafaudages improvisés de métal et de bois encadrent les scènes et des pans de ciel parfaitement bleu. Au-dessus des platines, une toile colossale : une chaîne humaine de corps blancs sur fond bleu s’emboîte en un cercle surréaliste, une version déliquescente de la danse de Matisse. Mon amie surgit de nulle part et interrompt la circonvolution de mes pensées. Elle me prend par la main. On entre dans la masse. La cadence s’accélère. Confusion des sens. Il fait chaud, le soleil pose un baiser sur nos têtes, la fumée blanche propulsée au sol enlace nos pieds. Les heures défilent, en un clin d’œil, le jour s’éclipse en auréoles de couleurs diffuses. Le rose caresse les dernières teintes bleutées, violacées, puis elles ruissèlent toutes ensemble sous terre. Les spots s’allument, créant une vision stroboscopique, soudain ébahie par le nuage de bulles soufflé vers le ciel. Même les danseurs possédés interrompent leur communion sonore. Les yeux se lèvent et les doigts se tendent pour effleurer leur beauté fragile, instant volatile et hors du temps. Cette poésie nocturne sonne l’heure de l’aparté. Derrière la foule, un espace abrite les plus fatigués. On ne résiste pas à l’appel d’une balançoire géante. Allongés et bercés, les yeux rivés vers les étoiles, on distingue des échos, bribes musicales ou bribes de paroles : « c’est fou quand même, cet endroit… ».
Ressourcés, on retourne dans la chaîne pour le reste de la soirée. Les douze coups de minuit nous rappellent à la réalité. La fin approchant, déjà nostalgiques de cette idylle d’un jour, l’euphorie s’empare de tous dans un feu d’artifice final. Le musicien derrière ses machines ajuste ses lignes, il nous éclabousse d’un rouge passion, d’un jaune enthousiaste. Puis le silence s’abat. Les voix ressurgissent, les couleurs s’évaporent, le monde retrouve ses nuances de gris. Orphelins livrés à nous-mêmes, nous reprenons le chemin inverse. A la sortie, les regards se croisent, balaient le vide : « on va où maintenant ? ». Certains repartiront jusqu’au bout de la nuit, d’autres fermeront leurs yeux encore brillants. Mais ici, c’est un no man’s land. Loin des cartes postales de Paris, à la lisière du périphérique, on dessine un monde hors frontières, hors genres, hors normes. Au cœur d’un quartier défiguré, avec ses façades noircies, c’est ici, à la Station Gare des Mines que grouille une fourmilière d’un jour. Les poumons calcinés de ces vestiges d’une gare à charbon désaffectée entrent en apnée, chaque mois, pour se gonfler de vie, le temps d’un samedi.
Joana Durbaku