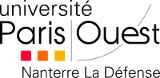Répondre au commentaire
La législation française sur le livre numérique et le défi du prix unique, par Sara Thomases (avril 2014)
La politique Européenne en matière de livres n’a fait l’objet que d’une harmonisation à minima. Les différents pays de l’Union ont depuis toujours adopté des stratégies différentes face à ce produit particulier. L’arrivée du livre numérique sur le marché, a relancé le débat en France sur le type de réglementation le plus à même d’assurer une certaine protection pour la diversité de l’offre culturelle et le monde de l’édition.
Il est indéniable que le livre, qu’il soit papier ou numérique, n’est pas un bien comme les autres, du fait de l’important vecteur culturel qu’il constitue. A la lumière de cette considération certains Etats ont estimé nécessaire de le protéger, et plus particulièrement par rapport aux éventuels risques que l’économie de marché pourrait constituer pour celui-ci. C’est dans cette optique que la France a adopté en 1981 une politique de prix unique en matière de livres. Avant cette date la France connaissait une pratique de prix suggéré par l’éditeur. L’entrée de la Fnac sur le marché du livre a amené la classe dirigeante à réformer le système en place. En effet la Fnac, a dès le début entrepris une politique de prix agressive, et rapidement les autres grands distributeurs l’ont suivie sur ce chemin. La loi Lang est alors intervenue afin de protéger le réseau de petits libraires qui ne pouvait subsister face à la forte concurrence par le prix des grandes surfaces. Cette loi met en place un système de prix unique fixé par l’éditeur et imposé aux détaillants, qui se couple d’une interdiction de concéder des rabais supérieur à 5% du prix de vente public fixé par l’éditeur.[1]
La mise en place de cette loi affiche plusieurs objectifs, qui vont dans le sens de la promotion de la culture, par le biais d’un accès facilité au livre. Tout d’abord elle vise à assurer une certaine diversité de l’offre. En effet l’éditeur en fixant le prix des livres qu’il propose maintient le contrôle : il peut ainsi se permettre de publier certains livres peu rentables économiquement parlant, en compensant cela par les ventes de livres à succès. Le deuxième grand objectif de la loi est celui de préserver le réseau de petits libraires, qui assurent que l’accès aux produits littéraires soit uniforme sur le territoire national. Enfin, la législation vise à garantir que les prix pratiqués restent abordables et que le public lecteur ne soit pas pénalisé selon sa localisation géographique.
La loi n’avait pas manqué d’être critiquée, notamment par les grandes surfaces qui se trouvaient contraintes de respecter le prix fixé par l’éditeur. Ainsi certaines d’entre elles avaient tenté d’attaquer le texte sur la base du droit européen. Néanmoins, la Cour de Justice de l’Union a validé le système français, et a depuis maintenu son appréciation.[2] Au regard de la grande diversité des traditions des Etats membres en la matière elle a choisi la voie de la prudence en laissant subsister une certaine liberté en matière de prix du livre.
L’avancée technologique est entre temps passée par là : l’arrivée du livre numérique sur le marché est porteuse d’une révolution en germe dans les habitudes des lecteurs. L’enjeu peut sembler moindre au regard du fait que le numérique ne représente encore en France qu’à peine plus de 1% du marché éditorial. C’est sans considérer les évolutions potentielles de ce secteur en pleine expansion.
Le choix français d’adopter un prix unique aussi en matière de numérique fait débat, certains s’interrogeant sur la pertinence et sur la légitimité d’un tel choix. En effet, le mouvement au niveau international ne va pas pour l’instant dans cette direction, laissant la France seule dans cette voie (I). De plus, est toujours en suspens la question de la compatibilité d’une telle loi au regard du droit européen, qui est loin d’être anodine (II).
- Le prix du livre numérique, des réponses différentes selon les pays
Il apparaît comme instructif d’observer l’appréhension américaine de la question du prix du livre numérique (A), afin de mieux saisir la spécificité du choix du législateur français (B).
- Le modèle américain et le choix de la pleine concurrence
Les lois antitrust américaines s’appliquent pleinement en matière de livre: non seulement il n’existe aucune obligation légale pour les distributeurs de respecter le prix proposé par les éditeurs, mais au contraire, toutes pressions de ces derniers pour obtenir le respect d’un prix fixe pourraient tomber sous la coupe des lois antitrust.
En vertu de la section première du Sherman Act de 1890, premier cadre légal pour la régulation des pratiques anti-concurrentielles aux Etats Unis, sont interdites les ententes entre entreprises qui aboutiraient à une restriction du commerce. En 1911 la Cour Suprême dans un arrêt Dr. Miles Medical and co. Vs. John D. Park & Sons Co. interpréta l’imposition d’un prix fixe comme étant une restriction du commerce. Le droit de la concurrence américain se montre particulièrement attaché à la liberté des revendeurs de décider eux-mêmes de leur politique tarifaire, avec l’idée que cela bénéficiera au consommateur final. Depuis 2007, il y a eu un certain assouplissement : la Cour Suprême considère que pour les fixations de prix imposées résultant d’une entente verticale s’applique désormais la rule of reason (Supreme Court, 28 juin 2007, Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc, 551 U.S. 877). En vertu de celle-ci, une telle pratique sera considérée comme illégale que s’il est démontré que cela entraîne des risques avérés d’effets anticoncurrentiels. En revanche, lorsque l’entente est horizontale, aucun examen des conséquences effectives sur la concurrence n’a lieu : l’entente amenant à la fixation de prix constitue une violation per se, c’est à dire un comportement illégal en soi, qui ne peut être justifié.
Il convient tout d‘abord de souligner que livre numérique a connu un succès à la croissance exponentielle aux Etats Unis. Entre 2008 et 2012 la vente de livres numériques est passée de 10 M à 457 M. En 2012 la vente d’ouvrage électroniques aux Etats Unis s’approchait des 20%. Ce marché en plein essor, n’a pas manqué de réveiller les appétits des grandes entreprises spécialisées, cherchant à s’imposer sur le marché comme référence incontournable en la matière.
Dès le début le marché du livre numérique américain a été dominé par Amazon, qui s’est imposée comme leader dans le secteur. Depuis 2007 et l’apparition de sa liseuse Kindle, l’entreprise a pu établir un quasi monopole sur le marché, ce qui lui a permis dans une très large mesure d’effectuer des pressions commerciales et imposer des prix à la baisse aux éditeurs. Le prix moyen de vente d’un e-book était ainsi fixé dans une très grande majorité des cas à 9,99 $. Certains analystes ont d’ailleurs considéré que Amazon revendait sciemment à perte, du moins certains titres, afin de mieux établir son monopole sur le marché.
Cela avait tout naturellement effrayé les maisons d’édition craignant qu’à terme cela entraîne une baisse significative du prix du livre. D’un autre coté elles redoutaient que les grandes sociétés de distribution acquièrent un poids commercial tel que celles-ci auraient pu obtenir une compression des marges des éditeurs, afin de baisser les coûts des ouvrages. Néanmoins les maisons d’éditions se trouvaient dans l’impossibilité d’effectuer une pression envers Amazon, en situation de quasi-monopole, afin qu’elle cesse de brader les prix.
En 2010 Apple se lança dans le marché des tablettes, avec la sortie de l’I-Pad. Sa volonté était de se creuser une place sur un marché dominé par Amazon. Ainsi elle proposa un nouveau type de contrat aux maisons d’édition. Jusque là celles-ci avaient organisé leurs relations contractuelles de façon classique : elles vendaient les livres aux revendeurs à un certain prix, ces revendeurs étant alors libres de fixer librement le prix de revente. Apple proposa en revanche aux éditeurs de passer par un nouveau type de contrat, dit contrat d’agence. En vertu de celui-ci les éditeurs auraient le contrôle du prix de revente : ils proposeraient une fourchette de prix de revente et en vertu d’une clause dite « retail price, most favoured nation » les revendeurs n’auraient pas le pouvoir de descendre en-dessous d’un prix minimal (à savoir le prix fixé sur l’Ibook-Store pour le livre en question).
Les éditeurs furent ainsi en mesure de fixer un prix minimal de 12.99 $, et par la suite ils réussirent à aligner les prix chez les autres revendeurs, en renégociant leurs contrats. Amazon, se retrouva ainsi dans l’impossibilité de continuer à proposer les livres numériques à 9,99 $, ce qui constituait le cœur de sa stratégie commerciale. Cette dernière se considéra bien évidemment lésée, car privée de sa liberté de décider de sa politique de prix.
Le département de Justice des Etats Unis ne tarda pas à lancer une procédure contre Apple et les maisons d’éditions ayant pris part à l’élaboration des contrats d’agence. Il était avancé que ces contrats résultaient d’un accord entre Apple et cinq des plus grandes maisons d’édition américaines, ayant un objectif anticoncurrentiel : celui d’augmenter le prix de vente des livres numériques.
Une grande attention médiatique a été porté à ce procès, défini comme « historique », en ce qu’il permettait au juge américain de s’exprimer sur la politique de prix du livre et sur sa vision des ententes en la matière. La District Court de New York, le 5 septembre 2013, a choisi la voie de la fermeté : elle a considéré que les contrats en cause étaient bien le fruit d’une entente entre Apple et les maisons d’édition, et a qualifiée celle-ci de « verticale ». Ainsi, elle tombait sous la coupe de l’illégalité per se, et ne pouvait être sauvée en examinant d’éventuels effets positifs sur la concurrence. Les éditeurs avaient déjà signé un accord à l’amiable avant l’issue du procès. En revanche Apple se trouve bel et bien condamnée, et la clause dite « retail price MFN » interdite. [3]
La justice américaine n’a pas tenu compte de l’argumentaire d’Apple visant à démontrer qu’Amazon s’était créée une situation monopolistique sur le marché et a tranché de façon claire : pas de prix fixe pour le livre numérique. Sa position a de très faible chances d’évoluer lors de l’appel, qu’Apple a d’ores et déjà intenté.
- La détermination législative française face à la régulation du livre numérique
En l’absence d’un cadre spécifique posé par l’Union Européenne dans le domaine du livre, les Etats ont conservé leur liberté quant aux choix à mettre en œuvre. Cela s’est traduit en Europe par une multitude de réponse différentes : certains pays ont choisi de ne pas réguler le secteur du livre (par exemple, la Belgique), d’autres ont mis en place un système de prix unique, que ça soit par le biais d’une mesure législative comme en France, ou par accord sectoriel comme au Luxembourg ou en Norvège.
Le législateur français est particulièrement soucieux de soutenir le réseau de librairies indépendantes. C’est dans cette optique par exemple qu’a été tout récemment ( le 8 janvier 2014) adoptée une proposition de loi, dite « anti-Amazon », qui vise à ce que les frais de port offerts soient inclus dans les 5% de rabais qui constituent le plafond maximum autorisé par la loi Lang. Cela vient donc contrer la pratique des opérateurs en ligne proposant la gratuité des frais de port. De plus la France est, du moins à l’heure actuelle, le seul pays à avoir décidé de légiférer en matière de livre numérique en imposant un prix unique aussi pour ce type de produit.
Le 18 décembre 2009, suite à une demande d’avis de la part du Ministre de la Culture et de la Communication, l’Autorité de la Concurrence s’exprimait sur une éventuelle adaptation de la loi Lang aux œuvres numériques. Elle rendait un avis mitigé quant à l’opportunité d’une telle mesure, en considérant que les objectifs de la loi Lang étaient difficilement transposables à un produit non seulement nouveau, mais aussi différent par rapport au livre papier.[4] Par exemple il peut être difficile de comprendre comment l’imposition d’un prix unique puisse changer la donne par rapport à l’objectif de péréquation géographique. Par le biais d’internet le livre numérique est par définition accessible de façon égale à tous les consommateurs, qui peuvent l’acquérir librement. Le maintient d’un réseau de librairies indépendantes afin de garantir l’accessibilité du libre perd son sens en matière de livre numérique. En outre, la diversité éditoriale serait déjà possible par le seul fait de la numérisation des livres : en effet le coût de stockage et de production de tels ouvrages est très faible et permet ainsi d’offrir un choix d’œuvres très diversifié. Là encore l’instauration d’un prix unique ne semble pas indispensable pour que soit garanti un certain pluralisme de la création.[5] Ce sont sur ces points que la Commission européenne entend attirer l’attention des Etats. Elle vise donc à décourager les éventuelles mesures imposant un prix unique en matière de livre numérique. Les atteintes au droit européen de la concurrence pouvaient être tolérée en matière de livre papier au nom de certains intérêts non-économiques. En revanche en matière de livre numérique la mise en place d’un prix unique ne semble contribuer à la protection de ces intérêts que dans une très faible mesure.
Malgré cela, la France a souhaité poursuivre dans la voie de l’extension de l’obligation de respecter un prix fixe : cela est l‘objet de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. L’objet de cette loi parait bien être de protéger les librairies indépendantes. Le législateur français considère en effet que celles-ci exercent et continueront d’exercer un rôle fondamental dans la diffusion de la culture, et en particulier dans la promotion de la diversité des œuvres. Le risque avec la numérisation c’est que les grandes plateformes internet ne mettent en avant que certains livres, et que donc les consommateurs qui visitent de tels plateformes sans avoir déjà une idée précise de l’achat qu’ils entendent effectuer, seront poussés à acheter les œuvres les plus « populaires ». Dans cette optique les rôles de conseil et de valorisation des librairies indépendantes resteraient précieux, et c’est pour cela que l’on souhaite leur permettre d’accéder au marché du numérique. Hors pour qu’elles ne soient pas trop désavantagés par rapport aux grandes plateformes, il convient d’éviter que ces derniers puissent mettre en place une politique de prix agressive.[6]
L’adoption de la loi a été précédée par de longs débats internes, ainsi que par un bras de fer avec la Commission Européenne. La question principale était celle de savoir si auraient été seuls concernés les éditeurs et distributeurs établis en France, ou si au contraire la loi aurait aussi pu s’appliquer aux distributeurs établis hors France mais proposant des livres aux acheteurs situés sur le territoire français. La première option apparaissait moins problématique au regard du droit européen de la concurrence et des libertés de circulation, mais elle avait le défaut d’être d’une efficacité douteuse dans la mesure où l’internet abolit la réalité des frontières physiques. La loi aurait difficilement pu faire preuve d’efficacité s’il avait suffit aux acheteurs basés en France d’acquérir le livre numérique sur le site d’un détaillant basé dans un pays où il n’y aurait pas d’obligation de respecter un prix unique.
Au final le choix du législateur français a été celui de l’intransigeance. Ainsi, le Sénat à en deuxième lecture réintroduit la clause d’extra-territorialité qui faisait débat. Celle-ci apparaît donc à l’article 3 de la loi, qui prévoit que « Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France”. [7]
Reste qu’aux termes de l’article 2 de la loi, seuls les éditeurs établis en France ont l’obligation de fixer un prix de vente au public pour les livres numériques qu’ils entendent commercialiser en France. Ce prix, tous les distributeurs se doivent de le respecter, qu’ils soient établis à l’étranger ou en France. En revanche, la loi ne s’applique pas à « tout livre édité en langue française ». Seuls les livres édités par des éditeurs établis en France sont concernés. Concrètement cela laisse la possibilité à un éditeur basé par exemple en Belgique (où il y a un régime de prix libre) de proposer des livres en langue française au prix qu’il souhaite. Rien n’empêche alors aux acheteurs situés en France de procéder à l’achat sur le site de l’éditeur belge, non soumis à la réglementation française.
Il apparaît ainsi que la clause d’extraterritorialité, outre qu’elle pourrait être contestée au regard du droit européen, pourrait poser des problèmes concrets d’application. On voit bien qu’il est difficile de transposer les règles valables pour le livre-papier dans un espace dématérialisé, où les notions de « frontières » et « territorialité » perdent de sens.
Selon la directive 98/34, les Etats membres doivent notifier à la Commission Européenne tout projet de règle technique relatif aux produits et aux services relatifs à la société d’information, cela afin que l’Union puisse avoir un certain droit de regard par rapport à d’éventuelles barrières commerciales. Ainsi la France avait notifié son projet de loi à la Commission. Cette dernière avait exprimé de nombreuses réserves quant à la compatibilité d’une telle norme au regard du droit communautaire. Néanmoins selon la directive 98/34, lorsque la Commission rend un tel avis, l’Etat n’a pas l’obligation de modifier son projet de réglementation. Il est seulement tenu, en vertu de l’article 7 de la directive, de reporter l’adoption de la norme.
Ainsi, la France a choisi de passer outre l’avis de la Commission. Cela laisse ainsi planer de nombreux doutes quant à la compatibilité de la loi du 26 mai 2011 au regard du droit communautaire.
- Une régularité douteuse de la loi française au regard du droit européen
Il conviendra d’examiner la loi relative au prix du livre numérique tout d’abord au regard de l’article 101 TFUE (A), pour ensuite l’analyser au regard des libertés de circulation (B).
- La légalité du prix unique sous le prisme de l’article 101 TFUE
La Cour de Justice a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la validité de certaines pratiques concernant la fixation du prix du livre. En 1984 dans arrêt VBBB contre Commission des Communauté européennes elle avait considéré qu’un accord sectoriel transfrontalier entre éditeurs et distributeurs flamands et néerlandais établissant un prix de vente fixe pour les livres tombait sous la coupe de l’article 85 du Traité de Rome (aujourd’hui 101 TFUE)[8]. Les libraires se trouvaient contraints de respecter un prix fixe, et ne pouvaient donc établir librement leurs conditions de vente : dès lors le commerce entre Etats membre se trouvait affecté. La Cour de Justice avait refusé l’argumentaire tendant à démontrer qu’un tel système pouvait bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101§ 2, et avait invalidé l’accord.
La situation française par rapport au prix unique du livre était différente, en ce que tout d’abord la réglementation était d’origine légale, et qu’ensuite celle-ci n’avait vocation à s’appliquer que sur le territoire national. La Cour de Justice confrontée à une question préjudicielle portant sur la validité d’une telle loi avait tiré les conséquences de la spécificité de la situation par rapport à l’arrêt de 84. Ainsi, dans un arrêt Leclerc et autres contra SARL « Au Blé Vert » de 1985 la Cour avait considéré que le droit européen de la concurrence ne s’oppose pas à une loi nationale imposant que le prix de vente au détail des livres soit fixé par l’éditeur. En effet l’article 85 du Traité vise les accords entre entreprises, alors que la loi Lang n’impose pas aux éditeurs et aux détaillants de fixer un prix ensemble, mais créée une obligation unilatérale à la charge de l’éditeur. Néanmoins la Cour posait la réserve de la nécessité de respecter les autres dispositions du Traité, plus particulièrement celles relatives à la libre circulation des marchandises. Tant que la loi n’entravait le mouvement d’importation et d’exportation des livres vers d’autres Etats membres, elle était licite au regard du droit de l’Union.
Il est légitime de s’interroger sur l’issue d’un examen éventuel de la loi du 26 mai 2011 par la Cour de Justice. L’article 101 TFUE énonce clairement que sont interdits les accords consistant à « fixer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ». La Cour de Justice a eu l’occasion de préciser que bien que l’article s’intéresse aux accords entre entreprises, cela ne dispense pas les Etats d’éviter d’adopter des règlementations susceptibles d’éliminer l ‘effet utile des règles de concurrence.[9]
Certes, l’article 101§3 TFUE permet d’obtenir une exemption pour un accord, mais les conditions sont strictes. Celui-ci doit contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. De plus la norme est soumise au test de nécessité et proportionnalité. Comme déjà expliqué ci-dessus, en matière de livre numérique il ne semble pas nécessaire d’instaurer un prix fixe pour promouvoir la culture et la diversité des produits proposés. Dès lors il apparaît difficile que la loi du 26 mai 2011 puisse bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101§3 TFUE.
Il est vrai que dans son arrêt Leclerc la Cour de Justice arrivait la conclusion qu’en l’état, le droit européen n’interdisait pas à un Etat d’établir par une disposition législative un prix unique pour le livre. Mais il faut aussi considérer qu’à l’époque de nombreux pays en Europe avaient mis en place un tel système. Or en matière de livre numérique la France est pour l’heure seule à avoir légiférer. Cela pourrait pousser la Cour à prendre une position différente, dans l’hypothèse où elle se trouverait dans la situation d’examiner la loi du 26 mai 2011.
- La légalité du prix unique sous le prisme des libertés de circulation
Les articles 49 et 56 TFUE interdisent les restrictions à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement. C’est au regard de ces deux libertés que la loi pose le plus de difficultés. La Cour de Justice considère qu’une restriction peut résulter d’une mesure qui ne discrimine pas en fonction de la nationalité, dès lors qu’elle rend moins attractif l’exercice de ces deux libertés.
Afin de vérifier si la loi relative au prix du livre numérique est valide au regard du droit européen il est nécessaire de procéder en trois temps : vérifier si celle-ci constitue une restriction à la liberté de prestation de services ou d’établissement ; dans l’affirmative vérifier si la restriction peut être justifiée ; enfin, s’assurer que la mesure en cause soit réellement nécessaire afin d’obtenir le résultat recherché et qu’elle soit proportionnée.
En l’espèce, il apparaît assez clairement que la loi constitue une restriction. Les distributeurs étrangers voulant proposer des livres numériques sur le marché français se voient appliquer la loi en vertu de son article 3, qu’ils soient établis dans un autre Etat membre et proposent simplement à la vente des livres en France, ou qu’ils choisissent de s’établir en France. Dès lors le fait de ne pas pouvoir choisir librement leur prix apparaît comme une restriction et à la liberté de prestation de services et à la liberté d’établissement.
Il convient donc de voir si la mesure peut être justifiée. Au niveau des justifications la Cour distingue entre les mesures discriminatoires et non-discriminatoires : ces dernières peuvent être justifiées par la théorie jurisprudentielle des « raisons impérieuses d’intérêt général » ; en revanche lorsque la mesure est discriminatoire seuls les motifs énumérés à l’article 36 TFUE peuvent justifier une restriction aux libertés. Selon l’approche concrète de la Cour la mesure semble être discriminatoire. Peu importe en effet que la mesure soit indistinctement applicable, dès lors qu’elle aboutit de facto à défavoriser les opérateurs étrangers. En l’espèce c’est justement le prix qui constitue le moyen de concurrence principal de ces derniers pour s’affirmer sur un marché où les détaillants français sont déjà implantés. En imposant un prix fixe en matière de livre numérique la France crée une mesure défavorisant indirectement les opérateurs étrangers.
Dès lors, la loi du 26 mai 2011 ne saurait être justifiée pour un motif autre que ceux énumérés à l’article 36. Or, la protection de la « diversité de l’offre culturelle » ne figure pas parmi ces derniers. De plus, même dans l’hypothèse où la mesure serait jugée non-discriminatoire, et si l’on pouvait invoquer un tel intérêt, encore faudrait-il que la loi passe le test de nécessité. Mais, comme déjà souligné, le prix fixe ne semble pas de façon évidente contribuer à la diversité de l’offre et à l’accessibilité, du moins pour le livre format numérique.
Il apparaît donc au regard de cette analyse, que dans le cas où la Cour de Justice serait amenée à se prononcer sur la loi du 26 mai 2011, celle-ci encourrait un fort risque d’être invalidée, du moins en l’état actuel.
Bibliographie
Loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique
Rapport n° 339 (2010-2011) de Mme Colette MÉLOT, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 9 mars 2011
http://www.senat.fr/rap/l10-339/l10-339.html
Rapport du 16 avril 2011, M. Hervé Gaymard
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3318.asp
Première notification : avis circonstancié et observations de la Commission Européenne du 13 décembre 2010
http://www.senat.fr/rap/l10-339/l10-3399.html#toc41
Deuxième notification : avis circonstancié et observations de la Commission Européenne du 31 janvier 2011
http://www.senat.fr/rap/l10-339/l10-33910.html#toc42
Autorité de la concurrence, Avis n° 09-A-56 du 18 décembre 2009 relatif à une demande d’avis du ministre de la culture et de la communication portant sur le livre numérique
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09a56.pdf
Rapport du 18 septembre 2013 sur la proposition de loi tendant à ne pas intégrer le prestation de la livraison à domicile dans le prix unique du livre,
M. C. Kert
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r1385.pdf
Proposition de loi tendant à ne pas intégrer le prestation de la livraison à domicile dans le prix unique du livre, 26 juin 2013
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1189.asp
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:FR:NOT
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:NOT
Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 10 janvier 1985 « Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc et autres contre SARL "Au blé vert" et autres » (Affaire 229/83)
Arrêt de la Cour du 30 novembre 1995 Reinhard Gebhard contre Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 octobre 2000 « Echirolles Distribution SA contre Association du Dauphiné e.a »
Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 30 avril 2009 « Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft contre Libro Handelsgesellschaft mbH”
Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 juillet 2012 « Usedsoft Gmhb contre Oracle International Corp »
L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle, Edition Puf, 13 mars 2013
Ipsos Meadict, CNL- Etude sur les publics du livre numérique, 2010
Mme M. Dournes, « Le prix unique du livre au regard du droit européen », Bulletin des Bibliothèques de France, 1988, n° 1-2, p. 88-102
Culture Prospective, Ministère de la Culture, juin 2010 « Modèles économiques d’un marché naissant : le livre numérique » par Mme F. Benhamou, Mme O. Guillon
http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-livrenumerique-2010-2.pdf
Syndicat de la Librairie française, Les cahiers de la Librairie, « 25 ans de Loi Lang », par Mme S. Lieber, mai 2007
http://www.syndicat-librairie.fr/images/documents/cahiers_slf_6_2.pdf
Syndicat National de l’Edition, Dossiers et Enjeux « Prix Unique du Livre »
http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/prix-unique-du-livre.html
Site Toute L’Europe.EU, interview à M.H. Gayamrd « La notion de diversité culturelle doit aussi s'appliquer à la directive services pour les biens culturels”, 25 février 2011
Site Toute L’Europe.EU « Un pays Européen peut-il imposer un prix unique pour les livres numériques dans ses frontières ? », 19 mai 2011
Communiqué de presse de la Commission Européenne, 6 décembre 2012 « Antitrust : la Commission ouvre une enquête formelle concernant les ventes de livres électroniques »
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1509_fr.htm?locale=fr
Site, Blog de Maître P. Reynaud « Le livre numérique et le contrat d’édition »
http://www.reynaud-avocat.com/livre-numérique-et-contrat-d-édition/
M.Plener, Le livre numérique et l’Union Européenne, Edition L’Harmattan, 1 décembre 2003
A. Cenk Keskin, Pour un nouveau droit international de la concurrence, Edition L’Harmattan, 18 décembre 2009
Revue Lamy de la Concurrence, « Livre numérique et droit de la concurrence : quelles implications pour les acteurs du secteurs? », par Mme P. Le More, Mme J. Riffault-Silk, M. G. de Muizon avril-juin 2012
http://www.lemore-legal.com/trarticles/rlc31_livrenumerique.pdf
Assemblée Nationale, Projet de loi de finances pour 2014, amendement n°II-22
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1395C/AN/22.asp
Site Actualitté - les univers du livre « Etats-Unis : un procès historique pour l ‘édition autour du livre numérique », 1 juin 2013
E. Scaramozzino, E-U : Entente sur le prix des eBooks : Obligations imposées à Apple sous surveillance d’un expert tiers, Cabinet Scaraye, 25 juillet 2007
Le Monde.fr La loi « anti-Amazon » votée par le Parlement A. Beuve-Méry, 9 janvier 2014
[1] Mme M. Dournes, « Le prix unique du livre au regard du droit européen », Bulletin des Bibliothèques de France, 1988, n° 1-2, p. 88-102
[2] Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 10 janvier 1985 « Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc et autres contre SARL "Au blé vert" et autres » (Affaire 229/ 83)
[3] E. Scaramozzino, E-U : Entente sur le prix des eBooks : Obligations imposées à Apple sous surveillance d’un expert tiers, Cabinet Scaraye, 25 juillet 2007
[4] Autorité de la concurrence, Avis n° 09-A-56 du 18 décembre 2009 relatif à une demande d’avis du ministre de la culture et de la communication portant sur le livre numérique
[5] Revue Lamy de la Concurrence, « Livre numérique et droit de la concurrence : quelles implications pour les acteurs du secteurs? », par Mme P. Le More, Mme J. Riffault-Silk, M. G. de Muizon avril-juin 2012
[6] Rapport n° 339 (2010-2011) de Mme Colette MÉLOT, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 9 mars 2011
[8] Article 101 TFUE 1. « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur... »
[9] CJUE, 10 janvier 1985 « Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc et autres contre SARL Au blé vert et autres »