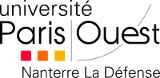Répondre au commentaire
LA LIBERTE D’ETABLISSEMENT ET LE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL. Une jurisprudence militante : la liberté d’établissement comme bouclier aux tentatives étatiques de régulation du transfert de siège, par Mathilde Boucton et Sarah O'Neil (avril 2014)
En effet, l'objectif principal du Traité de Rome de 1957 étant la réalisation d’un marché commun, les libertés de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ont été consacrées sur le territoire de l'Union européenne. A ce titre, il était indispensable pour assurer la libre circulation des personnes morales, de lui reconnaître la liberté d’établissement, qui est devenu son corollaire; comme le souligne Thomas Mastrullo « à quoi bon circuler si on ne peut s’établir ?[3] ».
Cette liberté d’établissement est consacrée aux articles 49 et 50 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et c’est notamment sur ce fondement que vont porter les débats relatifs au transfert de siège social au sein de l’Union européenne. Il faut au préalable préciser que le transfert de siège social n’est pas la seule opération de délocalisation possible, on trouve aussi la fusion et la transformation. Ces différentes opérations emportent toutes des conséquences importantes, soulevant les épineuses questions du droit applicable et de la reconnaissance des sociétés.
Afin de déterminer le droit applicable à une société, la lex societatis, différents critères de rattachement à un ordre juridique ont été dégagés en droit international privé. En effet, diverses théories existent pour déterminer le rattachement des personnes morales à la législation nationale d’un Etat. Il s’agit des théories du contrôle, du siège ou de l’incorporation.
Si le premier critère dit du « contrôle » est « impuissant à déterminer le rattachement de principe des personnes morales[4] » en revanche, les critères de siège et d’incorporation se partagent la question de la détermination de la lex societatis.
La théorie de l’incorporation est celle que l’on retrouve principalement dans les pays de culture juridique anglo-saxonne et qui confère aux formalités de création de la société, à savoir l’immatriculation, une importance majeure. En effet, c’est le lieu d’immatriculation qui détermine la loi applicable à la société. A l’inverse, d’autres Etats nuancent l’importance de ce critère formel et appliquent la théorie du siège social (appelée aussi théorie du siège réel, pour la distinguer du système d’incorporation). Cette théorie est née de la prise en compte de la potentielle discordance entre le centre de gravité d’une société et le lieu d’accomplissement de la formalité administrative[5]. En effet, dans cette hypothèse « l’identité de localisation du siège social (statutaire) et du siège effectif (réel)[6]» est exigée.
La France, tout comme la majorité des Etats-membres de l’UE[7], a adopté cette théorie, retrouvée à l’article 1837 du code civil et pose une présomption simple tirée du siège statutaire ; cela signifie que le siège statutaire est présumé correspondre au centre réel des activités de la société. Alors, si ces deux sièges sont situés sur le territoire national, la lex societatis sera la loi française.
Cet examen préalable des critères de rattachement, retenus par les Etats-membres de l’UE, se justifie en raison des débats juridiques auxquels ils ont donné lieu.
De manière schématique, il est fait grief à la théorie de l’incorporation de laisser une trop grande liberté de choix de la lex societatis aux personnes morales, sans suffisamment protéger les Etats contre la fraude, notamment en matière fiscale. Quant à la seconde théorie, il lui est le plus souvent reproché de constituer un frein, voire une entrave au principe européen de liberté d’établissement. A cet égard, la position adoptée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est avérée centrale étant donnée l’absence d’harmonisation régionale du droit privé sur ces questions. A ce titre, certains auteurs ont parlé d’une « jurisprudence militante » de la Cour[8]. En effet, la CJCE a dû trancher des litiges relatifs à la détermination de la lex societatis, sans consacrer l’une ou l’autre des théories.
La question qui découle de cette jurisprudence est de savoir comment s’articulent liberté d’établissement et diversité des critères de rattachement au sein de l’UE.
Cette problématique soulève des enjeux importants, à la fois économiques et politiques. Ces derniers sont liés à la pratique du law shopping qui pourrait inciter les acteurs économiques à défavoriser certains territoires de l'UE en exploitant les particularismes législatifs. Les tensions résultant de ces comportements pourraient alors avoir d'importantes répercussions sur la scène politique.
SOMMAIRE
I) VERS UNE REGLEMENTATION RELATIVE AU TRANSFERT DE SIEGE INTRA-EUROPEEN : UNE DEMARCHE INCERTAINE……………………………….…………………….5
II) LA SAGA CENTROS – SEVIC SYSTEM: UNE LIBERALISATION CROISSANTE DU DROIT D'ETABLISSEMENT……………………………………………………………………………...….11
III) UNE JURISPRUDENCE AFFIRMEE EN FAVEUR DE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT…………………………………...……………………………….……..……..15
- Vers une réglementation relative au transfert de siège intra-européen : une démarche incertaine
L’absence de législation européenne sur le transfert de siège social (A), bien que le statut de la société européenne, ait lui finalement émergé (C), a sans doute incité la Cour de justice de l’Union européenne à prendre position en faveur d’un droit d’établissement quasi-illimitée (B).
- Les sociétés au cœur de la réalisation du marché intérieur
En 1957, lorsqu’est adopté le Traité de Rome instituant la communauté économique européenne (Traité C.E.E.) les six Etats membres originaires se fixent pour ambition de parvenir à la réalisation d’un marché commun[9]. En effet, l’article 2 du Traité C.E.E. dispose « La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques des Etats membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la communauté (…) ».
L’effectivité du marché intérieur, reposant sur les quatre libertés de circulation, n’est de toute évidence possible, qu’en gommant certains particularismes nationaux. A ce titre, le Traité prévoit « le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun[10] » et comprend également des dispositions invitant à un tel rapprochement dans des domaines particuliers, à l’instar du droit des sociétés visé à l'article 50 alinéa 2 g) du TFUE. Selon les professeurs Klaus Hopt et Richard Buxbaum, les Etats membres auraient, par ces dispositions, insisté sur l’importance du droit des sociétés considéré comme l’une des « clefs du processus d’intégration européenne »[11].
Le rapprochement des droits nationaux en matière de droit des sociétés peut naître, comme le précise T. Mastrullo dans son ouvrage[12], des Etats membres eux-mêmes ou bien des institutions européennes. En effet, la première possibilité, posée à l’article 293 du Traité C.E., prévoyait la négociation de conventions entre les Etats membres afin de favoriser « la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes ». Néanmoins, cette disposition ayant été abrogée avec l’adoption du Traité de Lisbonne, c’est par la voie du droit européen dérivé que ce rapprochement s’effectue désormais, et plus précisément au moyen des deux outils que sont le Règlement européen et la Directive européenne.
Treize directives ont été adoptées mais aucune n’a réglé la question du transfert de siège social des sociétés nationales (voir ci-après les développements sur la création de la société européenne). Or, cette mobilité opérée à travers le transfert de siège social est un droit auquel peuvent prétendre les sociétés au regard du principe de la liberté d’établissement, adopté dès le Traité C.E.E.[13].
Ce principe est désormais consacré aux articles 49 et suivants du TFUE. Comme le résume G. Santoro, il s’agit de « [donner] aux sociétés établies dans les différents Etats membres de l’Union européenne la possibilité de développer leurs activités transfrontalières »[14]. Ces dispositions participent ainsi pleinement à l’objectif de réalisation d’un marché intérieur et plus largement de développement de l’activité économique au sein de l’Union européenne ; elles placent à nouveau la société au cœur du sujet. Les Etats membres ne peuvent donc prendre des mesures susceptibles d’empêcher ou d’entraver la mobilité intra-européenne des sociétés.
L'objectif de rapprochement des législations prévu par le droit primaire cherchait à minimiser les difficultés résultant de la diversité des critères de rattachement retenus par les Etats-membres.
En effet, la Commission a, à l’occasion du projet de première directive[15], considéré que ce rapprochement visait « l’accompagnement de la liberté d’établissement afin d’assurer son effectivité et la correction des effets adverses que la liberté d’établissement risque de faire encourir aux Etats [16]».
Concernant le transfert de siège social, cet accompagnement a été abordé de manière originale. Les institutions européennes ont élaboré un statut parallèle, celui de la société européenne; longtemps resté en gestation il a finalement permis le transfert de siège sans qu'une dissolution puis une nouvelle création de personne morale soit nécessaire.
- L’inertie institutionnelle dénoncée par la CJCE
Dès novembre 1965, un premier projet portant sur la création d’un statut uniforme de société européenne (SE) a été initié par la Commission. Néanmoins, le texte final n’a vu le jour que plus de trente ans après l’engagement des négociations interinstitutionnelles. Ce statut définitif de la SE a nécessité de longues négociations sur les différentes conséquences d’un tel texte (notamment sur les implications sur le statut des travailleurs de la SE) et a été finalement adopté dans un contexte où les institutions européennes ont, à travers différents canaux, favorisé cette initiative.
L’un des moteurs de l’évolution du traitement européen de la problématique du transfert de siège a été la Cour de justice européenne. A cet égard, l’arrêt Daily Mail en 1988[17] en fait la démonstration. Cet arrêt a, comme le souligne T. Mastrullo « révélé que les travaux communautaires relatifs aux opérations transfrontalières des sociétés étaient au point mort en insistant sur la divergence des législations nationales »[18]. En l’espèce, il s’agissait d’une société établie en Angleterre souhaitant, afin de profiter d’une fiscalité plus avantageuse, transférer son siège social de direction aux Pays-bas. Au regard des critères de rattachement respectifs des deux Etats (tous deux ayant opté pour le système de l’incorporation) cette opération était envisageable. Néanmoins, l’Etat d’origine soumettait un transfert du siège de direction (critère de résidence fiscale) à un accord préalable des autorités fiscales. Ainsi, confronté au refus de ces autorités, la société Daily Mail a soutenu qu’il s’agissait d’une violation de son droit d’établissement et c’est à ce titre que la High Court a soumis une question préjudicielle à la CJCE. Dans son arrêt, la Cour ne considère pas ce refus des autorités fiscales britanniques comme une entrave à la liberté d’établissement puisque cet accord préalable de l’administration fiscale n’est exigé que si la société souhaite préserver sa personnalité juridique lors du transfert de siège[19].
La Cour déplore à plusieurs reprises l’absence d’harmonisation à l’échelle européenne sur cette question[20]. En effet, au point 19 elle rappelle que « contrairement aux personnes physiques, les sociétés sont des entités créées en vertu d'un ordre juridique et, en l'état actuel du droit communautaire, d'un ordre juridique national. Elles n'ont d'existence qu'à travers les différentes législations nationales qui en déterminent la constitution et le fonctionnement » et ajoute ensuite au point 21 que « les législations des Etats membres diffèrent largement en ce qui concerne (…) le lien de rattachement » pour finir sur l’absence de « directive de coordination[21] » adoptée en la matière.
A travers cet arrêt, la Cour luxembourgeoise confronte ainsi sans détour les institutions européennes au déficit d’uniformisation et à l’échec de l’objectif de rapprochement des législations nationales.
Parallèlement à cet arrêt, l’évolution du droit primaire européen a également contribué à précipiter l’adoption de mesures plus favorables à la liberté d’établissement. En effet, avec l’adoption du Traité d’Amsterdam en 1997, entré en vigueur en 1999, les compétences européennes en droit international privé ont été accrues[22]. Puis, l’avènement du Traité de Lisbonne en 2007 (entré en vigueur en 2009) a prévu expressément à l’article 81, paragraphe 2, c), la compétence de l’Union pour l’adoption de mesures visant à « la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence »[23].
Enfin, un autre indicateur des mutations relatives à la mobilité des sociétés dans l’espace européen est l’abrogation de l’article 293 du Traité CE (cf supra). Cet article avait certes déjà été interprété par la CJCE comme ne constituant pas une réserve de compétence législative aux Etats membres[24], mais la disparition de cette disposition incitant les Etats membres à engager des négociations pour favoriser les transferts transfrontaliers semble témoigner de l’influence croissante de l’Union sur le phénomène de migration intra-européenne des sociétés.
C’est dans ces circonstances que s’est inscrit le projet final instituant une Société Européenne.
- La création de la Société Européenne : une solution partielle à la mobilité des sociétés
L’accord sur la Société Européenne, finalisé lors du Sommet de Nice, a pris la forme d’un Règlement européen, le Règlement 2157/2001/CE adopté le 8 octobre 2001. Ce statut, après avoir été freiné par l’absence d’harmonisation fiscale, par de longues hésitations quant à la nature du dispositif[25], et par les nouvelles adhésions à l’Union européenne, a donc donné naissance à la Societas Europaea.
Il s’agit d’une société anonyme régie par la législation européenne. Cette société doit selon les dispositions en vigueur, conserver son siège réel dans le même Etat où se situe son siège statutaire, comme le précise expressément l’article 7 du Règlement de 2001 qui dispose : « Le siège statutaire de la SE est situé à l’intérieur de la Communauté, dans le même Etat membre que l’administration centrale. ». Cette disposition peut s’expliquer du fait de la dualité des systèmes de rattachement au sein de l’UE. L’adoption de la théorie du siège réel pour la société européenne semble avoir été choisie pour ne pas limiter la liste des Etats membres où elle pourrait s’installer. A cet égard, l’article 8, paragraphe 1 du Règlement dispose que « Le siège statutaire de la SE peut être transféré dans un autre Etat membre conformément aux paragraphes 2 à 13. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. ». La mobilité accrue de la SE est l’un des facteurs déterminants du recours à cette forme juridique[26].
Toutefois, en dépit de cet aspect attractif, la SE a subi les critiques de la doctrine et de la pratique. La SE resterait rattachée à un système national, qui combinerait un « double rattachement national et européen[27] », et ne serait pas une entité supranationale distincte. Le Professeur Brouillaud souligne en effet qu’ « une lecture approfondie du règlement du 8 octobre 2001 fait douter du véritable caractère européen de la SE. [28]» puisque le texte fait plusieurs fois référence au droit national de l’Etat dans lequel la société est immatriculée. Le degré d’indépendance de la SE vis-à-vis du droit de cet Etat de référence est donc limité.
En dépit de ces failles, il n’en reste pas moins que l'avènement de la société européenne illustre la volonté des institutions de faciliter la mobilité au sein de l'Union européenne. Toutefois, s’agissant des sociétés nationales, les modalités de transfert de siège social d’un Etat membre à l’autre ont continué à soulever de nombreuses interrogations quant à l’exercice du droit d’établissement.
Ces questions ayant été soumises à la Cour luxembourgeoise, celle-ci a fourni une jurisprudence nourrie et très évolutive.
A ce titre, il convient de rappeler brièvement les apports de l’arrêt Daily Mail précité puisque c’est à partir de celui-ci que l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice peut être appréciée. En 1988, la Cour consacre dans un premier temps la liberté d’établissement et reconnaît qu’elle « constitue un des principes fondamentaux de la Communauté » et que ces dispositions « assurent le droit de s’établir (…) aux sociétés »[29]. Pour autant, la Cour a finalement retenu dans son arrêt qu’ « on ne saurait interpréter les articles 52 et 58 du traité comme conférant aux sociétés de droit national un droit de transférer leur siège de direction et leur administration centrale dans un autre État membre tout en gardant leur qualité de sociétés de l'État membre selon la législation duquel elles ont été constituées.[30]».
Face à l’absence de règlementations plus complètes relatives à la mise en œuvre du principe d’établissement, la CJUE a, peu à peu, exercé une véritable pression, visant à promouvoir la mobilité des sociétés.
- la saga centros-sevic system: une libéralisation croissante du droit d’établissement
La liberté d’établissement a fait l’objet d’une interprétation toujours plus favorable à la mobilité des sociétés. D’abord, dans l’hypothèse du transfert de siège social, où la motivation des fondateurs a été jugée comme un motif inopérant pour justifier une restriction étatique au droit d’établissement (A et B). Puis, la liberté d’établissement a été jugée applicable aux opérations de fusion et de transformation transfrontalières (C et D).
- L’arrêt Centros : la liberté d’établissement applicable au transfert de siège social
L’arrêt Centros marque un tournant dans la jurisprudence de la Cour concernant le transfert de siège social intra-européen[31].
En l’espèce, la législation de l’Etat d’accueil est en en cause. Une société incorporée aux Royaume-Uni souhaitait établir une succursale au Danemark. Les autorités danoises se sont opposées à cette immatriculation au motif que la société cherchait, en réalité, à établir un établissement principal - son siège effectif se trouvant selon celles-ci au Danemark – en échappant à la législation danoise applicable à la constitution d’une société (on retrouve fréquemment ce cas de figure, les sociétés souhaitant échapper à la libération d’un capital minimum).
La Cour fait jouer le principe de la liberté d’établissement, qu’elle limite toutefois avec la réserve classique de la fraude.
La liberté d’établissement conférée par le droit de l’Union européenne permet la constitution d’une société, dans un Etat membre et dans le même temps la constitution d’une succursale dans un autre Etat membre.
La CJCE affirme ainsi qu’il est possible pour une société de constituer une société dans un Etat membre et une succursale dans un autre le même jour.
La Cour va plus loin, en ajoutant, que cette faculté « inhérente » au droit d’établissement persiste quand bien même le but de cette opération serait de bénéficier d’une législation moins contraignante.
Les Etats membres d’accueil – dans l’hypothèse susvisée – ont néanmoins la possibilité de prendre « toute mesure de nature à prévenir ou sanctionner les fraudes » si il est établi que les associés cherchent en réalité à échapper à leurs obligations, vis à vis des créanciers, établis sur son territoire.
La Cour considère cependant que le refus d’immatriculation de la société par les autorités danoises constitue une restriction non justifiée alors même que les associés cherchent à éviter l’exigence de capital minimum.
Cette décision a fait l’objet de nombreuses critiques. La solution posée par la CJCE semble considérer le droit d’établissement comme un droit « absolu » dont l’exercice ne peut être restreint. En effet, bien que l’Etat ait une certaine marge de manœuvre, par le biais de la fraude, cette limite parait bien théorique dans la mesure où elle ne semble pas caractérisée par le fait que les associés aient agi dans le but de bénéficier d’une législation plus avantageuse.
Les Etats ne semblent disposer des armes nécessaires pour résister au law shopping.
- La reconnaissance imposée des sociétés constituées conformément à la législation d’un autre Etat membre
L’arrêt Uberseeing[32] met en cause une société de droit néerlandais, gouvernée depuis les Pays bas, qui est cédée à des repreneurs allemands. La société ayant pour seul objet l’exploitation d’un terrain situé en Allemagne, tous les critères de rattachement (nationalité des associés, lieux d’exécution et de la prise de décision) désignent désormais cet Etat. Un litige éclate entre la société et l’un de ses créanciers.
Le critère de rattachement retenu par le droit allemand à l’époque était celui du siège (la loi applicable est celle du lieu où la société à son siège, le siège statutaire devant correspondre au siège réel). Par conséquent, les juridictions allemandes déclarent que la société n’avait pas la capacité d’ester en justice en raison de la dissociation entre son siège réel (Allemagne) et statutaire (Pays-Bas).
La principale question à laquelle devait répondre la CJCE était celle de savoir si les dispositions relatives à la liberté d’établissement s’opposaient à ce que l’Etat dans lequel, une société avait transféré son siège effectif puisse apprécier la capacité juridique de celle-ci alors même qu’elle avait été valablement constituée dans son Etat d’origine ?
Le fait que cette question ne constitue pas une réserve de compétence des Etats membres, ne fait avec cet arrêt, plus aucun doute. De plus, on apprend que l’Etat d’accueil ne peut priver une société, constituée conformément au droit de l’Etat membre d’origine, de sa capacité juridique, bien que celle-ci ait transféré sur son territoire son siège effectif et qu’elle n’y respecte pas le droit applicable.
Une telle mesure constituerait en effet une « négation (…) de la liberté d’établissement »[33]
Les associés peuvent donc, en vertu de la liberté d’établissement, choisir librement la lex societatis et l’Etat membre d’accueil ne peut s’y opposer, le principe de reconnaissance s’imposant dans toute situation, quand bien même le lien avec l’Etat d’origine ne serait plus qu’artificiel.
- Une mise en œuvre du droit d’établissement indifférente aux motivations du transfert de siège social
L'affaire Inspire art[34] a apporté des précisions supplémentaires sur l'exercice de la liberté d'établissement lorsqu'il est confronté à une loi de police d'un Etat-membre.
En l'espèce, une société valablement constituée au Royaume-Uni établit une succursale aux Pays-Bas. Or, la réglementation néerlandaise impose une mention particulière lors de l’inscription d’une filiale étrangère au registre du commerce et des sociétés et que celle-ci l’indique dans la vie des affaires. En réalité, le siège effectif de la société se trouvait au Pays-Bas mais celle-ci souhaitait bénéficier de la législation britannique quant aux règles applicables à la constitution d’une société.
La disposition néerlandaise constituait en l’espèce une loi de police – loi « supra impérative, d’applicabilité immédiate » visant à protéger les créanciers. Une grande partie de la doctrine avait jugé l’application de cette disposition appropriée et justifiée.
Mais la CJCE considère elle, que la disposition, fusse t-elle une loi de police est contraire à la liberté d’établissement. Elle rappelle néanmoins la limite du « comportement abusif et frauduleux » tout en réaffirmant que « le fait qu’une société n’exerce aucune activité dans l’Etat membre où elle a son siège et exerce uniquement ses activités dans l’Etat membre de sa succursale » n’est pas suffisant pour permettre une quelconque restriction à la liberté d’établissement.
La CJCE condamne en l’espèce le simple fait que la législation néerlandaise impose la mention que la succursale appartient à une société étrangère et non pas un refus d’établissement.
- Extension de la jurisprudence Centros aux fusions transfrontalières
L’arrêt Sevic System[35] est rendu au sujet d’un contrat de fusion conclu entre une société allemande et une société luxembourgeoise.
L’inscription au Registre du commerce et des sociétés allemand de cette nouvelle société a été refusée au motif que la législation allemande ne prévoit la fusion que pour des sociétés ayant leur siège sur le territoire allemand. Le droit allemand établit donc une différence de traitement entre la fusion interne et la fusion transfrontalière.
La question principale qui se posait en l’espèce était de savoir si les dispositions relatives à la liberté d’établissement s’appliquaient à l’opération de fusion.
La CJUE répond par l’affirmative et énonce que « le champ d’application du droit d’établissement couvre toute mesure qui permet, ou même ne fait que faciliter, l’accès à un Etat membre autre que celui d’établissement et l’exercice d’une activité économique dans cet Etat, en rendant possible la participation effective des opérateurs économiques intéressés à la vie économique dudit Etat membre, aux mêmes conditions que celles applicables aux opérateurs nationaux. ».[36]
Les opérations de fusions transfrontalières constituent selon la Cour « des modalités particulières de la liberté d’établissement (elles) relèvent donc des activités économiques pour lesquelles les Etats membres sont tenus au respect de la liberté d’établissement (…) [37]
La disposition allemande constitue donc une restriction au droit d’établissement.
La CJUE considère que les motifs de protection des créanciers et la loyauté dans la vie des affaires ne sont pas suffisants pour justifier cette restriction au regard des principes de nécessité et d’équivalence. L’interdiction générale de la fusion transfrontalière « allant au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visant à protéger lesdits intérêts ».[38]
Comme le soulignent Bernard Audit et Louis d’Avout, la CJCE en adoptant une méthode unilatéraliste (et non pas conflictuelle), étant donné que la société est systématiquement rattachée à l’Etat où elle a son siège statutaire (où elle a donc été constituée), donne une nouvelle solution au conflit de systèmes . Cette expression désigne la situation dans laquelle la situation juridique apparaît dépourvue d’attaches suffisantes avec le for, de ce fait, le juge ne devrait pas faire application de sa propre règle de conflit mais de la règle de conflit étrangère présentant les liens les plus caractérisés avec la situation litigieuse. La CJCE consacre donc dans une telle hypothèse « la reconnaissance imposée des situations juridiques étrangères, au nom d’une liberté économique fondamentale ».[39]
Certains auteurs ont vu dans cette décision, la volonté de la Cour d’anticiper l’application du Règlement européen sur les fusions transfrontalières qui n’était alors pas encore en vigueur. [40]
III. Une jurisprudence affirmée en faveur de la liberté d’établissement
Malgré certaines limites reconnues par la Cour, au droit d’établissement (A), la jurisprudence européenne cherche toujours à promouvoir activement la mobilité des sociétés au sein de l’Union européenne comme en témoigne la reconnaissance d’un droit à la transformation transfrontalière (B).
L’inefficacité des mesures préventives étatiques laisse à penser que les Etats devraient se diriger vers des solutions palliatives (C).
- L’arrêt Cartesio[41] : le refus d’un droit au transfert de siège avec maintien de la loi applicable de l’Etat d’origine
Cet arrêt est rendu par la Cour siégeant en grande chambre. Il a suscité de vives réactions de la part de la doctrine.
Une société hongroise décide de transférer son siège en Italie et demande aux autorités hongroises l’inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés.
La demande est rejetée au motif que la législation hongroise ne permet pas à une société de transférer son siège tout en continuant à être soumise à la loi hongroise en tant que loi personnelle.
Il paraît intéressant de souligner qu’au soutien de ses prétentions, la société invoque la jurisprudence Sevic pour affirmer qu’une différence de traitement prévue par la législation d’un Etat membre, fondée, sur le lieu du siège, est contraire aux dispositions sur la liberté d’établissement[42].
La question préjudicielle qui nous intéresse en l’espèce, est celle de savoir si le droit d’établissement s’oppose à ce que l’Etat membre d’origine puissent refuser le transfert de siège d’une société constituée conformément à son droit national lorsque celle-ci prétend garder cette qualité.
La loi hongroise, retenant comme critère de rattachement celui du siège de direction, ne peut continuer à s’appliquer à la société si celle-ci transfère son siège « en tant que loi régissant son statut »[43] .
Par conséquent, la société doit cesser d’exister en Hongrie pour se reconstituer sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.
La Cour énonce un principe et un obiter dictum tout aussi important.
La CJUE vise la jurisprudence Daily Mail pour rappeler « qu’une société créée en vertu de son droit national n’a d’existence qu’à travers la législation nationale qui en détermine la constitution et le fonctionnement ». (104). Elle ajoute qu’ « un État membre dispose ainsi de la faculté de définir tant le lien de rattachement (…) que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement.[44] (110) ». Or, c’est du fait de sa constitution conforme au droit de son Etat d’origine que la société tire le droit d’établissement. Par conséquent, cet Etat peut refuser le transfert de siège si celui-ci s’accompagne du maintien du droit national alors même que ce transfert met fin au lien de rattachement.
L’obiter dictum énonce en revanche, que lors d’un transfert avec changement de loi applicable, l’Etat d’origine ne peut imposer la dissolution et la liquidation de la société. En effet, cela constituerait alors une « entrave injustifiée »[45] à la transformation transfrontalière, modalité de la liberté d’établissement.
Cette solution a fait elle aussi l’objet de nombreuses critiques doctrinales.
D’une part, la solution manquerait de cohérence. En effet, après avoir affirmé que l’Etat d’origine peut « revendiquer sur (la société) un droit de vie ou de mort dans l’espace européen »[46] , que de ce fait, on ne peut lui imposer le maintien de l’application de sa propre législation si celle-ci retient comme critère de rattachement celui du siège de direction. A l’inverse, dans l’hypothèse où la société déciderait de transférer siège statutaire et réel – le transfert s’accompagnerait donc d’un changement de droit applicable – l’Etat de constitution ne pourrait imposer ni la dissolution, ni la liquidation de ladite société, si une telle transformation est permise par le droit de l’Etat membre d’accueil.
L’Etat d’origine n’a donc aucune marge de manœuvre en cas « d’expatriation » de la société.
Cet arrêt a également donné lieu à diverses interprétations doctrinales.
En effet, certains y ont vu un coup d’arrêt à la liberté d’établissement. D’autres ont considéré qu’en réalité, l’hypothèse de l’arrêt Cartesio se distinguait des arrêts précédents car elle concerne la réglementation de l’Etat d’origine et non de celle de l’Etat d’accueil. Il ne s’agit donc pas d’une remise en cause de la liberté d’établissement. Simplement, dans ce cas le principe de reconnaissance ne trouve pas à jouer.
Cette dernière interprétation semble pertinente au regard de la solution rendue à propos de l’arrêt Vale Epitesi, « miroir inversé » de l’arrêt Cartesio.
- Le droit à la transformation transfrontalière conféré au nom de la liberté d’établissement
L’arrêt Valé Epitesi[47] met en cause une société italienne qui fut radiée, à sa demande, du registre italien en vue de s’établir en Hongrie. Plus d’un an après, la société demande son inscription sur le registre hongrois mais aussi que la société italienne soit mentionnée comme son prédécesseur en droit. Cet enregistrement est refusé, la réglementation ne permettant pas lors d’un transfert de siège social en Hongrie, qu’une société étrangère soit inscrite comme prédécesseur en droit.
La question est donc de savoir si la liberté d’établissement, conférée par le droit de l’Union européenne, s’oppose à ce qu’une législation nationale ne permette pas la transformation d’une société étrangère en société nationale[48].
La transformation est une opération consistant à changer la forme de la société.
Certains auteurs, à l’instar du Professeur Daniel Cohen, contestent la notion même de transformation transfrontalière. En effet, parler de transformation alors qu’en réalité une nouvelle société est créée avec un changement de droit applicable ne va t’il pas à l’encontre de la définition même de la transformation ?
Les autorités hongroises ont invoqué au soutien de leur prétention, le fait qu’à l’inverse de la fusion transfrontalière (arrêt Sevic), la transformation emporte elle, constitution sur le territoire de l’Etat membre d’accueil d’une société.
La CJCE réfutent les arguments des autorités hongroises et accorde un droit à la transformation transfrontalière au nom de la liberté d’établissement.
Celle-ci ne peut en principe être soumise à un régime juridique plus contraignant que celui applicable à la transformation interne. Ce faisant, la mention de prédécesseur en droit étant permise lors d’une transformation interne, elle doit l’être également lors de transformation transfrontalière[49] .
La jurisprudence de la CJUE permet sans conteste un law shopping quasi absolu, bien qu’il soit en théorie interdit par le droit de l’Union européenne. Le droit d’établissement devant, dans la logique de la Cour, produire ses pleins effets au nom de l’objectif de constitution du marché intérieur.
Or, une telle conception du droit d’établissement paraît contestable compte tenu de l’absence d’harmonisation des législations des Etats membres.
Le traitement accordé au critère de rattachement du siège par la Cour amène à se demander si celle-ci n’a en réalité pas fait le choix de l’incorporation.
En effet, bien que la Cour ne condamne pas formellement le critère de rattachement du siège, ses effets sont très affaiblis par sa jurisprudence. L’un des intérêts principaux de ce critère étant d’empêcher une société n’exerçant plus d’activité sur le territoire de son Etat d’origine d’échapper à la législation nationale et à l’inverse d’obliger celle-ci à appliquer la législation de l’Etat d’accueil si elle y a transféré ses activités.
La Cour a néanmoins limité cette application libérale du droit d’établissement à travers les notions de fraude et d’abus. Mais, les conditions de mise en œuvre des « limites » rendent celles-ci inefficaces.
- Inefficacité des mesures préventives : vers des mesures curatives ?
Le droit d’établissement ne connaît que peu de limites. En effet, seule la fraude et l’abus peuvent justifier une mesure restrictive prise par un Etat ou elle doit être prise pour des motifs impérieux d’intérêt général et justifiée au regard des principes de nécessité et d’équivalence.
Or, ces limites sont formelles. Tout d’abord, la Cour ne considère pas que la fraude soit caractérisée quand le transfert a pour seul but de bénéficier d’une législation plus avantageuse et que la société n’a plus aucun lien ou juste artificiel avec la société. Pour ce qui est des motifs impérieux d’intérêt général, ceux invoqués par les Etats ne semblent jamais être suffisants. L’objectif de protection des créanciers et de loyauté dans la vie des affaires (classiquement invoqués en droit des sociétés) ne permettant jamais, au regard de la jurisprudence actuelle de la CJUE, de faire échec à l’application du droit d’établissement et de ses modalités.
Il semble que les limites classiques telles que la fraude mais aussi les loi de police et l’ordre publique ne seraient reconnues que théoriquement.
Au regard de l’inefficacité des moyens préventifs, B. Audit et L. d’Avout soulignent qu’il existerait d’autres moyens pour faire échec aux contournements des lois nationales désavantageuses par certaines sociétés migrantes.
Ces auteurs suggèrent une lecture de la jurisprudence européenne qui préconiserait l’exercice d’une « protection curative plutôt que préventive, des intérêts locaux »[50]. Cette suggestion est née du constat du refus de la Cour de justice, dans les arrêts Centros et Inspire Art, de valider la sanction préventive opposée par les Etats d’accueil. Dans ces deux arrêts, les autorités nationales trouvées en contradiction avec la liberté d’établissement, justifiaient les mesures en cause (refus d’immatriculation de la succursale et l’application de règles impératives locales) par leur volonté de protéger les créanciers nationaux. Or, il semblerait que par ses décisions, la Cour ait incité les autorités à se tourner davantage vers des moyens de protection curative des créanciers, moyens pouvant être puisés dans le droit national (engagement de la responsabilité des dirigeants ou droit des procédures collectives notamment).
Face à cette jurisprudence pléthorique et innovante, l’absence persistante de réglementation européenne sur le transfert de siège est surprenante, compte tenu notamment de la diversité des législations des Etats membres concernant cette question, qui se trouve bien démunis face à la faveur dont la Cour faveur à une mobilité que rien ne semble devoir entraver.
Il faut néanmoins souligner que l’activité de l’Union n’en est pas au point mort puisque le processus de rapprochement des législations en matière de transfert transfrontalier a été enclenché. En 1999, un premier avant-projet d’une quatorzième Directive a été lancé mais le législateur européen n’a pas réussi à trouver l’équilibre permettant de concilier les divers intérêts des parties prenantes en présence. Celle-ci n’a donc pas été concrétisée « malgré ses qualités »[51]. Toutefois, la perspective d’un texte uniforme n’a pas été abandonnée puisqu’elle a été réaffirmée par la Commission européenne dans son Plan d’action du 21 mai 2003, où elle précise son « intention de présenter à court terme (…) une proposition de quatorzième directive sur le droit des sociétés, qui concernera le transfert du siège social d'un État membre à l'autre[52]. » Cet objectif a été réitéré dans une résolution du Parlement européen du 2 février 2012, contenant des « recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire »[53].
Dans cet élan de mobilisation institutionnelle, une consultation publique en ligne a été initiée par la direction du marché intérieur et des services le 20 février 2012[54]. Parmi les enjeux de cette consultation, se trouve « [l’amélioration] de l’encadrement des opérations transfrontalières des entreprises[55] ». C’est à cette occasion que le Club des juristes de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – think tank juridique français regroupant praticiens, entreprises, magistrats et professeurs[56]- a imaginé le texte qui pourrait incarner cette quatorzième Directive[57]. Cette remobilisation laisse entrevoir une éventuelle clarification de la part des institutions législatives de l’Union européenne de la portée à accorder à la liberté d’établissement mais l’échéance est encore très incertaine.
BIBLIOGRAPHIE
- TRAITES
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11957E/TXT:FR:PDF
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_FR.pdf
TRAITE SUR L’UNION EUROPEENNE, disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:fr:PDF
TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE, disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:fr:PDF
- JURISPRUDENCE ET NOTES
ARRET DAILY MAIL : Affaire 81/87 – Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988 - Daily Mail and General Trust plc
ARRET CENTROS : Affaire C-212/97, Arrêt de la Cour du 9 novembre 1999– Centros Ltd contre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
ARRET UBERSEERING : Affaire C-208/00, Arrêt de la Cour du 5 novembre 2002 – Überseering BV contre Nordic Construction Company Baumanagement GmBH
ARRET INSPIRE ART : Affaire C-167/01, Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003 - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam contre Inspire Art Ltd.
ARRET CARTESIO : Affaire C-210/06, Arrêt de la Cour du 16 juillet 2008, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt.
ARRET VALE ESPITESI : Affaire C-378-10, Arrêt de la Cour du 12 juillet 2012, Vale epitesi ktf
CJCE, 9 MARS 1999, AFFAIRE C-212/97, REC. 1999, I-1459, D. 1999, p. 550, note M. MENJUCQ, Rev. societes 1999, p. 386, note G. PARLEANI, RTD. COM. 2000, p. 224, OBS. G. JAZOTTES, disponible sur : http://www.dalloz.fr.faraway.u-sparis10.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f1999%2f2020&FromId=REVDIP_CHRON_2003_0042#TargetSgmlIdRECUEIL/JURIS/1999/2020
CJCE, 5 NOVEMBRE 2002, AFFAIRE C-208/00, INFRA, p. 508, avec la note de P. LAGARDE, Rev. societes 2003, p. 315, note J. DOM, disponible sur : http://www.dalloz.fr.faraway.u-paris10.fr/documentation/Document?id=REVSOC%2fCHRON%2f2003%2f0024&FromId=REVDIP_CHRON_2003_0042#TargetSgmlIdREVSOC/CHRON/2003/0024
- OUVRAGES
B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit international privé, 7e édition refondue, Economica 2013
T.MASTRULLO, Le Droit international des sociétés dans l’espace régional européen, PUAM, 2009
A. COTIGA, Le Droit européen des sociétés, compétition entre les systèmes juridiques dans l’union européenne, Editions Larcier, 2013
M. MENJUCQ, Droit international et européen des sociétés, Montchrestien, 2010
R.M. BUXBAUM et K.J. HOPT, Legal harmonization and the Business nterprise, Corporate and Capital Market Law Harmonization Policy in Europe and the U.S.A., 1988, Walter de Gruyter, Berlin.
- REVUES
M. TALY, La fiscalité incite-t-elle à délocaliser, Risques : les cahiers de l’assurance - FFSA, septembre 2008 N°75, disponible sur : https://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/html/Risques_75_0018.htm
G.SANTORO « L'évolution du principe de liberté d'établissement en droit communautaire : un mouvement de libéralisation depuis l'arrêt Cartesio », Revue internationale de droit économique 3/2010 (t.XXIV), disponible sur : www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2010-3-page-351.htm
Y. LOUSSOUARN, « Le droit d’établissement des sociétés », Revue trimestrielle de Droit Européen, 1990, disponible sur : http://www.dalloz.fr.faraway.u-paris10.fr/documentation/Document?id=RTDEUR%2fCHRON%2f1990%2f0022&FromId=REVDIP_CHRON_2003_0042#TargetSgmlIdRTDEUR/CHRON/1990/0022
J.-P. BROUILLAUD, « la SAE : la « société approximativement européenne » », Juris-classeur périodique, éd. E, 2007, 1100, disponible sur : http://www.lexisnexis.com.faraway.u-paris10.fr/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T19125807638&format=GNBFULL&sort=null&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T19125807642&cisb=22_T19125807641&treeMax=true&treeWidth=0&csi=268086&docNo=5
LEXISNEXIS, « projet de 14e directive sur les transferts des sièges sociaux – présentation du rapport de la CCIP et des travaux du Club des juristes » Cahiers de droit de l’entreprise, Novembre 2011, n°6, disponible sur : http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/cahiers-droit-entreprise/06-2011/040_PS_CDE_CDE1106ET00040.htm#.UvFz9Pl5O0A
T. BALLARINO, « Les règles de conflit sur les sociétés commerciales à l’épreuve du droit communautaire d’établissement », Revue critique de Droit international privé, 2003, disponible sur : http://www.dalloz.fr.faraway.u-paris10.fr/documentation/Document?id=REVDIP%2fCHRON%2f2003%2f0042&ctxt=0_YSR0MT1kYWlseSBtYWlswqdkJG5UZXh0ZTI9My8xMsKndCRzMD1ET0NUwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PQ%3d%3d#TargetSgmlIdREVDIP/CHRON/2003/0042
G.PARLEANI, « L’arrêt Cartesio, ou l’ingénieuse incitation à la migration intra communautaire des sociétés », Revue des sociétés, 2009, disponible sur : http://bu.dalloz.fr.faraway.u-paris10.fr/documentation/Document?id=REVSOC%2fCHRON%2f2009%2f0029&ctxt=0_dCRzMD1ET0NUwqdkJHJEYXRlPWxlwqdjJGQ9MTR8MnwxMnwxNnwyMi8yfDIyLzExfDIyLzEwfDIyLzZ8MjIvMTJ8MjIvN3wyMi8yMnwyMi8xNXwyMi80fDIyLzEzfDIyLzI4fDIyLzE2fDIyLzI3fDIyLzI2fDIyLzMwfDIyLzE5fDIyLzF8MjIvM3wyMi8xOHwyMi8yOXwyMi8xNHwxfDE3fDE5wqdhJHQxPXNvY2nDqXTDqSBsaWVuIHJhdHRhY2hlbWVudMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PQ%3d%3d#TargetSgmlIdREVSOC/CHRON/2009/0029
- SITES INTERNET ET RAPPORTS
EUROPA, Synthèse de la législation de l’UE, Affaires institutionnelles, la construction européenne à travers les traités – Traité C.E.E. (version non consolidée), disponible sur : http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_fr.htm
EUROPA, Synthèse des réactions à la communication de la Commision au Conseil et au Parlement européen, disponible sur : http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/governance-consult-responses_fr.pdf
COMMISSION EUROPEENNE, Principes généraux : liberté d’établissement, disponible sur : http://ec.europa.eu/internal_market/services/principles_fr.htm
COMMISSION EUROPENNE, Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d’entreprise, disponible sur : http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_fr.htm
RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN du 2 février 2012, (2011/2046(INI), disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1189221&l=fr&t=E
X. KRAMER, « Lacunes actuelles et perspectives futures du droit international privé européen : vers un code du droit international privé ? », Direction générale des politiques internes, Parlement européen, disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130110ATT58829/20130110ATT58829FR.pdf
INSEE, L. FONTAGNE et A. D’ISANTO, Chaînes d’activité mondiales : des délocalisations d’abord vers l’Union européenne, disponible sur : http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1451/ip1451.pdf
CLUB DES JURISTES DE LA CCIP, disponible sur : http://www.leclubdesjuristes.com/
[1] INSEE, L. FONTAGNE et A. D’ISANTO, Chaînes d’activité mondiales : des délocalisations d’abord vers l’Union européenne, disponible sur : http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1451/ip1451.pdf
(Etude réalisée sur les entreprises marchandes non financières, de 50 salariés ou plus).
[2]M. TALY, La fiscalité incite-t-elle à délocaliser, Risques : les cahiers de l’assurance - FFSA, septembre 2008 N°75, disponible sur : https://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/html/Risques_75_0018.htm
[3] T.MASTRULLO, Le Droit international des sociétés dans l’espace régional européen, PUAM, 2009, p.41
[4] BERNARD AUDIT, LOUIS D’AVOUT, Droit international privé, 7e édition refondue, Economica 2013, p.925, §1045
[5] BERNARD AUDIT, LOUIS D’AVOUT, Droit international privé, 7e édition refondue, Economica 2013, p.926, §1046
[6] ANDRA COTIGA, Le Droit européen des sociétés, compétition entre les systèmes juridiques dans l’union européenne, Editions Larcier, 2013, p.151, §205.
[7] Ibid.
[8] T.MASTRULLO, Le Droit international des sociétés dans l’espace régional européen, PUAM, 2009, p.186
[9]EUROPA, Synthèse de la législation de l’UE, Affaires institutionnelles, la construction européenne à travers les traités – Traité C.E.E. (version non consolidée), disponible sur :
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_fr.htm
[10] TRAITE C.E.E. article 3 h)
[11] R.M. BUXBAUM et K.J. HOPT, Legal harmonization and the Business nterprise, Corporate and Capital Market Law Harmonization Policy in Europe and the U.S.A., 1988, Walter de Gruyter, Berlin, p.193
[12]T .MASTRULLO, Le Droit international des sociétés dans l’espace régional européen, PUAM, 2009, p.96.
[13] TRAITE C.E.E., Deuxième partie, Titre III, chapitre 2
[14] G.SANTORO « L'évolution du principe de liberté d'établissement en droit communautaire : un mouvement de libéralisation depuis l'arrêt Cartesio », Revue internationale de droit économique 3/2010 (t.XXIV), p. 351-372.
URL : www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2010-3-page-351.htm.
[15] Directive 68/151/CEE
[16] ANDRA COTIGA, Le Droit européen des sociétés, compétition entre les systèmes juridiques dans l’union européenne, Editions Larcier, 2013, p. 64.
[17] Affaire 81/87 – Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988, disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0081:FR:NOT
[18] T .MASTRULLO, Le Droit international des sociétés dans l’espace régional européen, PUAM, 2009, p.89.
[19] Point 18 de l’arrêt précité.
[20] Y. LOUSSOUARN, « Le droit d’établissement des sociétés », Revue trimestrielle de Droit Européen, 1990, p. 229, disponible sur : http://www.dalloz.fr.faraway.u-paris10.fr/documentation/Document?id=RTDEUR%2fCHRON%2f1990%2f0022&FromId=REVDIP_CHRON_2003_0042#TargetSgmlIdRTDEUR/CHRON/1990/0022
[21] Point 22 de l’arrêt précité.
[22] BERNARD AUDIT, LOUIS D’AVOUT, Droit international privé, 7e édition refondue, Economica 2013, p.937, §1061.
[23] X. KRAMER, « Lacunes actuelles et perspectives futures du droit international privé européen : vers un code du droit international privé ? », Direction générale des politiques internes, Parlement européen, disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130110ATT58829/20130110ATT58829FR.pdf
[24] Affaire C-208/00, Arrêt de la Cour du 5 novembre 2002 – Überseering BV contre Nordic Construction Company Baumanagement GmBH (NCC), disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0208:FR:HTML
[25] A. COTIGA, Le Droit européen des sociétés, compétition entre les systèmes juridiques dans l’union européenne, Editions Larcier, 2013, p.109
[26] Ibid, p. 138
[27] M.MENJUCQ, Droit international et européen des sociétés, Montchrestien, 2010, p. 155
[28] J.-P. BROUILLAUD, « la SAE : la « société approximativement européenneé » », Juris-classeur périodique, éd. E, 2007, 1100, disponible sur : http://www.lexisnexis.com.faraway.u-paris10.fr/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T19125807638&format=GNBFULL&sort=null&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T19125807642&cisb=22_T19125807641&treeMax=true&treeWidth=0&csi=268086&docNo=5
[29] Point 15 de l’arrêt Daily Mail
[30] Premier point du dispositif de l’arrêt Daily Mail
[31] Affaire C-212/97, Arrêt de la Cour du 9 novembre 1999– Centros Ltd contre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
[32] Affaire C-208/00, Arrêt de la Cour du 5 novembre 2002 – Überseering BV contre Nordic Construction Company Baumanagement GmBH
[33] Point 93 de l’arrêt Überseering
[34] Affaire C-167/01, Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003 - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam contre Inspire Art Ltd.
[35] Affaire C-411/03, Arrêt de la CJCE du13 décembre 2005 - SEVIC Systems AG
[36] Point 18 de l’arrêt Inspire Art
[37] Point 18 de l’arrêt Inspire Art
[38] Point 30 de l’arrêt Inspire Art
[39] B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit international privé, 7e édition refondue, Economica 2013, p.943.
[40] Ibid.
[41] Affaire C-210/06, Arrêt de la Cour du 16 juillet 2008, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt.
[42] Point 26 de l’arrêt Cartesio.
[43] Point 102 de l’arrêt Cartesio
[44] Point 110 de l’arrêt Cartesio
[45] Point 113 de l’arrêt Cartesio.
[46] B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit international privé, 7e édition refondue, Economica 2013, p.943.
[47] Affaire C-378-10, Arrêt de la Cour du 12 juillet 2012, Vale epitesi ktf .
[48] Point 23 de l’arrêt Vale Epitesi.
[49] Points 43 et 44 de l’arrêt Vale Epitesi
[50] B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit international privé, 7e édition refondue, Economica 2013, p.937, §1066.
[51] T.MASTRULLO, Le Droit international des sociétés dans l’espace régional européen, PUAM, 2009, p.146
[52] EUROPA, Synthèse des réactions à la communication de la Commision au Conseil et au Parlement européen, p. 22, disponible sur : http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/governance-consult-responses_fr.pdf
[53]RESOLUTION du Parlement européen du 2 février 2012, (2011/2046(INI), disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1189221&l=fr&t=E
[54]COMMISSION EUROPENNE, Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d’entreprise, disponible sur : http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_fr.htm
[55] Ibid.
[56]Club des juristes de la CCIP : http://www.leclubdesjuristes.com/
[57] LEXISNEXIS, « projet de 14e directive sur les transferts des sièges sociaux – présentation du rapport de la CCIP et des travaux du Club des juristes » Cahiers de droit de l’entreprise, Novembre 2011, n°6 http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/cahiers-droit-entreprise/06-2011/040_PS_CDE_CDE1106ET00040.htm#.UvFz9Pl5O0A