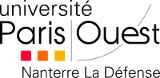Répondre au commentaire
Les nouveaux enjeux juridiques internationaux de l’économie participative, par Kathija Bhatoo
Suite à l’explosion de la crise économique et financière mondiale, les foyers mondiaux ont été généralement touchés par une forte récession. Alors que les effets de la crise semblent désormais s’estomper quelque peu, l’une de ses conséquences demeure : la tendance des populations à se tourner désormais vers elles-mêmes afin de subvenir à leurs besoins en termes de prestations de service.
Dans texte l’économie parctipative, ou sharing economy, s’est développée, ee therme désignant le partage de compétences, de biens et de services de particuliers à particuliers. D’un point de vue technologique, cette notion s’attache à l’émergence de sociétés chargées de mettre en contact, par le biais de plateformes électroniques, des particuliers demandeurs et des particuliers offreurs de biens, de compétences ou de services. Le développement de nouvelles sociétés basées sur ce business model a vu une diversification notable des services proposés, depuis les pionniers de l’économie participative Airbnb et Uber, mettant respectivement en relation des vacanciers et particuliers louant leur logement, et des passagers et chauffeurs particuliers. Le succès de ces deux sociétés a entraîné l’apparition de sociétés similaires et a conduit à étendre le réseau de biens, services et compétences sujets au partage de particulier à particulier. La conséquence économique ne s’est pas fait attendre : selon le magazine Forbes[1], le marché mondial de l’économie participative était estimé en 2013 à 26 milliards de dollars, les revenus des particuliers collaborateurs se montant quant à eux à 3,5 milliards de dollars. L’impact de ce business model a été tel qu’en 2011 le magazine Time a fait figurer l’économie participative parmi les dix idées qui changeront le monde[2].
L’explosion des sociétés participatives est également une conséquence naturelle de l’essor des nouvelles technologies et d’une société hyper-connectée[3]. L’interposition d’Internet entre demandeurs et offreurs a permis de réduire grandement le coût des transactions envisagées, et de gérer celles-ci de la prise de contact au règlement, par le biais de systèmes de paiement en ligne. En outre, ces transactions prennent désormais une dimension internationale importante. Cependant, l’explosion de ce nouveau business model soulève des interrogations quant aux règles à lui appliquer : faut-il appliquer les règles nationales existantes - notamment en matière de droit de la concurrence et de droit fiscal – ou élaborer des règles spécifiquement applicables aux sociétés d’économie participative? La question de la régulation de ces start-ups est l’un des principaux obstacles à leur développement économique. La problématique est particulièrement d’actualité : les Etats sont clairement incertains quant à l’attitude à adopter afin de réguler ces sociétés (I), ce qui conduit à se demander si les institutions internationales, notamment l’Union européenne, devraient se pencher sur la question de leur régulation afin d’harmoniser les législations nationales (II).
La principale difficulté rencontrée par les Etats est constituée par le paradoxe entre la nécessité de contribuer au développement économique et technologique, et celle de protéger les industries dites « traditionnelles » contre la concurrence des sociétés d’économie participative. En effet, les activités d’économie participative se voient décriées par les acteurs de l’économie traditionnelle comme des concurrents déloyaux proliférant au détriment de la protection des consommateurs, tandis qu’à l’inverse les plateformes peer-to-peer s’érigent en défenderesses de la libre concurrence en permettant l’accès de particuliers aux marchés pertinents. Il s’agit alors, pour les régulateurs, de mettre en balance les bénéfices de l’économie participative quant à l’emploi ou l’innovation technologique, et le risques de dérives causées par le contournement des règles juridiques applicables aux industries traditionnelles.
- L’incertitude quant à la régulation de l’économie participative
Lors de l’analyse du panorama général de l’économie participative, les principaux acteurs en jeu sont les Etats sur le territoire desquels s’implantent les entreprises issues de la consommation « collaborative ». Le premier constat qui doit être fait est que de grandes divergences sont observables quant au traitement réservé aux activités de ces sociétés à l’échelle nationale, et même à l’échelle des villes (A), rendant difficile une quelconque cohérence des législations nationales. En outre, il est à noter que les sociétés d’économie participatives ont pu conduire, dans le cadre de leurs activités, au contournement du droit en prenant avantage de leur statut flou et du caractère souvent inopportun des règles applicables aux secteurs commerciaux traditionnels (B).
- La difficile insertion de l’économie participative dans les droits nationaux
L’opinion publique semble considérer qu’il faudrait se contenter, pour les utilisateurs de prestations peer-to-peer (de particulier à particulier), de règles juridiques moins contraignantes que celles applicables aux sociétés commerciales traditionnelles. Dans le contexte d’une économie libérale, cet argument répondrait de ce fait aux impératifs (notamment européens) de libre prestation de service et d’ouverture à la concurrence.
Il s’avère toutefois que toutes les sociétés peer-to-peer ne bénéficient pas du même traitement de la part des Etats : un constat général est que les Etats cherchent à réguler en priorité l’activité des sociétés de locations de vacances et celle du transport de passagers, faisant d’Uber et Airbnb des cibles privilégiées. Parmi les Etats présentant une approche plus hostile envers les plateformes peer-to-peer se trouvent l’Espagne et l’Allemagne[4]. Il va de soi que l’approche étatique vis-à-vis de ces plateformes répond également à un but politique, lorsqu’on considère les statistiques selon lesquelles des sites de location, Airbnb en tête, pourraient s’emparer de 10% du marché de la location saisonnière. De ce fait l’hôtellerie, et le gouvernement se retrouveraient privés d’une part substantielle de la taxe hôtelière.
Par contraste, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, il semble que la piste privilégiée soit celle de la recherche d’une coexistence pacifique entre activités de particuliers à particuliers et protection des consommateurs, par l’élaboration de recommandations ciblées. Un rapport intitulé « Unlocking the Sharing Economy »[5] commissionné en septembre 2014 demande ainsi au gouvernement du Royaume-Uni d’appliquer des règles plus souples à l’activité des sociétés concernées. Cette souplesse répond au caractère non professionnel des prestations effectuées par des particuliers. Plus récemment, la ville de Londres a suivi l’exemple de Paris et d’Amsterdam (dotées de lois « Airbnb-friendly » depuis 2014), en autorisant la location de résidences primaires à des fins touristiques et pour une durée limitée[6].
Toutefois, même en suivant le raisonnement qu’il est nécessaire d’assouplir les règles juridiques pour les appliquer à l’économie participative car ce sont des particuliers qui en sont à l’origine, il n’empêche que cela permettrait de conférer aux plateformes matérialisées par les sites Internet un statut moins contraignant. Alléger les règles auxquelles sont contraintes les sociétés collaboratives peut s’avérer problématique, notamment lorsqu’on considère le poids financier de ces plateformes. Celles-ci se défendent de participer à une économie à deux vitesses, en avançant l’argument qu’elles ont uniquement pour but de faire le lien entre demandeurs et offreurs de biens et services : comment expliquer alors le pourcentage reversé par leurs utilisateurs au site hébergeur ? La confusion est possible sur sa qualification juridique, entre simple redevance d’utilisation de la plateforme, ou commission portant sur la prestation elle-même (court-circuitant alors l’argument de la simple mise en contact entre utilisateurs).
De par ces nombreuses incertitudes juridiques, un statu quo est difficilement envisageable. Les législateurs et régulateurs nationaux et internationaux ont pris conscience de l’inadéquation et du caractère lacunaire des législations existantes aux sociétés peer-to-peer, de par l’implication de particuliers exerçant a priori une activité non professionnelle – cette qualification étant également sujette à des divergences d’interprétation non tranchées jusqu’à présent. L’une des solutions préconisées par les partisans de l’économie participative serait d’assouplir certaines règles applicables aux secteurs réglementés (par exemple l’hôtellerie et la perception de la taxe touristique) afin de garder l’attractivité de ce business model fondé sur la simplicité d’utilisation, mais en établissant des standards minimaux tenant prioritairement à la sécurité et la santé[7] des consommateurs. Il existe en effet de nombreux risques associés à l’économie participative, dont l’utilisation abusive des lacunes des droits nationaux fait partie.
- Des risques croissants de dérives
Typiquement, la première opposition envers l’économie participative concerne le droit fiscal : les positions hostiles de l’Espagne envers un service tel qu’Airbnb reposent en majeure partie sur le fait que la location par l’intermédiaire de cette plateforme permet de contourner le prélèvement de la taxe touristique. De même, l’Avocat général de New York a attrait Airbnb devant les juridictions new-yorkaises pour non-respect de la loi sur le logement de 2010 interdisant la location à court-terme dans l’Etat de New York, afin d’éviter une éventuelle évasion fiscale causée par la non-perception de la taxe touristique s’élevant à 5% du prix de la location.
Alors que ces accusations ciblent finalement les particuliers utilisateurs de plateformes peer-to-peer, celles-ci semblent se dissimuler encore derrière ces utilisateurs en alléguant de leur statut d’interface permettant le contact entre particuliers. Toutefois, alors qu’Airbnb, à l’instar d’autres géants de la technologie tels que Google, a choisi d’installer son siège international à Dublin afin de profiter du dumping fiscal en vigueur en Irlande, il est possible de se poser la question de la fiscalité à laquelle sont assujetties les plateformes d’économie participative. Il est en effet important de souligner que celles-ci collectent une grande partie des revenus générés par les particuliers utilisateurs. Pour l’instant, il semble que les Etats préfèrent miser sur la possibilité d’une action à l’échelle européenne : le Conseil français du numérique (CFN) a ainsi remis le 10 septembre 2013 un rapport sur la fiscalité du numérique en rejetant l’idée d’une taxe sectorielle. Pourtant, en 2012 le CFN avait avancé l’idée de mettre en place un concept d’ « établissement stable virtuel»[8]. Cette définition permettrait que le seul « exercice d’une activité numérique dématérialisée significative dans un pays [9]», par une entité non présente physiquement sur le territoire national, suffise à l’assujettir à l’impôt national.
Les opérations mondiales d’Uber sont également un exemple frappant d’optimisation fiscale, par son utilisation de sociétés-écran aux Caraïbes. En examinant l’activité d’Uber exclusivement au Royaume-Uni, le premier constat est qu’Uber London Limited est détenue par une société privée néerlandaise, Uber International B.V., elle-même détenue par une forme sociale néerlandaise, une société Commanditaire Vennootschap (C.V.) incorporée aux Bermudes. De ce fait, Uber bénéficierait à la fois des avantages fiscaux mis en place aux Pays-Bas et des exonérations d’impôts sur les sociétés aux Bermudes[10].
Outre cette optimisation fiscale qui constitue l’essentiel des oppositions étatiques à l’économie participative, ces dernières soulèvent également certains problèmes à une échelle nationale tenant à la santé et la sécurité des utilisateurs : à titre d’exemple, des sites de partage de repas tels Shareyourmeal ou Feastly posent la question des contrôles sanitaires[11].
Ces controverses ont finalement poussé les autorités nationales à entamer des politiques de régulation de ces sites, avec pour résultat un certain alignement des positions. L’objectif à long terme serait alors d’imposer des conditions d’exercice aux plateformes concernées, afin de les autoriser en aval dès lors que ces conditions seraient respectées.
- Une nécessaire harmonisation des comportements étatiques envers l’économie participative
Au vu de la diversité d’approches nationales quant aux sociétés issues de l’économie participative, la difficulté réside en l’élaboration d’un consensus visant à harmoniser les règlementations étatiques. Cette nécessité de dialogue se fait surtout sentir au sein de l’Union européenne (A) autour du caractère opportun de règles juridiques applicables à l’économie participative. Toutefois, face aux entraves auxquelles elles se heurtent dans l’exercice de leurs activités, et dans un souci de prise de conscience des dérives qu’elles peuvent engendrer, les sociétés issues de l’économie participative tendent désormais à collaborer avec les autorités nationales et à s’autoréguler (B).
- L’appel à un consensus européen
Le problème de la gestion de l’économie participative se pose surtout au niveau de l’Union européenne, où des approches divergentes des Etats membres, notamment envers des sites pionniers tels qu’Uber et Airbnb, ont attiré l’attention des autorités européennes. En effet, il est apparu que l’ampleur prise par les sociétés peer-to-peer risquait de présenter une source de concurrence déloyale pour les entreprises régulées. Les autorités européennes semblent désormais se pencher au préalable sur l’établissement d’un dialogue avec les consommateurs, les Etats ainsi que les sociétés de la sharing economy. L’impact réel de l’économie participative sur le territoire de l’Union européenne, ainsi que les revenus générés, imposait la tenue d’un débat à concrétisé lors de la mise en place par le Conseil économique et social européen, le 25 septembre 2013, d’une coalition européenne sur l’économie participative, ou « European Sharing Economy Coalition » (Euro-SHE[12]).
Ce rapprochement de l’Union européenne et de l’économie participative a été possible en considérant leurs points communs. L’économie participative a pour but d’encourager la solidarité entre particuliers et semble rejoindre en ce sens les objectifs sociaux de l’Union européenne, soit contribuer à l’avancement de l’innovation, créer de l’emploi et arriver à une utilisation plus effective des ressources. L’initiative Euro-SHE peut alors être vue comme un facteur de continuité avec la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable. Euro-SHE étant relativement récente, il n’est possible que de s’en remettre à son programme, qui consiste en un renforcement de la coopération entre les trois acteurs visés par le projet : les régulateurs européens, les sociétés issues de l’économie participative et les associations européennes d’entreprises. Il apparaît également que l’objectif d’Euro-SHE à long terme soit de généraliser l’économie participative, tout en fournissant un encadrement juridique spécifique aux sociétés concernées. Cela permet ainsi, par le biais de l’uniformisation du modèle de société participative, d’opérer un certain niveau de contrôle, notamment en ce qui concerne le sujet épineux de la rémunération et du financement des sociétés concernées.
Par ailleurs, le Business Innovation Observatory de la Commission européenne a émis un rapport sur le business model des entreprises « peer-to-peer »[13], selon lequel il manquait un cadre juridique taillé pour l’économie participative. De fait, l’Union européenne et les autorités nationales se retrouvent confrontées à la problématique de délimiter la frontière entre les sociétés peer-to-peer et les sociétés commerciales ordinaires : « it will be a challenge for policy makers to draw the line between peer-to-peer sharing and conventional commercial activities »[14]. A partir du moment où un particulier propose des biens et services par l’intermédiaire d’une plateforme électronique, son statut de « peer » est incertain, puisqu’il serait possible de considérer qu’il constitue une entreprise individuelle.
Par ailleurs, de la qualification de l’activité du particulier sur des sites peer-to-peer découle des considérations d’ordre plus global : face aux professions régulées, à l’instar des hôteliers, des restaurateurs ou des taxis, l’économie participative est souvent accusée de causer des pratiques de concurrence déloyale. Il a déjà été remarqué que, d’une part à cause du manque de législations spéciales, et d’autre part de par les lacunes des législations existantes, l’économie participative se trouve dans une zone grise au regard du droit de la concurrence, qu’il soit national, européen ou international. Si l’on s’attache uniquement au droit de la concurrence européen, deux considérations s’opposent clairement. D’une part on retrouve la libre prestation de service consacrée par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[15] ainsi que la libre concurrence de l’article 101 du même traité[16], impliquant nécessairement un nombre suffisant d’intervenants sur un marché pertinent afin de laisser le plus grand choix aux consommateurs, et d’autre part la nécessaire règlementation de la concurrence par le droit européen afin d’éviter ou de réprimer les pratiques anticoncurrentielles.
Or il est difficile de trancher en ce qui concerne l’économie participative et de déterminer si l’implication de particuliers procède davantage de la libre concurrence ou de la concurrence déloyale aux professions réglementées. Cette dichotomie se retrouve à tous les niveaux du droit de la concurrence. Il s’agit évidemment d’une question de point de vue, mais en tout état de cause, les plateformes peer-to-peer les plus importantes tendent désormais à favoriser la coopération avec les entités régulatrices.
- La prise de conscience des entreprises face aux exigences juridiques
Conscientes de la nécessité d’être en conformité avec les législations des Etats où elles s’implantent, les sociétés issues de l’économie participative tendent à s’autoréguler et à entreprendre des politiques de collaboration avec les autorités nationales. Ce faisant, elles tendent à se doter d’un statut hybride puisqu’elles ne peuvent se voir appliquer l’intégralité des règles applicables aux activités réglementées. Ainsi, Airbnb a instauré une coopération avec les autorités d’Amsterdam aux fins de collecte de la taxe touristique due par les touristes résidant en hôtel. Jusqu’à présent il existait un flou quant à la nécessité pour les loueurs particuliers de collecter également cette taxe. Cependant, la controverse reste entière pour Uber, qui voit son activité peer-to-peer UberPop menacée en Europe, sans toutefois l’éliminer.
Comme l’a exprimé un article de la Harvard Business Review, les plateformes peer-to-peer et les autorités nationales et internationales sont conscientes des avantages de l’économie participative en termes d’emploi, de cohésion sociale et d’innovation technologique[17]. L’équilibre à établir consiste alors à conserver la particularité de l’économie participative tout en imposant des conditions à son exercice. Il reste toutefois aux instances régulatrices nationales, régionales et internationales à faire un choix pratique, entre amendement des législations et règlementations existantes ou élaboration d’un cadre juridique spécifique à l’économie participative.
Bibliographie
Ouvrages
J. ORSI, Practising Law in the Sharing Economy: Helping People Build Cooperatives, Social Enterprise and Local Sustainable Economies, American Bar Association, août 2013, 630 p.
N. PETIT, Droit européen de la concurrence, Domat droit privé, Montchrestien, 4 juin 2013, 688 p.
Articles
Article collectif, “Ten ideas that will change the world”, in Time magazine, 17 mars 2011
D. BAKER, “Don’t buy the “sharing economy” hype: Airbnb and Uber are facilitating rip-offs”, in The Guardian, 27 mai 2014
S. CANNON, L.H. SUMMERS, “How Uber and the Sharing Economy can win over Regulators”, in Harvard Business Review, 13 octobre 2014
P. FUMENIER, « BEPS Action 1: Faire face aux défis fiscaux de l’économie numérique », in Fiscalité et Stratégie (blog du Pôle Prospective Fiscale et Stratégie d’Entreprise du cabinet Taj), 7 avril 2014
T. GERON, “Airbnb and the unstoppable ruse of the share economy”, in Forbes, 23 janvier 2013
A.KAMENETZ, “Does the sharing economy have a shadow side?”, Fast company, 21 juin 2013
V. KOPYTOFF, “Airbnb’s woes show how far the sharing economy has come”, in Time, 7 octobre 2013
A. OZIMEK, “Is the Sharing Economy just a Scam to dodge good Regulations?”, in Forbes Modeled Behaviour, 23 juin 2014
T. REDMOND, “Uber’s tax-avoidance strategy costs government millions. How’s that for “sharing”? ”, 48hills.org, 10 juillet 2014
A. RINNE, “Sharing Economy Law: Outdated Rules create Opportunity”, Shareable, 22 octobre 2012
W.COLDWELL, “Airbnb’s legal troubles: what are the issues?” in The Guardian, 8 juillet 2014
W. COLDWELL, « Airbnb to be legalized in London”, in The Guardian, 10 février 2015
Rapports
Business Innovation Observatory, “The Sharing Economy: Accessibility-based Business models for Peer-to-Peer Markets”, Commission européenne, septembre 2013
OCDE, « Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique », 28 octobre 2014
UK Department of Business, Innovation and Skills, “Unlocking the sharing economy: independent review”, 26 novembre 2014
[1] T. GERON, « Airbnb and the unstoppable ruse of the share economy”, in Forbes, 23 janvier 2013
[2] « Ten ideas that will change the world”, in Time magazine, 17 mars 2011
[3] OECD, The Sharing Economy Forum, 5 mai 2014
[4] “Unlocking the sharing economy: independent review”, rapport pour le compte du UK Department of Business, Innovation & Skills, 26 novembre 2014. L’exemple-type de l’hostilité de Barcelone et Berlin sont respectivement l’amende de 30000 euros infligée à Airbnb pour violation des lois locales sur le tourisme, et la nouvelle loi berlinoise sur le logement, interdisant la location à court-terme sans l’approbation des autorités.
[5] W.COLDWELL, “Airbnb’s legal troubles: what are the issues?” in The Guardian, 8 juillet 2014
[6] Cette pratique, auparavant considérée illégale, était frappée d’une amende de 20000£. v. W. COLDWELL, “Airbnb to be legalized in London”, in The Guardian, 10 février 2015
[7] V. note 4
[8] Notion avancée par l’OCDE dans son projet de rapport sur les problèmes fiscaux relatifs à l’économie numérique, devenu plus tard le rapport « Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique », 28 octobre 2014
[9] V. P. FUMENIER, « BEPS Action 1: Faire face aux défis fiscaux de l’économie numérique », in Fiscalité et Stratégie (blog du Pôle Prospective Fiscale et Stratégie d’Entreprise du cabinet Taj), 7 avril 2014
[10] V. T. REDMOND, “Uber’s tax-avoidance strategy costs government millions. How’s that for “sharing”? ”, 48hills.org, disponible à: http://www.48hills.org/2014/07/10/ubers-tax-avoidance-strategy-costs-gov...
[11] V. KOPYTOFF, op.cit, v. note 7
[12] Présentation complète d’Euro-SHE sur le site d’Euro-Freelancers : http://www.euro-freelancers.eu/european-sharing-economy-coalition
[13] “The Sharing Economy: Accessibility-based Business models for Peer-to-Peer Markets”, Business Innovation Observatory, Commission européenne, septembre 2013
[14] Id.
[15] Aux termes duquel « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation (…) »
[16] Aux termes duquel « 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur (…)»
[17] S. CANNON, L.H. SUMMERS, “How Uber and the Sharing Economy can win over Regulators”, in Harvard Business Review, 13 octobre 2014