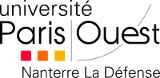La prise en compte mitigée de la protection de l’environnement dans le droit de la concurrence européen, par Margaux Koenig (avril 2014)
« Il ne sert à rien de dire « Nous avons fait de notre mieux ». Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire ». Cette citation de Winston Churchill représente l’idée même derrière la politique environnementale européenne. L’étendue des dégâts en matière d’écologie est considérable. Les États n’ont commencé à se pencher sur la question que depuis le début du siècle dernier et bien que les engagements se multiplient, les mesures concrètes se font rares.
Le sujet des aides d’État n’a jamais été autant d’actualité depuis la crise financière. Devant l’effondrement du système, les Etats n’ont eu d’autre choix que de venir à l’aide des banques pour tenter tant bien que mal de maintenir une économie viable au sein du pays. Ces aides d’État, par nature interdites par le traité,[1] ont été tolérées dans les domaines les plus touchés par la crise comme les secteurs bancaire, financier ou encore de l’énergie. Si l’environnement s’est vu donné de l’importance ces dernières années, les aides d’État dans ce domaine n’ont pas eu besoin de la crise pour être en pleine expansion.
Une aide d’État sera considérée comme telle et prohibée par le traité s’il s’agit d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, accordant un avantage à son bénéficiaire et faussant ou menaçant de fausser la concurrence au sein de l’Union.[2] Cette définition étant assez large, les subventions et autres avantages fiscaux pour favoriser la protection de l’environnement, le développement durable et les énergies renouvelables peuvent facilement tomber sous le coup de l’interdiction de l’article 107 TFUE.
Dans cette optique, une question légitime vient à l’esprit : dans quelle mesure la politique de concurrence de l’Union européenne (ci-après dénommée UE) pourra-t-elle impacter la volonté des États de favoriser les modes d’énergies renouvelables ?
Cette problématique sera développée en deux temps. Dans une première partie (I), les prémices d’une exception environnementale dans la politique de concurrence de l’UE seront examinées. Dans une seconde partie (II), un probable revirement sera étudié, par le biais d’un cas concret qu’est l’arrêt vent de colère.[3] récemment rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée CJUE).
I.Droit de la concurrence et protection de l’environnement : le développement novateur d’un régime d’exception
Il n’y a parfois qu’un pas entre la théorie et la pratique. À coté de l’interdiction des aides d’État au sein de l’Union, une théorie de justification des aides par la protection de l’environnement a été élaborée par la Cour (A). Cette théorie, découlant initialement du droit européen primaire, n’a pas tardé à être mise en œuvre à plus large échelle par la Commission à travers une série de normes (B).
A.Un régime d’exception à l’instigation de la CJUE
Malgré la prohibition expresse faite au premier paragraphe de l’article 107 TFUE, la suite du texte tend à restreindre la notion d’aide d’État, en indiquant que certaines aides ne tomberont pas sous le joug du premier paragraphe. Ainsi, les aides à caractère social ou remédiant aux dommages d’une catastrophe naturelle ne seront jamais constitutives d’aides d’État au sens de l’article 107(1).[4] D’autres auront la possibilité d’être déclarées compatibles avec le marché intérieur, telles que les aides remédiant à une perturbation grave dans l’économie d’un État membre ou les aides destinées à promouvoir la culture et le patrimoine d’un État de l’Union.[5] Cependant, ces exceptions n’ont jamais pu donner lieu à une justification quelconque d’une aide sur le fondement de la protection de l’environnement ou du recours aux énergies renouvelables.
Sur cette base, le critère des services d’intérêt économique général (ci-après dénommés SIEG) a en revanche déjà été retenu. Cette exception se trouve en dehors de la section sur les aides accordées par les États, et indique que :
« les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (…) sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».[6]
La Cour, en 2001, a tenu à préciser que les aides fournies aux entreprises chargées d’un SIEG s’analysaient comme une contrepartie des prestations effectuées et n’étaient donc pas à assimiler à des aides d’État au sens de l’article 107(1).[7] Dans un arrêt de principe Altmark, la Cour de Luxembourg est venue préciser la signification exacte de cet article, la notion de SIEG restant floue de part la seule lecture du traité.[8]
Un des apports de cet arrêt réside donc dans le fait que la Cour étende la notion de SIEG à celle de service public.[9] Avec une conception plus large et surtout plus commune au sein des législations nationales, le terme de SIEG devient plus facile à cerner par un juge national, familier avec la notion de service public. Les apports principaux de la décision restent cependant les quatre conditions pour qu’une subvention publique soit compatible avec le traité sur la base du financement d’une activité de service public. Premièrement, l'entreprise bénéficiant de l’aide doit avoir été clairement chargée d’exécuter une activité de service public ; deuxièmement, la compensation doit avec été établie de façon objective et transparente ; troisièmement, cette compensation ne doit couvrir que les coûts nécessaires à l’exécution de cette activité de service public ; enfin, la compensation doit être évaluée sur la base des coûts qu’une entreprise moyenne normalement gérée aurait supporté, si le choix de cette entreprise n’a pas été fait par le biais d’une procédure de marché public.[10]
Quant à l’application concrète de ce critère du SIEG en matière de protection de l’environnement pour éviter la dénomination prohibée d’aide d’État, on peut notamment la retrouver dans l’arrêt FFAD c/ Københavns Kommune. Ainsi, il a été reconnu que « la gestion de certains déchets peut faire l'objet d'un service d'intérêt économique général, en particulier lorsque ce service a pour but de faire face à un problème environnemental »[11].
À coté de ces développements jurisprudentiels, des développements ont surtout été initiés au niveau de la Commission et du Conseil, pour mettre en œuvre les idées discutées au sein des différentes réunions et consultations civiles.[12]
B.Une pratique suivie par le pouvoir exécutif
La Commission possède un rôle phare en matière d’aide d’État. Elle est l’organe de l’Union ayant le pouvoir et le devoir de vérifier que les aides fournies par les États membres aux entreprises sont compatibles avec les nécessités du marché commun. Ainsi, les États se doivent de notifier les aides qu’ils accordent auprès de Bruxelles, alors même qu’elles ne sont qu’au stade de projet.[13] Au fil des années, la Commission a développé un droit mou conséquent dans ce domaine, notamment par le biais de nombreuses communications. Les États membres au courant du cheminement de la Commission quant à l’évaluation d’une aide d’État, connaissent ainsi les erreurs à ne pas commettre. Ces documents n’ayant aucune force contraignante, seule la Commission elle-même se trouve juridiquement liée par ses communications.
Tout d’abord, elle définit la protection de l’environnement comme suit :
« [T]oute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables. »[14]
Partant de ce postulat, la Commission se lance depuis plusieurs décennies dans la rédaction d’objectifs qui se concrétisent par la suite en des paquets législatifs ou normes souhaitant uniformiser des règles au sein de plusieurs domaines simultanément.
Ainsi est né le paquet législatif énergie et changement climatique, de l’objectif européen 2020.[15] Les grandes idées de cet objectif se traduisent pas la cible 20-20-20, à savoir une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; une hausse de 20% dans la consommation d’énergies renouvelables au sein de l’Union ; et une amélioration de 20% de l’efficacité énergétique dans l’Union européenne. L’un des instruments phares lié à l’accomplissement de cet objectif est la directive de 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Dans cette directive se trouve notamment un régime d’aide spécifique destiné à favoriser l’utilisation de toute énergie produite à partir de sources renouvelables en réduisant le coût de cette énergie.[16] Cela peut se faire en augmentant le prix de vente ou le volume d’achat ou encore par l’obligation d’utilisation de cette énergie, à l’aide d’exonérations fiscales ou de fixations de tarifs de rachat notamment.
Deux autres directives finalisent ce paquet législatif, se focalisant plutôt sur le problème des gaz à effet de serre et leur nécessaire réduction,[17] mais leur pertinence quant au sujet de cet article reste moindre.
Même si l’UE se lance déjà dans une feuille de route pour un nouvel objectif 2050, la récente décision de la Cour de justice dans l’affaire vent de colère tend malheureusement vers un retour en arrière quant à la justification d’aides d’État pour la protection de l’environnement.
II.Droit de la concurrence et protection de l’environnement : un retour navrant au droit commun
L’arrêt vent de colère du 19 décembre 2013 a soufflé sur la jurisprudence, laissant s’effondrer les efforts entrepris pour faire de la protection de l’environnement une cause juste défendue au sein de l’Union européenne.[18] Si cette jurisprudence perdure, les conséquences en matière de soutien aux énergies renouvelables pourraient être importantes (A). Cependant, la situation au delà des frontières françaises ne semble pas être en déclin pour autant (B).
A.L’arrêt vent de colère, la fin du soutien à l’énergie éolienne
Avant même qu’une décision n’ait été prise par les juges de Luxembourg, cette affaire faisait déjà des émules au sein de la doctrine,[19] l’avocat général ayant rendu ses conclusions en faveur d’une qualification d’aide d’État pour la mesure en cause[20].
À l’origine du litige, l’association vent de colère avait saisi les juridictions administratives françaises, invoquant que le changement dans les conditions d’achat de l’énergie produite par les éoliennes constituait une aide d’État, non notifiée à la Commission européenne et donc illégale. En France, les producteurs d’énergie éolienne bénéficient d’un avantage notable. Les distributeurs d’électricité se doivent de racheter l’électricité ainsi produite à un prix supérieur à celui du marché. C’est un moyen aussi digne qu’un autre de favoriser les énergies renouvelables. Auparavant, ces surcoûts étaient compensés par un fond du service public de l’électricité, alimenté par les contributions des producteurs, fournisseurs et distributeurs d’électricité. Cependant, depuis une loi de 2003,[21] la compensation de ces surcoûts a été modifiée. Depuis cette loi, la compensation se fait directement par les consommateurs, le montant au prorata étant arrêté par le ministre chargé de l’énergie. Le Conseil d’État, qui reconnaissait la légalité du procédé avant cette loi, a donc du remettre son jugement en question.
Dans le cas de l’espèce, le juge suprême administratif ne doutait pas de la réunion de trois des quatre critères (affectation des échanges entre États membres, avantage à son bénéficiaire et menace pour la libre concurrence au sein de l’Union) de constitution d’une aide au sens de l’article 107(1) TFUE. Il a cependant tenu à poser une question préjudicielle à la CJUE quant au rôle de l’État dans l’attribution de cette aide. La Cour a répondu que cette mesure avait non seulement été accordée au moyen de ressources de l’État français mais lui était également directement imputable.[22] Son analyse s’est notamment fondée sur le fait que les contributions payées par les consommateurs transitaient par la Caisse des dépôts et des consignations, organe public, et étaient évaluées au niveau ministériel.
La Cour a donc choisi de s’écarter de sa jurisprudence Preussen Elektra,[23] dans laquelle elle avait décliné l’existence d’une aide. Dans cette affaire, aucun montant ne transitait directement des ressources de l’État vers celles des entreprises productrices d’énergies renouvelables et surtout aucune réglementation étatique ne fixait de mécanisme de remboursement précis des surcoûts engendrés.
L’évolution dans l’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables annoncée par la Commission dans ses lignes directrices ne trouve donc aucune application concrète.[24] Il y est effectivement indiqué que les infrastructures d’énergies renouvelables devenant moins couteuses de part leur mise en place depuis plusieurs années à présent, leur soutien par les États membres doit à présent se réduire, ou tout du moins changer de forme pour s’adapter à leur omniprésence. C’est ce qu’a choisi de faire la France, en faisant reposer directement sur le consommateur final les surcoûts d’une énergie et en déterminant son prix, pour éviter les éventuels abus des distributeurs et fournisseurs d’électricité. En prohibant ce genre de mesure, la Cour va directement à l’encontre de son raisonnement selon lequel la seule condition qu’une subvention soit octroyée par le biais de contributions imposées par l’Etat ne suffit pas à l’assimiler à l’emploi de ressources d’Etat.[25]
L’arrêt vent de colère est encore trop récent pour que sa portée puisse être appréciée avec exactitude. L’examen de éventuelles aides dans le domaine de la protection de l’environnement par la Commission sera donc décisif quant à la future position à tenir.
B.Une exception française ?
Le travail de la Commission dans le domaine des aides d’État est en constante augmentation, les aides devant être notifiées à Bruxelles alors même qu’elles sont encore au stade de projet[26] Toutes les aides ne font pas l’objet d’instructions et encore moins l’objet d’interdictions. Effectivement, la plupart des décisions octroyées rendues sont des décisions de ne pas soulever d’objections.
À titre d’exemple, dernièrement, le Danemark a été autorisé à subventionner l’utilisation de biogaz[27], les Pays-Bas ont été autorisés à subventionner une entreprise d’énergies renouvelables s’occupant de projets immobiliers « verts »[28], ou encore le Royaume-Uni a pu publiquement investir dans des projets d’énergie éolienne en conformité avec les dispositions du traité[29].
Cependant, ce qui ressort de ces différentes décisions est qu’elles sont toutes basées sur l’article 107(3)(c) TFUE indiquant que
« [L]es aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun »
sont susceptibles d’être compatibles avec le marché commun. Dans l’affaire vent de colère, l’aide n’ayant pas été notifiée, elle a toujours la possibilité d’être examinée par la Commission et d’être considérée comme compatible. Effectivement, la CJUE se bornant à interpréter le traité, elle n’a aucun pouvoir quant à la détermination de compatibilité d’une aide lorsqu’elle statue à titre préjudiciel, comme dans le cas de l’espèce.
Conclusion
Les politiques de l’UE en elles même sont contradictoires. D’un coté le paquet législatif de 2020 encourage les initiatives étatiques pour changer les façons de consommer et de produire l’énergie pour aller vers un monde plus propre et respectueux de l’environnement, mais de l’autre, la politique de concurrence ne peut pas laisser les États prendre une place trop importante dans les relations économiques entre entreprises. La politique de la concurrence comme celle de protection de l’environnement et la promotion du développement durable sont inscrits dans le traité, et ces dernières doivent être prises en compte dans la mise en œuvre des autres politiques.[30] Ainsi, on peut penser que des mesures plus contraignantes et visant au respect des provisions sur l’environnement, toujours perçu comme une politique « secondaire » à coté des grandes politiques telles que la coopération judiciaire, la politique de concurrence, la politiques monétaire ou autres, verront le jour à travers les futurs objectifs 2020, 2030 et 2050.
Bibliographie
Législation
Traité sur l’Union européenne.
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (CE) No 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, article 2.
Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion e l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement n1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Décisions de la Commission
Décision de la Commission, SA 35485, 14.11.2013.
Décision de la Commission, SA 34453, 06.11.2013.
Décision de la Commission, SA 24895, 31.07.2013, JOCE C/279/2013, 27.09.2013.
Rapports et Communications
COM(2010) 2020, Communication de la Commission, Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente durable et inclusive, 03.03.2010.
COM(2009)647 final, Document de travail de la Commission, Consultation sur la future stratégie «UE 2020», 24.11.2009.
Commission, lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, 2008/C 82/01.
Paper of the Services of DG Competition containing draft Guidelines on environmental and energy aid for 2014-2020.
Communiqué de presse de la Commission Européenne, IP/13/1021, 05/11/2013, Commission européenne: des orientations pour l'intervention publique dans le secteur de l’électricité.
Arrêts
CJUE, C-262/12, 19 décembre 2013, Association vent de colère e.a.
CJUE, C-169/08, 17 novembre 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri, Rec. p. I-10821.
CJCE, C-345/02, 15 juillet 2004, Pearle e.a., Rec. p. I-7139.
CJCE, C-280/00, 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. p. I-7747.
CJCE, aff. C-53/00, 22 nov. 2001, Ferring c/ ACOSS, Rec. p. I- 9067.
CJCE, C-379/98, 13 mars 2001, PreussenElektra, Rec. p. I-2099.
CJCE, C-209/98, 23 mai 2000, FFAD agissant pour Sydhavnens Sten & Grus ApS, c/ Københavns Kommune, Rec. p. I-3743.
Doctrine
E. Durand, L’affaire « Vent de colère », une légère brise avant la tempête ? Commentaire des conclusions de l’avocat général Jääskinen, JCP éd. Administrations et collectivités territoriales, n° 48, 25 nov. 2013, p. 234.
Divers
Conclusions de l’Avocat général Jääskinen, C-262/12, 19 décembre 2013, Association vent de colère e.a.
Conclusions de l’Avocat général Léger (présentées en 2003), C-280/00, 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg.
[1] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé TFUE), article 107(1).
[2] CJUE, C-169/08, 17 novembre 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri, Rec. p. I-10821, pt 52 et jurisprudence cite.
[3] CJUE, C-262/12, 19 décembre 2013, Association vent de colère e.a.
[4] TFUE, article 107(2)(a) et (b).
[5] Ibid, article 107(3)(b) et (d).
[6] Ibid, article 106(2).
[7] CJCE, 22 nov. 2001, aff. C-53/00, Ferring c/ ACOSS, pt 27
[8] CJCE, C-280/00, 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg.
[9] Conclusions de l’Avocat général Léger (présentées en 2003), C-280/00, 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, pt. 11.
[10] CJCE, C-280/00, 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, pt 95.
[11] CJCE, C-209/98, 23 mai 2000, FFAD, agissant pour Sydhavnens Sten & Grus ApS, c/ Københavns Kommune, Rec. I-3743, pt. 75
[12] COM(2009)647 final, Document de travail de la Commission, Consultation sur la future stratégie «UE 2020», 24.11.2009; Paper of the Services of DG Competition containing draft Guidelines on environmental and energy aid for 2014-2020; Communiqué de presse de la Commission Européenne, IP/13/1021, 05/11/2013, Commission européenne: des orientations pour l'intervention publique dans le secteur de l’électricité.
[13] Règlement (CE) No 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, article 2.
[14] Commission, lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, 2008/C 82/01, pt. 70.1.
[15] COM(2010) 2020, Communication de la Commission, Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente durable et inclusive, 03.03.2010.
[16] Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion e l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, article 2.
[17] Directives 2009/31/CE et 2009/29/CE.
[18] CJUE, C-262/12, 19 décembre 2013, Association vent de colère e.a.
[19] E. Durand, L’affaire « Vent de colère », une légère brise avant la tempête ? Commentaire des conclusions de l’avocat général Jääskinen, JCP éd. Administrations et collectivités territoriales, n° 48, 25 nov. 2013, p. 234.
[20] Conclusions de l’Avocat général Jääskinen, C-262/12, 19 décembre 2013, Association vent de colère e.a.
[21] Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
[22] CJUE, C-262/12, 19 décembre 2013, Association vent de colère e.a, pts. 18 et 33.
[23] CJCE, C-379/98, 13 mars 2001, PreussenElektra, Rec. p. I-2099.
[24] Cf supra, Commission, lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, 2008/C 82/01.
[25] CJCE, 15 juillet 2004, Pearle e.a., Aff. C-345/02, Rec. p. I 7139, pt 41.
[26] Article 108(3) TFUE.
[27] Décision de la Commission, SA 35485, 14.11.2013.
[28] Décision de la Commission, SA 34453, 06.11.2013.
[29] Décision de la Commission, SA 24895, 31.07.2013, JOCE C/279/2013, 27.09.2013.
[30] TFUE, article 11.