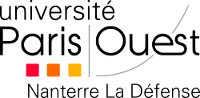Répondre au commentaire
Une tache d'encre pour un tableau de maitre
Philip Carver nous livre son dernier roman. Après une vie guidée par l’excès, il semble qu’en dépit des apparences, l’auteur iconoclaste ait (enfin) trouvé une autre voie que celle de la débauche gratuite. Comme souvent, à l’heure du bilan, l’homme se repend. À demi-mots.

Il n’est jamais facile de parler d’un livre qui nous touche au point de nous blesser. Le dernier livre de Philip Carver, Aller simple vers l’oubli, paru au Editions Gallmeister (21 euros, 337 p.) est de ceux-là. Pourtant, à la lecture de la quatrième de couverture, rien ne laisse supposer que l’on va être « touché ». Loin de là. À la fois arrogant et méprisant, l’auteur franco-américain offre un condensé de suffisance en même temps que de vulgarité. Il serait vain d’essayer de vous l’expliquer, le plus simple est de vous en livrer un extrait:
« Vous me connaissez, ma réputation me précède, je ne fais pas dans la dentelle. Dans la vie comme dans mes écrits. Jamais je ne me suis travesti en écrivant pour gagner des « prix » comme tous ces traîne-savates de bas étage en manque de reconnaissance. Le seul exploit dont je me vante c’est d’avoir mis une fessée un soir de cuite à Elizabeth Loftus*. Ce n’est peut-être pas très littéraire, mais ça se vendrait toujours mieux que les derniers bobards de Giscard. [...] Je m’emporte mais c’est pour ne pas faillir à ma réputation. Il ne faudrait pas qu’ils viennent à m’prendre pour un vieillard sénile, tous ces journaleux qui se prétendent critiques littéraires. Je n’ai rien perdu de ma verve. Ce dernier roman en est la preuve : c’est mon chef-d’œuvre.[...] »
Ne serait-ce que pour l’adresse aux « journaleux qui se prétendent critiques littéraires », inutile de vous dire à quel point j’ai eu envie de lire cet Aller simple vers l’oubli. Quand on tend un bâton pour se faire battre, il faut être prêt à recevoir des coups. J’avais donc dans l’idée de ne rien laisser passer. Mais à la fin de ma lecture, force est de constater qu’à l’instar de son titre, c’est un livre que l’on ne peut assurément pas oublier. Et pour cause, Philip Carver, aujourd’hui âgé de soixante-seize ans, signe effectivement son chef-d’œuvre.
L’histoire est celle d’un vieillard dont on ne connaît pas l’âge, Jimi Autumn, qui, sur le bord d’une station-service de l’Ohio, raconte sa vie à un jeune garçon. En s’inspirant des voitures qui passent, il compose un tableau autobiographique où chaque type de voiture lui rappelle un événement particulier de sa propre vie. D’abord sombre quand il évoque son enfance difficile dans un quartier pauvre à Trenton (capitale du New-Jersey, nldr), la toile se colore ensuite d’éclats lumineux (la rencontre de la richesse et des femmes), avant d’être irrémédiablement déchirée. Dans cette partie, ce sont tous les mythes de l’Amérique celui du self made man, celui de la liberté comme valeur première, ou « unique » comme le dit le narrateur qui sont démolis à grand coup de déboires et de désillusions. Égoïsme, désirs, argent roi, l’homme chute jour après jour dans l’ignorance et la facilité. Jusqu’à ce qu’il touche le fond, un soir d’été, au volant d’une Cadillac rouge sang. Débute alors le récit de la reconstruction qui s’apparente à la recherche du sens, quête inachevée et inachevable selon le vieil homme.
Au court du récit, l’enfant pose de nombreuses questions au narrateur afin d’essayer de comprendre certaines situations qui lui échappent totalement. Souvent, l’enfant conclut par une phrase qui finit par devenir une sorte de ritournelle : « Si tu avais eu Internet, les choses se seraient passées autrement. » ou « Avec un téléphone portable, tu aurais pu l’appeler ». De fait, les aventures du vieil homme se transforment en une succession de contes modernes et cyniques où la morale, donnée par l’enfant, s’incarne dans le matérialisme des nouvelles technologies. Carver pointe ici du doigt l’écart qui s’est brutalement creusé entre deux générations: la nouvelle, qui « naît avec un téléphone portable dans la main », et l’ancienne qui a connu les balbutiements des « nouvelles technologies ». Un écart que le vieil homme n’essaye pas de combler.
Tout au long de cette histoire, la force de Carver est de nous faire croire à la possibilité d’une telle existence sans jamais s’empêtrer dans des justifications. Les anecdotes évoquées, toujours accompagnées de détails insignifiants, servent de faire-valoir à ces tranches de vie très différentes. Mais plus que leur diversité, c’est la frénésie avec laquelle ces expériences s’enchaînent qui frappe dans cette histoire, l’accélération du rythme des voitures au fil de la journée créant une sorte de mise en abime du récit. De fait, Aller simple vers l’oubli est véritablement un roman de l’accélération, un roman de la brutalité. La nouvelle modernité, de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, prend ici l’apparence d’un « instrument de torture qui ferait subir à l’homme en une minute seulement tous les états possibles et inimaginables de joie, de tristesse, de nostalgie, de déprim’, d’angoisse, d’espoirs et de peur. » En ce sens, on peut se demander si Carver ne s’est pas inspiré des travaux du sociologue français P. Virilio et de l’Allemand H. Rosa, auteur notamment d’Accélération, une critique sociale du temps aux éditions La Découverte (2010).
Le style quant à lui, sec et sans complaisance, reste celui de Boire et déboires et Conjuration des bien-pensants, ses deux plus grand succès. Le narrateur, qui se laisse facilement emporter par son récit, donne au Franco-américain l’occasion de nous montrer que sa plume est encore aiguisée et vive. Seulement, dans Aller simple..., elle est maîtrisée et ne sert pas uniquement de défouloir, de crachoir à encre.
Au final, il semble que la quatrième de couverture ne serve pas ce roman sucré-salé, comme l’exige la nouvelle cuisine française. Mais, connaissant le parcours de Carver, on peut se demander si comme son héros, ce n’est pas au bout du compte ce qu’il souhaite : disparaître dans un nuage de fumée, trace éphémère d’un dernier tour de passe-passe. « Heureusement, on ne vit qu’une fois. [...] Je mourrai seul et l’on m’oubliera vite. Comme un livre que l’on referme à tout jamais après l’avoir lu. »
Ludovic PIN.
* Elizabeth Loftus est une psychologue américaine de renom.