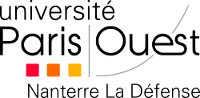Répondre au commentaire
L'histoire d'un refus de maternité
Charles Smith revient enfin après cinq années d’absence et nous offre un deuxième roman étonnant
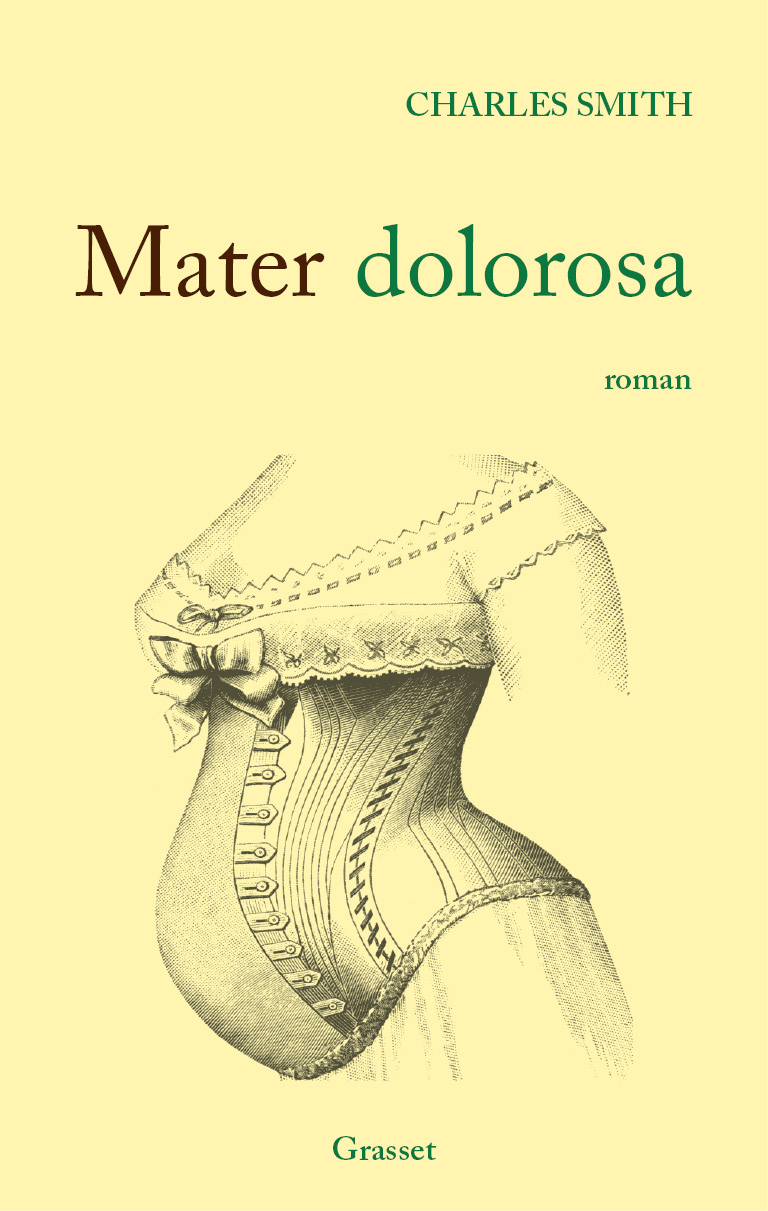
Vivre sa grossesse comme on subirait une maladie. Telle est la conception d’Alice, l’héroïne du nouveau roman de Charles Smith, intitulé Mater dolorosa.
Alors qu’il avait décrit les déboires d’un couple d’adolescents « paumés et amoureux » dans son premier roman, Jeunesse (paru en 2005 aux éditions Grasset), salué unanimement par la critique, cet Irlandais quinquagénaire a choisi cette fois de nous livrer les états d’âme d’une trentenaire encore célibataire qui tombe enceinte un peu par hasard. Un peu par hasard car « elle enchaîne les conquêtes d’un jour ou d’un soir », ne sait plus si elle veut s’engager, s’estime trop indépendante pour avoir des enfants. La scène qui ouvre le roman est exposée de telle manière qu’il est difficile de savoir si la suite de l’histoire relève de la comédie ou du drame. On assiste avec Alice, en direct de ses toilettes, au verdict du test de grossesse : le résultat est « effroyablement positif ». Première question que se pose la jeune femme : qui est le père ? Mais cette interrogation légitime et somme toute, rationnelle, est rapidement balayée par un constat, effroyable lui aussi : elle ne veut pas de « cette chose en elle » qu’elle ne connaît pas et ne veut de toute façon pas connaître. Elle pense bien sûr à l’avortement, mais, même si elle ne fréquente plus les églises, ne peut s’empêcher de culpabiliser quand elle se remémore les cours de catéchisme de son enfance. En outre, sa culpabilité est accrue par la pression sociale : absolument tout le monde veut des enfants, ceux qui peuvent en avoir en font, ceux qui ne peuvent pas en adoptent, alors pourquoi, elle, n’en veut-elle pas ? C’est cette question centrale que l’auteur se propose d’étudier et d’analyser à travers son personnage. Poussant toujours son héroïne dans ses derniers retranchements, il se plaît à tantôt la malmener, tantôt la prendre en pitié, en mettant davantage en lumière son côté fragile et pathétique. Tout est beaucoup trop lourd pour elle. Trouver une solution est-il seulement possible ?
On retrouve le style cher à Smith, qu’il avait déjà exploité dans Jeunesse, caractérisé par sa simplicité, sa sobriété, la langue étant volontairement dépouillée de tout ornement littéraire. Le vocabulaire est simple, comme la syntaxe dans laquelle apparaît nettement le refus de l’auteur de formulations alambiquées. Toute proportion gardée, son écriture rappelle quelque peu celle de Annie Ernaux. Quand on sait que Smith fait partie du lectorat de l’écrivain française, on est en droit de se demander s’il ne s’en inspire pas dans la concision, l’utilisation d’une plume minimaliste et la pratique, comme elle, de l’écriture dite « plate ». Smith ne veut pas faire du beau, il veut « faire du vrai », comme on peut le lire dans la préface, et il réussit très bien ce tour de force de travailler les phrases sans en avoir l’air, en s’attachant à traiter simplement un sujet aussi complexe.
De plus, Smith nous étonne par sa facilité déconcertante à écrire avec justesse sur un état que, a priori, seule une femme aurait pu décrire. En effet, l’auteur détaille avec une rare empathie les doutes, les émotions, les douleurs qui touchent au plus profond de l’intimité féminine. Sans avoir la prétention de livrer une étude sociologique, Smith fait apparaître le constat lucide que les années n’ont guère modifié la perception de l’avortement ; même s’il est devenu légal, il n’en demeure pas moins « intolérable » pour la société dans laquelle évolue Alice, que certains analyseront comme une caricature de notre société contemporaine, mais dans laquelle nous voyons davantage un simple prolongement de celle-ci.
Mater dolorosa, Charles Smith, traduit de l’anglais par Richard Alay, éd. Grasset, 200 pages, 20 EUR.
Morgane Sirot