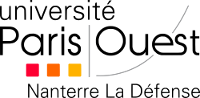déc.
27
Réécriture d'un mythe
Soumis par Anonyme le mar, 12/27/2011 - 12:50
Le rêve d’Antigone
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours vécu avec une femme distante et silencieuse, dans un intérieur tout aussi froid que les relations que nous entretenions. Elle était plutôt jolie, c’est ce que m’apprennent certaines photographies prises au même endroit, celui qui l’avait vue grandir, le garage familial, avec les mêmes personnes, sa sœur et ceux qu’on m’a dit être ses deux frères. Au second plan, je distingue des pièces détachées de voiture, un bidon d’essence, un chiffon sale, une vieille table basse, les restes d’un repas, sans doute une soupe de pois chiches, une théière. C’était un lieu de vie, un peu meurtri, un peu blessé, mais on semblait s’y aimer.
La jeune femme aux côtés de celle qui sera ma mère est plus belle. Grande, pulpeuse, elle arbore sur toutes les photographies un sourire tranquille, serein, elle est sûre d’elle et de sa beauté. Elle est élégante et noue joliment ses cheveux. Elle est tout ce que la jeune femme un peu pâle à ses côtés n’est pas, elle pétille, elle apaise. Les deux jeunes hommes sont les aînés de la famille. Le premier d’entre eux, sur les dernières photos, est habillé en soldat. On m’a souvent parlé de lui, cet homme courageux qui ne déçut personne et ne vieillit jamais. Il ne ressemble pas au cadet dont l’air désinvolte, ricaneur, malicieux, ne me rappelle rien. J’ai vécu avec des gens qui ne riaient plus. Sur toutes les images, ma mère est ce regard insondable qui fixe sans se dévoiler ; il est fier et déstabilisant. Celui qui prend la photographie doit être leur oncle. Il vécut avec eux longtemps avant que son fils épouse ma mère. C’est aujourd’hui un vieillard que je ne vois qu’aux grandes occasions et qui revient seulement parce que c’est le père du mien. Cet homme croit que sans lui la famille s’écroulerait et personne n’ose encore le contredire. Il était, aux dires de son fils, un gérant rigoureux et légaliste. Ces jeunes personnes sont des orphelins, les victimes indirectes d’un conflit éternel qui divise encore aujourd’hui le pays où je vis, qui sépara les familles, la mienne, et ce garage.
Je suis le fils d’une femme qui n’aurait pas dû m’avoir, je suis celui qui n’aurait pas dû naître. Je suis son erreur, et d’elle, je ne sais que ce que mon père m’a raconté.
******
C’était au temps où il ne faisait pas bon côtoyer l’ennemi, être son allié était donc un crime. L’aîné des deux frères le combattait. Depuis qu’il était enfant, il avait écouté ce que les plus grands disaient, en avait tiré une haine inaliénable, et dès qu’il l’avait pu, était entré dans l’armée, du côté de ceux qui ne transigent pas. Envers l’autre, il nourrissait une rancune plus nationale que personnelle, mais aussi tenace et aveugle que l’indifférence du cadet qui, soucieux de son bien-être, ne voyait l’autre que comme une possibilité de vivre différemment, de goûter à l’interdit, de ne pas ressembler à son frère. Aucune raison louable ne justifiait sa tolérance à l’égard de l’autre, avec lequel les relations clandestines et les échanges interlopes n’avaient pour cause qu’une ignorance qui aurait pu être salvatrice si elle n’avait pas été mue par le désir individualiste d’un divertissement inconscient.
Le garage était le reflet de ce conflit, il en prenait la forme. Ce n’était ni vraiment la guerre, ni vraiment la paix, mais de chaque côté les enfants mouraient. Les différences entre mes deux oncles étaient trop fortes pour protéger le garage, et parce que l’aîné était intransigeant, parce que le cadet avait fait du garage la cible idéale des autres, bien plus intéressés et bien moins indifférents qu’il ne le pensait, les deux frères se battirent. Je me suis souvent demandé ce qui serait arrivé si l’un des deux avait eu l’intelligence, et le courage, d’épargner l’autre, de se rendre compte que c’était son frère qu’il achevait et que ce lien était important. Rien ne fut à ce moment-là plus fort que la colère de l’un et le sentiment de trahison de l’autre. Aucun des deux ne fit grâce à son adversaire. Ce fut leur oncle, à l’ouverture du garage, qui découvrit les corps, ce fut lui qui appela les secours et attendit fébrilement qu’ils lui confirment ce qu’il savait sans doute déjà. Mon père me confia un jour que le sentiment d’échec que le sien éprouva ne dura pas. Ces garçons, on les lui avait confiés, avec le garage. Il leur avait imposé des lois précises, on ne rentrait pas après dix heures, on ne fumait pas, on n’avait que de bonnes fréquentations. La famille fonctionnait comme on tient un registre de comptes, aucune rature n’était tolérée, aucun débordement n’était accepté, une précision sans égale devait régner. Cela ne fonctionnait pas aussi bien qu’il le pensait, et d’ailleurs, le pensait-il vraiment ? Mais un ordre semblait s’être installé qui recouvrait, telle une patine, les violences souterraines et les rancœurs enfouies. Aujourd’hui pourtant, la mort frappait et cet ordre qu’il croyait avoir si minutieusement instauré montrait le ver qui le rongeait depuis si longtemps et qui n’avait peut-être rien à voir avec des relations familiales conflictuelles. Pour une raison que j’ignore encore, il n’acceptait pas de reconnaître qu’il avait été aveugle à ce point. Mon père ne le vit jamais pleurer, ni lorsque les médecins confirmèrent la mort des deux hommes, ni aux funérailles de l’aîné, ni bien après, quand toutes les voix se turent et que le vacarme cessa. C’est parce que, implacable, il refusait d’avoir échoué, qu’il accepta les conseils de l’armée : il ferait mieux d’enterrer l’aîné en respectant l’ensemble des rites funéraires et de ne jamais rendre les hommages au cadet. Il montrerait ainsi que celui-ci était un traître, qu’il ne respectait pas les règles de la communauté et que le système d’ordre et d’obéissance que lui-même avait instauré ne devait pas être remis en cause. C’était très bien, peut-être injuste, il n’en était pas sûr, mais tellement plus confortable.
******
Ce fut mon père qui raconta, le premier, à ma mère ce qui s’était passé. Il dit qu’à cette époque, l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre était encore le même. Elle était discrète, secrète, parlait peu et encore moins d’elle, lisait beaucoup, connaissait cinq langues, voyageait sans cesse à l’intérieur de sa petite chambre sans couleur où elle restait enfermée pendant des heures. Les vrais voyages, lui répétait-elle, sont immobiles. Immobiles et infinis. Solitaires. Silencieux. Elle aimait l’homme qui deviendra mon père parce qu’il disait aimer ces départs imaginaires autant qu’elle. Les perpétuelles guerres intestines n’occupaient pas ses pensées, à moins que ces fréquentes évasions n’aient été, pour elle, que le moyen d’y échapper.
Après la tristesse, ou étroitement mêlée à elle, ce fut de la colère. Mon père se souvint que, pour elle, la mort ne pouvait avoir de fins politiques, qu’elle en était peut-être l’affreuse conséquence, mais jamais l’instrument. Elle n’avait ni raison, ni but, ni justification. On ne l’excusait pas, on ne lui donnait pas de sens. La seule façon de la rendre supportable était de s’assurer, par l’unique moyen qu’on avait trouvé, qu’elle soit digne, au moins après coup. On s’assurait d’un beau rituel, on faisait quelque chose de soigné, de solennel, dont tout le monde se souviendrait, pour se donner l’illusion d’ôter un peu d’absurdité à ce qui demeurait inévitablement insensé. Cet homme, avait-elle ajouté, qu’on avait décidé de punir, était son frère, qu’importaient toutes les bonnes raisons du monde, elles ne le seraient jamais assez, il méritait, par ce seul lien, qu’on prenne soin de lui, qu’on l’accompagne, qu’on lui dise au revoir, même si, au fond, avec ces rites et ces cérémonies, on ne soigne que ceux qui restent. Et puis, les prières ne distinguaient personne.
« Tu n’y crois pas, aurait rétorqué mon père.
— Qu’importe, c’est pour les autres, parce que ça compte. »
Mon père n’essaya pas de la convaincre. Il se persuadait qu’elle ne ferait rien. Il la laissa se reposer, lui proposa un cachet, elle refusa, il partit.
*******
À l’aube du troisième jour après la mort de ses deux frères, et du deuxième après les funérailles de l’aîné, ma mère, comme elle avait l’habitude de le faire depuis qu’elle était enfant, sortit de la maison très tôt, ce que, depuis ma naissance, elle ne fait plus. Un des gardiens du cimetière, celui qui ouvre les grilles aux premiers rayons du soleil, lorsque la chaleur accablante de la journée est encore supportable, le raconta à son oncle. Ce matin-là, on sentait encore venir de la mer la fraîcheur parfumée d’un vent à peine tiède. C’est le moment de la journée que je préfère, c’était aussi le sien. Elle marchait dans les rues encore vides et silencieuses, en attente du vacarme qui allait les envahir quelques heures plus tard. Elles deviendraient vite poussiéreuses et bruyantes, mais en ce début de journée, un calme suspendu et une sérénité fragile pénétraient les ruelles désertes, telle la goutte d’eau qui s’accroche, hésite, tremble avant de se laisser brutalement tomber et de s’éparpiller en une myriade de petites gouttelettes. Ce matin-là, alors qu’il arpentait les allées pierreuses du cimetière, le gardien aperçut une jeune femme qu’il n’avait encore jamais vue dans cet endroit fréquenté d’ordinaire par de vieilles femmes pour lesquelles la visite quotidienne à un mari, à un fils, à un ami, est un rituel nécessaire. Il les reconnaît à leur démarche lourde, ralentie par les années et le deuil, aux chants ancestraux qu’elles sont les seules à encore murmurer, aux mêmes blouses colorées qui recouvrent leur corps meurtris, aux sourires qu’elles lui adressent, pleins d’une reconnaissance chaque matin renouvelée, comme si c’était lui qui veillait à présent sur ces âmes tant aimées. Ce matin-là, la jeune femme qu’il croise porte une légère robe noire à bretelles, tient dans son poing serré quelques cailloux blancs ramassés à l’entrée, et, avec le pas vif de quelqu’un qui sait parfaitement ce qu’il veut, passe devant lui sans le voir. Sa jeunesse et sa détermination le surprennent. Elle se dirige vers l’angle du cimetière, celui où il ne va jamais, où personne ne va jamais car n’y reposent que les anonymes, ceux que la mort a trop abîmés ou que personne n’a réclamés. Elle s’arrête devant un carré de terre encore fraîche et à peine bombée, puis dépose sans précipitation les cailloux qu’elle serrait dans sa paume griffée et émaillée de quelques points rouges. Elle sort de sa poche un petit livret qu’elle feuillette avec hâte. Elle semble de plus en plus inquiète. C’est à ce moment-là qu’il comprend, s’avance vers elle, trébuche. Elle sursaute, le regarde fixement, soudainement apeurée, s’enfuit. Il ramasse le petit livre qu’elle a laissé tomber.
Plus tard, lorsqu’il racontera à mon grand-oncle ce qu’il a vu, il dira qu’elle ressemblait à ces chats solitaires que l’on surprend en train de voler une victuaille sur un étal et qui s’enfuient avant d’avoir eu le temps de prendre quoi que ce soit. Il a pensé à cette frêle jeune femme trop courageuse ou trop inconsciente toute la journée, mais n’en a rien dit à personne.
Lorsque ma mère, ce matin-là, franchit les grilles, traversa la ville encore silencieuse et rentra à la maison, son oncle faisait les comptes dans la petite pièce grise, à l’entrée du garage, qui lui servait de bureau. Depuis trois jours, il dormait peu, se réveillait tôt, passait des coups de fil, mais ne changeait rien, le garage restait ouvert, les registres tenus. Mon père dormait encore et, comme elle le faisait chaque matin, ma tante attendait sa sœur. Elle veillait à ce qu’elle rentre bien, qu’elles déjeunent ensemble, qu’aucune d’elles n’oublient ces petits rites nécessaires mis en place depuis des années. Elles s’embrassaient, se brossaient mutuellement les cheveux, se complimentaient, ma mère lui parlait du dernier livre qu’elle avait lu, d’une phrase qu’elle avait retenue et aimée, ma tante évoquait le film qu’elle avait vu la veille, le lui conseillait, elle y retournerait avec elle, si elle voulait, pourvu qu’elles soient ensemble. C’était leur façon de veiller l’une sur l’autre. Ma tante faisait attention à ce que rien de trop violent ne vienne troubler cette façon d’être ensemble, elle éloignait tous les conflits, trouvait toutes sortes de compromis, vivait en croyant que les guerres ne concernaient que la partie de la population la plus idiote, ou la plus infantile, ceux qui ne comprenaient pas que la vie comptait plus que tout. La mort de ses deux frères était un accident, le prolongement de leurs jeux d’enfants, la dernière bêtise de deux jeunes hommes qui n’avaient pas grandi. Elle était triste, mais ils étaient morts par erreur. Elle porterait le deuil, mais pas trop longtemps. Au fond, je crois qu’elle était en colère. Ils avaient tout gâché, le soleil, les cafés où l’on reste à discuter pendant des heures jusqu’à ce qu’un vent frais nous attire vers la mer, les courses-poursuites avant d’aller dormir, les rires, les baisers, les années d’enfance. Ce matin-là, elle attendait sa sœur. Rien ne devait avoir changé. Ce matin-là pourtant, ma mère ne fit rien comme à l’ordinaire, elle se lava les mains frénétiquement, comme si elle voulait faire disparaître des traces ou des empreintes, elle se noua les cheveux, elle ne la regarda pas, ne lui sourit pas. Elle retrouva pourtant son calme, et sa sœur oublia que ma mère, cette fois, avait un peu dérogé aux règles. Elle s’approcha d’elle, et c’est à ce moment-là que ma mère lui confia être allée au cimetière rendre les derniers hommages à leur frère. On l’avait surprise, elle avait eu peur, c’était bête, elle recommencerait car elle n’avait pas fini et qu’elle le devait. Ce serait peut-être mieux tout de même si elles étaient deux. Ma tante fut la première à savoir ce que sa sœur avait fait. Elle fut interloquée, elle qui ne s’était jamais posé la question du bien-fondé de cette décision. Elle pensa, au début, qu’un tel acte était insensé, elle refusa de l’aider et d’ailleurs sa sœur ne devait pas y retourner. C’était dangereux, on allait le savoir, elle avait désobéi à leur oncle et à l’armée. C’était une trahison, un crime, et elle le savait bien. Ma tante ne se préoccupait que des vivants. Eux seuls méritaient son attention et sa patience. Elle prenait soin d’eux, pas des morts, pas de ceux qui l’avaient laissés en plan. Si sa sœur était accusée, jugée, emprisonnée, de qui allait-elle s’occuper ? Ma mère n’oserait pas l’abandonner comme leurs parents l’avaient fait, comme leurs frères, parce qu’abandonner, c’est trahir. Nous vivons les uns pour les autres, c’est comme ça, c’est une loi de la nature, nous prenons soin d’eux parce que nous les aimons. Elle, elle n’aurait jamais laissé ses parents ou ses deux frères, et encore moins sa sœur, pour n’importe quoi d’autre, une croyance, une religion, un bout de terre ou une tout autre cause obscure, jamais. Elle, elle ne prendrait pas le risque de quitter sa sœur, malgré, parfois, ses longs silences, ses migraines et ses sautes d’humeur, même si elle s’enfermait dans sa chambre, dans le noir. Elle se fâcherait quelquefois, elle ne lui parlerait peut-être pas pendant un jour ou deux, mais elle ne la quitterait jamais. Jamais de la vie. Ma mère répondit que ce soin, elle le devait à son frère et que le risque que cela lui faisait courir lui était égal. Quand je reconstitue cette scène, j’imagine facilement la douleur que ma tante a dû ressentir, comme elle a dû détester sa sœur et l’admirer en même temps, lui reprocher son égoïsme et envier son courage. Elle a dû aussi se haïr pour sa lâcheté et ne pas accepter tout de suite que, malgré toute la tendresse qu’elle avait pour elle et la patience dont elle faisait preuve, elle pouvait ne pas être une raison suffisante pour que sa sœur renonce à son projet. Elle ne put lui promettre qu’une chose, elle n’en parlerait à personne, mais de ma mère, elle n’obtint rien en retour.
Toutes sortes de bibelots, d’objets curieux, et de fruits d’été commençaient à garnir les étals lorsque mon père s’éveilla et que les deux jeunes femmes partirent rejoindre leur oncle.
********
C’est sans doute à peu près à ce moment-là que l’armée prévint mon grand-oncle. On avait recouvert la tombe du « traître ». En temps de guerre, cela signifiait que l’on pouvait pardonner à ceux qui pardonnaient, qu’on était indifférent face à l’indifférence, qu’on n’imposait pas de règles à ceux qui refusaient d’en suivre. En fait, l’acte de ma mère avait été interprété comme un signe de tolérance et de réconciliation, ce qu’il était peut-être. Elle avait voulu montrer que ceux qui prônaient l’échange avaient raison, ou n’avaient pas tort. Certains dirent qu’elle avait seulement considéré que les liens familiaux étaient plus importants que tout autre attachement. Je me suis souvent dit qu’elle voulait peut-être juste tromper l’ennui, ou la tristesse, ou la crainte que la réalité ne corresponde pas exactement à l’idée qu’elle s’en était faite et ne soit pas celle pour laquelle elle voulait vivre et mourir. La femme que j’ai connue et qui était ma mère n’avait pas su, je crois, supporter le quotidien. Elle se nourrissait de livres et de voyages, de grands sentiments, d’intensité promise, mais, entre les conserves de cornichons et le laurier-rose qui s’étiolait dans un bidon d’olives rouillé, les mains sales et les bruits de ferraille, elle se consumait. Elle aurait probablement pu résister à l’adversité. A la pauvreté. Aux deuils. Mais pas, je crois, à l’usure et aux concessions. Qu’importe, avait dit son oncle, c’était une question de droit. Il n’avait pas le choix et devait l’empêcher de désobéir à un ordre énoncé par l’armée. Je ne suis pas sûr qu’il croyait en ce qu’il disait, mais il s’était engagé, lui aussi, à sa manière, et ne pouvait plus changer d’avis. Ou bien avait-il juste eu peur de ne pas correspondre à l’image que lui-même, les autres, l’armée, avaient de lui, et de n’être plus cet homme qui croyait en l’ordre et dans l’Etat ?
Un gardien du cimetière avait apporté à mon grand-oncle le livret que ma mère avait laissé tomber. Celui-ci le reconnut immédiatement puisqu’il avait appartenu au père de ses neveux et nièces. Il y avait soigneusement recopié les passages des textes qu’il préférait et y avait inscrit dans la marge ses commentaires. Certains étaient analytiques, d’autres beaucoup plus prescriptifs. Sur quelques pages, écrites sans doute à la hâte, les ratures et les nombreux renvois empêchent une lecture facile et aérée. Il reste, à quelques endroits du texte, des points d’interrogation, signes de ses propres hésitations. « Ca me rappelle les choses auxquelles je crois » répétait-il, puis il laissa, un jour, ce livre à ses enfants. Il est aujourd’hui avec moi, la diversité des textes recueillis m’amuse, et j’aime trouver, à côté d’écrits littéraires et philosophiques, quelques petites prières transcrites avec des signes que je comprends à peine, comme de petits hommages, les souvenirs d’une langue que seules, aujourd’hui, de très vieilles personnes parlent encore.
Mon grand-oncle, en recevant le petit livre, trouva la situation ironique ; celui qui avait appris à sa fille à ne jamais renoncer à ce qu’elle considérait comme juste et nécessaire lui avait légué la seule chose qui aujourd’hui la rendait coupable et l’empêcherait d’accomplir complètement son action. Dès qu’elle arriva au garage, il demanda à lui parler. Cette conversation, il ne la raconta qu’à mon père bien des années plus tard. Il l’avait trouvée d’une assurance étonnante, ne niant jamais et ne cherchant pas les excuses qui auraient pu, peut-être, expliquer la présence du livre au pied de la tombe de son frère. C’était même agaçant, cette fierté, cette façon de ne rien regretter, d’affirmer qu’elle y retournerait dès qu’elle le pourrait. Il espérait qu’après lui avoir expliqué les motifs de sa décision, elle renoncerait à ce qui était, somme toute, un manque d’égard envers l’Etat et ceux qui se battaient pour lui. Son frère n’était pas de ceux qui prônaient la paix, il ne désobéissait pas pour montrer l’inanité de ces affrontements, il s’amusait. Il ne croyait à rien, ni au bien-fondé de ce conflit, ni à la possibilité d’une paix durable. L’honorer ne pouvait être un hommage à son engagement puisque celui-ci n’existait pas. Mon grand-oncle en convenait, l’autre était devenu, au fil des ans et des guerres qui les ponctuaient, un fantasme, le cauchemar des enfants, des lieux où il était interdit d’aller, des frontières qu’il ne fallait pas franchir, une raison obscure de ne pas cesser le combat. Bien que construit et fantasmatique, ce système donnait un sens, formait une communauté et un imaginaire sans lequel celle-ci n’existerait pas. Il avait raison, ces grandes familles sont très pratiques, souvent elles évitent à ceux qui s’en remettent à elles, de faire un choix différent. Mon grand-oncle est de ces hommes droits que l’obéissance rassure parce qu’elle donne raison, que l’adhésion à un système de pensée aide à vivre. Accepter qu’on ne peut pas changer les choses, que l’on n’y peut rien, est peut-être difficile, mais, au bout du compte, cela doit être un soulagement immense. Qu’elle ne s’y trompe pas, ce n’était ni une position plus facile, ni une décision plus lâche qu’une autre. Lui aussi avait fait un choix, celui du repos, ce n’était pas le même, c’est tout.
Où la mènerait son acte, sinon à une probable arrestation ? Que faisait-elle du bonheur que lui promettait une vie calme avec l’homme qui l’aimait, de ces moments dont son oncle lui avait dit qu’ils rattrapaient tout le reste, les trahisons, les douleurs, les déceptions ? Peut-être commença-t-elle, à ce moment, à le croire, à se persuader qu’à la faveur d’un renoncement, elle gagnerait une vie heureuse. Pour lui, vivre dans un pays en guerre était une image fidèle de la vie. Il y avait ceux, affirmait-il, comme lui, qui prenaient soin du quotidien, qui ne croyaient pas à tout mais qui s’en accommodaient et faisaient de leur mieux pour que ces petits sacrifices soient supportables. Puis, il y avait ceux, comme elle, qui pensaient que servir de grandes causes rendait meilleur, égoïste et prétentieux certes, mais meilleur. Il comprit ensuite qu’il s’était trompé, qu’elle ne voulait pas être une héroïne, qu’elle avait bien un idéal, mais que celui-ci était personnel. Ma mère n’avait pas agi par pacifisme, elle ne prônait pas la paix, elle y croyait à peine. Elle pensait seulement le monde comme il n’était pas, un espace dans lequel les ordres les plus impérieux étaient ceux que l’on se donnait à soi-même. Un mince voile de tristesse rêveuse, d’émotions secrètes et de souffrances recouvrait cette frêle jeune femme, une sorte de lichen romantique avait imprégné le cœur de ma mère, une brume affective dense, quelque chose relevant du crépusculaire entre le sublime, le tourment, le rêve et la solitude. Qu’elle eût réussi à rendre les hommages à son frère n’aurait peut-être rien changé, qu’elle eût éprouvé le sentiment, au moins une fois, de faire vivre l’idée qu’elle s’était toujours faite de la réalité et d’accomplir un désir qui lui était propre lui aurait sans doute offert une satisfaction éphémère.
********
J’ignore à quel moment ma mère renonça à retourner au cimetière. Fut-ce lorsqu’elle revit mon père après son cours de droit, lorsqu’il s’assit près d’elle en silence ? Fut-ce lorsqu’il la regarda écosser des haricots qu’ils s’apprêtaient à préparer ensemble pour le soir, lorsqu’il lui raconta la dernière échauffourée, le discours du ministre des armées qui ressemblait tant aux précédents, les travaux autour de l’université ? Bientôt, il y aurait des espaces verts qui entoureraient la nouvelle bibliothèque. Il savait, bien sûr, son père lui avait dit qu’elle avait tenté d’enterrer dignement son frère, un traître, mais il ne lui en parla pas, il ne lui en parlera jamais. Bien sûr, elle aussi savait bien que mon père avait été informé. Tu sais, me dit-il, j’étais terrorisé, je tremblais de tous mes membres quand nous nous sommes vus pour la première fois ce jour-là…Je ne cessais de me répéter que de moi dépendrait sa décision. Je craignais qu’aucun mot ne compte face à l’amour qu’elle portait à son frère, j’avais terriblement peur que le mien ne suffise pas. Je me dis aujourd’hui que le deuil que ma mère portait effrayait mon père. Il ne savait comment l’approcher et n’était pas prêt à accueillir sa souffrance, sa solitude, l’asphyxie qui l’empêchait de respirer, le cri de désespoir qu’elle poussait. C’est peut-être avec d’autres armes que ses sentiments qu’il aurait pu atteindre cette douleur et sans doute l’aider à l’apaiser. Pour cet étudiant en droit, qui maniait si bien le concept de justice, il aurait été simple de lui parler de légitimité et du sentiment personnel d’équité. Ça les aurait peut-être aidés, elle, à aller jusqu’au bout de ce qu’elle pensait nécessaire, lui, à comprendre pourquoi et à se résoudre, pour cela, à la perdre. Il n’en était pas capable. Je ne l’en blâme pas, moi qui ai eu tant de mal à accepter qu’elle m’échappe, ma mère, et bien plus de temps que lui pour cela. Moi aussi, j’aurais sans doute tout fait pour la retenir. Si j’avais été lui, je me serais bien sûr évertué à lui expliquer pourquoi il ne fallait pas qu’elle prenne un tel risque. Et si je n’y étais pas arrivé, j’aurais fait mon possible pour l’attendrir, pour qu’elle ait pitié de celui qui l’aimait. J’aurais pleuré, je l’aurais suppliée à genoux, sans aucune honte, je me serais frappé et griffé jusqu’au sang. Je me serais jeté sur elle comme un assassin, je n’aurais pas hésité à l’attacher, je lui aurais fait la promesse d’être plus mignon, plus doux qu’avant. Mais nous avons vécu, mon père puis moi, notre propre drame, pas le sien. Un jour, il me confia que leurs silences, comme ils étaient assis l’un près de l’autre, le soulagèrent.
Ce soir-là, quand ma mère sortit, seuls quelques échoppes et les cafés étaient encore ouverts. Ici, lorsque la chaleur commence à baisser, la nuit tombe déjà. C’est le moment dont les étudiants raffolent, on entend leurs voix qui proviennent des terrasses envahir les rues et couvrir les cris des mères inquiètes de voir leurs enfants dévaler les trottoirs de pierres vers la mer, mais on ne les voit pas. Dans l’obscurité pesante où leur légèreté crée un contraste curieux, des militaires se déploient et veillent. On aurait dit pourtant qu’elle ne les voyait pas, elle marchait, apeurée, hagarde ou rêveuse. Elle semblait perdue dans ces rues qu’elle connaissait pourtant si bien. Elle butait contre des ombres, des silhouettes noires qui se demandaient vers quel point obscur de la ville cette jeune femme, toute seule, se dirigeait. On me raconta que, croyant le reconnaitre, elle avait appelé son frère, voulu le rattraper et s’agripper à lui. Elle dut vouloir retourner au cimetière et traverser la ville en oubliant ses frontières imaginaires. On me dit souvent que, petite, lorsque la nuit tombait et que son père n’était pas encore rentré, elle avait coutume, impatiente, de se précipiter dans la rue et d’attendre, parfois pendant des heures, parfois en s’éloignant de la maison, ce soldat contre qui elle se blottirait. Elle s’imaginait dans ses bras, la peur qu’il ne rentre pas aurait totalement disparu, il la porterait haut, il sentirait bon, il lui promettrait d’attendre un peu avant de s’en aller. Mais de ces sorties nocturnes, cette petite fille revenait souvent bredouille, et lorsqu’il rentrait, harassé, triste, il ne désirait que repartir. Il disait que c’était important pour lui, que ça comptait, de se battre, et que malgré tout cet amour, il préférait être là-bas. Il combattait ceux qui faisaient de la lutte contre l’autre un principe éternel et divin, il croyait, plus fort que quiconque, à l’unité et à la paix, et personne ne valait, pour lui, cette croyance.
On la vit s’arrêter devant les grilles du cimetière, apparemment épuisée, comme au terme d’un long voyage où chaque pas aurait été un obstacle franchi avec effort, à l’intérieur d’un espace devenu soudain étranger et effrayant. Le gardien qui l’aperçut la reconnut immédiatement, c’est elle qu’il avait vue ce matin-là. Devant l’entrée, le regard happé par un point fixe, on aurait dit qu’elle guettait quelque chose, un signe, une voix. Elle aurait voulu, peut-être, qu’on la pousse, qu’on lui donne une raison d’entrer. Mais lui, malgré la peine que ça lui faisait de la voir toute seule comme ça, a pensé que ça le rendrait complice et qu’après tout, ce n’était pas son rôle. De plus, cette fille avait une famille, tout comme lui d’ailleurs. Après l’avoir longuement regardée et essayé d’attirer son regard, il est parti sans rien lui dire. Parce qu’elle ne revint à la maison qu’à l’aube, j’imagine qu’elle resta plusieurs heures à attendre. Peut-être déambula-t-elle en cherchant fébrilement des raisons qui justifieraient le choix qu’elle était sur le point de faire. Sans doute contempla-t-elle les façades, fascinants palimpsestes où elle-même avait, un jour, écrit son nom, se glissa-t-elle dans les ruelles sombres qu’elle avait tant de fois parcourues, et ressentit-elle une nouvelle fois l’humidité qui régnait entre ces murs qu’un fin ruban de pierre séparait et qu’un collier d’habits aux couleurs criardes et exotiques reliait de façon asymétrique. Elle caressa peut-être l’air suave et encore chaud et en goûta, au fur et à mesure qu’elle s’avançait vers la mer, le sel et l’amertume. Elle sera remontée par l’une de ces larges artères éclairées qui lient le bord de mer aux grandes places, puis aura longé les murs de la petite école, ceux de la maison qu’elle avait habitée et des refuges où se retrouvaient jadis les veuves, les pauvres, ceux qui voulaient être moins seuls. Souvent, ma mère, ma tante, leur mère et le cadet des deux frères venaient apporter leur aide. On y jouait de la musique, lisait quelquefois, et les soirs les plus réussis, on y dansait aussi. Il y a des choses qui ne cessent jamais de rendre heureux, répétait ma grand-mère, et ma mère n’avait jamais été plus en accord avec elle.
Le matin suivant, un soldat appela mon grand-oncle, la tombe était restée intacte et rien n’avait été tenté. Que, cependant, on la surveille encore quelques jours. Ma mère n’y retourna cependant pas, ni le lendemain, ni plus tard, et réussit, après ma naissance, à oublier ce qu’elle n’avait pas fait, mais les remords revinrent vite. Elle resta pourtant près des siens.
********
Je me dis que si ma mère avait fait un choix différent, si elle ne s’était pas sentie prisonnière des liens qu’avaient construits sa sœur, l’homme qui l’aimait, les autres, si elle n’avait pas fait le choix de la vie – et qui pourrait lui en vouloir ? –, si elle n’avait pas donné raison à cette guerre et à ses lois, elle n’aurait pas passé sa vie à se haïr, n’aurait pas fait de mon père cet homme malheureux qui a aimé de tout son cœur une femme qui n’a jamais pu lui rendre ce qu’il a passé sa vie à lui donner. Elle n’aurait pas fait de moi cet homme qui la cherche depuis si longtemps.
D’elle, je me souviens de ce conseil sibyllin que je comprends mieux aujourd’hui.
« Si, un jour, tu as à faire un choix, ce que je ne te souhaite pas, essaie de faire le bon. »
Ma mère avait-elle fait le mauvais choix ? Aurait-elle pu faire autrement ? Cesser de croire que l’idée que l’on a de la réalité et le monde dans lequel on vit puissent correspondre est-il un choix condamnable ? Je n’ai pas de réponse mais une question me revient à chaque fois que je repense à nous – qu’aura-t-elle sacrifié pour une vie calme et sans cris ?
Ce que ma mère ne s’est jamais pardonné, ce qu’elle n’a jamais pardonné aux autres, le renoncement à l’engagement et aux rêves, ce tueur en série sénile des âmes déçues, je le lui pardonne. Comme elle, je suis resté longtemps derrière les grilles d’un cimetière, le regard happé par un point fixe, à contempler le vide, la culpabilité et l’absurdité, croyant que c’était moi, le coupable de tant de tristesse, puis elle. Longtemps, j’ai traqué ces meurtriers, ces vieux séducteurs madrés à la voix douce-amère telle la corde voilée d’un violoncelle, ces rusés chasseurs de cœurs brisés. Jamais avant aujourd’hui, je n’ai pu, ou voulu entrevoir ce que dissimulaient ses silences. Comme elle, j’ai attendu longtemps avant de pouvoir dire tout cela, le temps du silence, de l’absence, que les langues se délient enfin, que l’arrogance de la jeunesse passe et que l’ajustement du regard vise ce qui a compté et non ce qui a manqué.