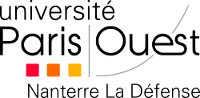Répondre au commentaire
Un homme à l'amer
Le nouveau livre de Jean Selbent, Jeunes soupirs et vieilles prières, sera sur les tables des libraires pour le début du mois de décembre. Doit-on s’attendre à une nouvelle trainée de poudre de la part du célèbre polémiste ? Rien n’est moins sûr…
« On dirait qu’ils n’osent pas transformer la Réalité. Ils sont les esclaves de la réalité, elle leur intime de ne pas mentir et de la suivre, en rangs, silencieux, obéissants, dans ses souffles d’agonisante, dans son moindre repli banal. Ils ont fait de la réalité une institutrice sadique au chignon tiré. Eux, ce sont les élèves timides et terrorisés du premier rang. Et cela donne de petites notations blafardes, toujours imprégnées d’Incertitude (autre déesse de la littérature de notre époque !), cela donne des dialogues mourants et des moitiés de personnages (les fameuses ombres contemporaines), cela donne des sortes d’esquisses faiblement crayonnées, qu’ils empêchent eux-mêmes de devenir des œuvres. Une œuvre c’est-à-dire quelque chose qui nous offre un support, un appui au rêve, une œuvre, c’est-à-dire quelque chose qui se grave dans notre cerveau, comme l’épitaphe sur la pierre, et qui nous remplisse de matière, nous autres, êtres humains qui avons besoin d’être arrimés solidement sur le sol de la terre, c’est cela le travail des artistes. »
Jean Selbent est un homme qui ne s’entoure pas, qui fuit les coteries et les chapelles littéraires, drapé dans une irritation constante et toujours en verve. Après s’être fait les dents sur la littérature, il a donné son avis sur tout. Pour beaucoup il est tentant de le ranger dans la catégorie des « nouveaux réacs » ; mais ce néo-conservatisme même a eu à pâtir de son ire redoutable. Comme pour tout le reste, il en a déconstruit les rouages et exposé les illusions, le révélant dans sa nudité de phénomène supplémentaire. En effet, c’est la gymnastique matinale de Jean Selbent que de conspuer quotidiennement notre société qui glisse et se contorsionne, patineuse frénétique, sur la ribambelle de ces divers phénomènes que toutes les fenêtres du Nouveau Monde (journaux, télés, radios, mais surtout internet, réseaux sociaux, buzz et autres blogs) charrient chaque jour, en trombe, sur nos têtes affolées.
Cette maison ouverte à tous les vents, il est peu de dire que Jean Selbent lui voue une véritable haine. Notre demeure culturelle commune, il la voudrait robuste et sûre d’elle, mais il lui apparaît qu’on en sape tous les jours un peu plus les fondations. Selon lui, elle est devenue « un morceau de gruyère que se disputent voracement toutes les souris folles du pays : il s’agit de se saisir d’un bout de ce fromage sans goût, et de le disperser partout, l’émietter devant toutes les vitrines du pays pour pouvoir s’y mirer à l’infini. » (Misère de la Nouveauté, 2005). Jean Selbent n’en peut mais. Il suffoque, il étouffe. Mais il ne se rend pas.
Si l’on observe le comportement de notre contradicteur en chef, qui ne manque pas de vilipender l’anti-conformisme lui-même, on pourrait dire qu’il est prêt à toutes les compromissions. Il se montre sur les plateaux télés, puis va se poster devant les micros de toutes les radios de France. Régulièrement, il jette à nos figures un article dont la froideur et l’implacabilité nous figent, comme le gant de Don Gomès la joue de Don Diègue. Enfin, ouvrez Google, cela pullule d’interviews accordées par l’ermite : depuis sa tour d’ivoire fusent tous les jours des projectiles empoisonnés.
Alors… alors… stupeur ! ahurissement ! à la découverte du dernier livre de Selbent. Imaginez un peu : on ouvre le colis, on le prend en main, on soupèse le mince volume. Non, cela ne ressemble pas à du Selbent, lui qui a l’habitude de nous jeter ses pavés obèses et difformes à la face, jamais assez lourds, jamais assez épais, pour embrasser l’étendue de la répulsion que lui inspirent notre misérable terre et nos misérables comportements de grotesques scarabées vaniteux. À l’intérieur du livre, les pages, qui débordent habituellement de lignes denses, de paragraphes condensés au point de faire gicler à nos figures le venin qu’ils contiennent, ces pages sont devenues aériennes et les phrases semblent des roseaux dénudés et fragiles. Qu’est devenue la syntaxe touffue, interminable, rebondissante comme un chien enragé. Et les cascades d’adjectifs assassins, les points d’exclamation vitupérants, ubi sunt… a-t-on presque envie de murmurer tant on a peur que la palpitation hargneuse de Selbent, qui nous exaspère parfois, mais nous projette dans la vie malgré tout, ait disparu en laissant derrière elle un silence de mort.
À propos de littérature, je me rappelle d’un livre qu’il avait écrit à la fin des années 90. Il n’avait pas de mots assez durs pour qualifier la vogue de l’auto-fiction, ou celle des récits de femmes qui « ne se dépêtrent pas des quelques regards las que leur père leur a adressés quand elles étaient adolescentes et qui en tirent ces phrases languissantes qui s’étirent interminablement sur des pages et des pages, des volumes et des volumes de récits » (L’Individu maniaque, 1997). Pourtant que lis-je, que lis-je !, en ouvrant le mince volume, la voici cette première phrase :
« Mon père était tellement loin et je l’aimais tellement que j’avais l’impression qu’il était moi. Il vivait en moi et j’étais obligé de bouger dans tous les sens pour trouver un amour qui soit à la hauteur de ce sentiment caché. Et ça donnait une cavalcade effrénée après l’amour. »
On passe donc d’abord par une première crainte : celle que Selbent se soit retrouvé entre les mains d’une amante, amatrice de psychanalyse qui l’aurait forcé - tout comme elle aurait pu exiger d’un autre qu’il cesse de boire - à passer sa vision éruptive et réactive du monde au filtre du schéma freudien. Et puis l’on avance dans ses pages étonnantes et l’on respire : non, il ne s’agit pas d’une confession. Non, Selbent n’égrène pas quelques minces souvenirs embués par une mémoire défaillante, il n’est pas devenu un individu ectoplasmique qui cherche dans un passé banal la clé d’une vie ratée et embryonnaire.
Ce roman d’une centaine de pages narre les premiers pas d’un jeune homme dans la vie intellectuelle des années 70, les rencontres qu’il fait, les théories auxquelles il est confronté. Il y a une figure paternelle qui plane et dont on comprend rapidement qu’elle est imaginaire. Il semble qu’elle soit un mélange entre son père biologique et les initiateurs du vrai Selbent : le prêtre, principal du collège jésuite qu’il a fréquenté ; son modèle en littérature, l’écrivain Raymond Sanquer ; et cet homme marginal, en voie de clochardisation comme on dit, qui fut son voisin quand il arriva à Paris, sorte de Cioran raté, retranché, comme le Roumain, dans une chambre de bonne parisienne. Le narrateur tente de se frayer un chemin dans le monde et dialogue avec cette figure paternelle hybride qui produit des discours travaillés comme de la dentelle et légèrement oraculaires auxquels le narrateur doit se confronter et à partir desquels il tente de justifier ses choix. En somme, il s’agit d’une sorte d’autobiographie intellectuelle qui montre les diverses facettes d’un homme dont la multiplicité l’a toujours empêché de produire un système de pensée livrable clés en main, à toutes les sauces et sur tous les sujets. Une pensée protéiforme, inconstante et tiraillée.
S’agit-il d’un texte de jeunesse ? C’est possible tant le doute est fort, prégnant, fondamental, et presque paralysant. Nous assistons donc à la genèse de cet esprit, violent et volcanique, mais qui n’aurait jamais sacrifié la complexité du monde à la cohérence de la pensée. Comme si Selbent avait tenu à nous expliquer que l’ardeur de ses réactions, les provocations dont il est coutumier, étaient le fruit d’un rapport au monde intense et amoureux.
Emmanuelle Maffesoli.
Jeunes soupirs et vieilles prières
Requiem éditeurs, 2012
158 pages.