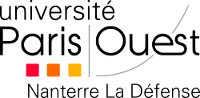Abus de faiblesse, de Catherine Breillat
Abus de faiblesse est le récit de la rencontre entre Catherine Breillat et l’escroc Christophe Rocquencourt, rencontre provoquée par la cinéaste qui recherche la vedette masculine de son prochain film, une histoire d’amour toxique entre une star de cinéma jouée par Naomi Campbell et un homme. Le récit alterne passages sur l’hémiplégie de l’auteur, qui fut victime d’une attaque cérébrale en 2005, et description de ce qu’elle nomme abus de faiblesse : l’entreprise systématique d’accaparement mental et financier entrepris par Rocquencourt, durant les quelques mois que durèrent leur relation.
Abus de faiblesse est un roman que j’ai lu coincée entre un mineur, dévoreur de bandes dessinées, et un vieillard proche de l’état du clochard, consultant un ouvrage d’astrologie, un jeudi soir d’octobre. Dehors, il pleut. Nous sommes tous les trois installés sur un banc de moleskine affaissée, le seul et l’unique du sous-sol du Virgin Mégastore des Champs-Élysées. Avoir une place ici relève de l’exploit : huitième arrondissement, Champs-Elysées, personnel conciliant : autant de raisons pour que l’endroit soit assiégé, qu’une queue se forme devant cette banquette située au large des romans poches et d’un escalator désert. Or, il n’en n’est rien. Je prends donc l’opportunité de ce banc pour une chance, vaguement abattue un instant, en songeant que le bruit qui court ces derniers temps est peut-être vrai, que les gens ne lisent plus. Que cet entresol est un purgatoire, un autodafé latent. J’admets que ce n’est pas moi, ce soir, qui ferai fonctionner l’économie du livre. Les 16,59 Euros d’Abus de faiblesse ne passeront pas par la caisse, resteront dans mon portefeuille où d’ailleurs où ils sont pas. Je suis à découvert et n’aime pas les bibliothèques, à moins peut-être qu’un certain goût un peu lâche pour la subversion, – la subversion du pauvre, dois-je relativiser, – ne me dicte cette conduite honnêtement honteuse, celle de lire sans payer sur les Champs-Élysées.
Pourquoi ce choix ? Abus de faiblesse, Catherine Breillat. Un battage médiatique : Paris Match, Gala, Libé, 20 minutes, m’ont influencée. Arrivée chez Virgin, je demande l’ouvrage à un jeune homme déguisé en rouge, me trompe, confonds les tortures psychiques et les Catherine. L’écrivain et la cinéaste sulfureuse dont je ne connais pas l’œuvre.
J’énonce : Abus de souffrance, Catherine Millet. Le jeune homme m’exhibe Jour de souffrance : je réalise ma bévue, lui parle escrocs et malversations financières, jusqu’à ce je mette enfin un titre et un nom sur l’ouvrage qu’il me tarde maintenant de lire : Abus de faiblesse, de Catherine Breillat.
Une minute plus tard, le jeune homme revient, le volume en main. Après un petit tour du propriétaire parmi les rayons, virevolte virtuelle destinée à tromper quiconque aurait pu croire, à raison, que je ne compte pas acheter l’ouvrage, me voici sur le fameux banc. Musique de frôlement d’escalator en fond, dos de préadolescent penché passionnément à ma gauche, odeur de vin et pire à ma droite.
Abus de faiblesse : Ce qui m’a plu est peut-être résumé dans le cœur même du livre. Catherine Breillat fait dire par le biais de son nègre, Jean-François Kervéan, dans la bouche de Michel Lafon : « Christophe, toi tu es l’incarnation du vieux fantasme populaire : partir de rien, monter très haut, traverser une épreuve dramatique et triompher par une nouvelle ascension plus magnifique encore ».
Tout est dit ! Christophe Rocquencourt, c’est Al Pacino dans Scareface, un concentré français de tous les films de mafia, d’entourloupe, Arsène Lupin en vrai ! Lire Abus de faiblesse, c’est découvrir une des multiples duperies d’un escroc, figure populaire détestable mais qui fait rêver les foules, dont moi. Lire Abus de faiblesse, c’est découvrir ce que cachent les brèves des quotidiens, les titres d’articles mystérieux suivis de quelques paragraphes bien frustrants pour le lecteur voyeur : Association de malfaiteur et grand banditisme, Escroquerie dévoilée dans l’univers des machines à sous. Puis, rien.
Qui ne s’est jamais demandé ce que cachaient ces mots, ce qu’ils sous entendaient d’existences illicites, de dommages humains collatéraux, d’anecdotique et d’essentiel ? Qui sont-ils, les escrocs, les bandits ? Quelles sont-elles leurs victimes ? Où tout cela se passe-t-il vraiment ? Faits divers, drames, m’ont toujours semblé appartenir à une sorte de fiction invraisemblable. N’est-il pas un monde entre les existences communes du citoyen ordinaire, – soit quatre-vingt-dix pour cent de la population – , et tous ces faits rapportés par les journaux, ces mots noirs sur papier gris, qui souvent ne semblent être que des coquilles vides ?
*
Un soir, c’est la révélation : Catherine Breillat est devant sa télévision, l’émission d’Ardisson, Tout le monde en parle est en train de passer. Un homme arrive sur le plateau, « Un regard qui entraînerait une femme magnifique, une star, sur son territoire, pour régner en conquérant analphabète et souverain. » Ce sera lui, lui qu’elle veut : « Parce qu’il est brutal (…) je suis subjuguée. » Casting sauvage, télévisuel, pour dénicher sa future vedette, le futur partenaire de Naomi Campbell, un homme d’une quarantaine d’années qui sent le souffre, a escroqué des célébrités aux Etats-Unis, usurpé des identités, et passé quelques années dans les prisons américaines. Mais il a payé sa dette à la société. C’est en tout cas ce qu’il affirme, d’une voix traînante. La cinéaste prend contact avec l’escroc. Une fiction en soi.
Abus de faiblesse parce qu’elle est hémiplégique, parce que l’homme la roule comme il sait si bien le faire, aspirant son argent tandis que la seule scène qui est jouée pendant cette période d’accaparement est une scène de dialogue de films à la Audiard : « Je palpe un million », déclare Rocquencourt. Les millions de Catherine Breillat.
Abus de faiblesse est l’histoire d’une deuxième descente aux enfers, (l’hémiplégie est la première) d’une femme, d’une artiste que la passion de l’art aura fait passer du statut d’auteur, de créateur tout puissant, à celui de marionnette disloquée : « Moi qui voulais tout lui voler, je n’ai pas imaginé qu’il venait tout me prendre. Je pensais : qui je veux, me veut. Qui j’utilise, m’utilise. »
C’est sans compter Christophe Rocquencourt. Car oui, il l’utilise, jusqu’à la moelle, la laissant, c’est ce que le récit narre, littéralement sans argent, avec ce qui est peut-être pire, la sensation de s’être fait avoir, du début à la fin.
Pourtant, rien n’est aussi simple ! Le roman démarre fort : « Mon père était gitan, ma mère pute. » Du Zola à l’estomac. C’est ce que déclare, dès le début du récit de Catherine Breillat, Christophe Rocquencourt, manière éventuelle de se dédouaner de qui arrivera tout au long du roman. L’homme présente mal, mélange du gangster de banlieue pavillonnaire et de l’oncle de province carrément vulgaire. Pourtant, la cinéaste est subjuguée, un peu plus loin bouleversée, une deuxième fois subjuguée, puis elle déclare : « L’ampleur de sa présence m’emplissait. », « Sa manière de prendre l’espace me (évidemment) subjuguait. »
Abus de faiblesse n’est pas le récit d’un bourreau et de sa victime, mais (aussi) l’histoire d’un démiurge dont la créature se révélerait, à l’usage, plus dangereuse que prévu. Se dessinent dans ce roman deux figures, celle de l’artiste et celle de l’imposteur. L’artiste cherche un acteur, l’imposteur, un coup à faire. L’ironie de ce récit, c’est que l’artiste, figure de l’imposture également dans cette tentative d’échapper au réel (« On est tous des imposteurs, on essaie tous d’échapper à la réalité. Elle est pas belle la réalité, » dixit Christophe Rocquencourt sur le plateau de Thierry Ardisson) se faire littéralement duper par l’escroc : du grand art.
On voit clairement dans le récit de cette sordide histoire d’extorsion de fonds, narrée, rappelons-le, d’après le ressenti de la « victime », que le type de relation qui se noua très vite entre C. Breillat et C. Rocquencourt fut un genre de rapport maladif, le corollaire d’un syndrome de Stockholm. Car, même si le mot n’est pas employé, c’est bien de sidération qu’il s’agit dans cet ouvrage et Catherine Breillat ne devient du coup rien d’autre qu’un citoyen lambda qui, croisant ce genre d’homme, ne peut rien faire d’autre que de succomber à son aura singulière. Mais il n’en n’est rien : si la cinéaste tombe, c’est qu’elle le veut, si elle se laisse séduire par cette voix « rauque, traînante, où flirtait le mal », c’est qu’elle est attirée, car ressentir est son fond de commerce.
L’imposteur ment, escroque et vole ; l’artiste ment, escroque et vole. Le syndrome de Stockholm, c’est la quête d’une « Gestalt », d’une totalité, entre une victime et un bourreau, qu’un véritable élan d’empathie pousse l’un vers l’autre. C’est un rapport sado-masochiste qui comble les deux individus qui le composent. Dans Abus de faiblesse, Catherine Breillat devient un otage, celui de l’homme qu’elle a choisi et de son propre art. Dès les premières lignes du récit, la fin est devinée, presque annoncée, et la suite ne devient qu’un développement anecdotique, un document presque clinique, l’étude d’un cas de manipulation entre deux Narcisses en puissance, deux egos surdimensionnés que sont l’imposteur qui détruit et l’artiste qui tente de construire en se mettant en danger. Dans la dichotomie détruire ou créer, on retrouve la figure de l’inventeur, de l’écrivain, du cinéaste, et celle de l’escroc, deux figures interchangeables évoluant dans une marge désirée car vitale.
Abus de faiblesse est un roman un peu long, même pour un roman lu sur un banc, mais un récit fascinant pour quelques unes de ses phrases à la sensualité vénéneuse, et pour son portrait d’un homme archétypal : une figure de l’imposture qui, malgré sa saleté totale, laisse toujours le commun des mortels un peu songeur. En somme, cette rage de survivre, d’échapper à un destin, de créer une légende pour ne pas devenir un vivant mort nous touche tous un peu car elle relève des profondeurs existentielles de nos vies : cette « prodigieuse envie d’exister qui n’est jamais tout à fait pitoyable. »