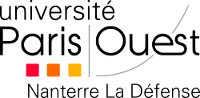Cécile Reims graveur
mer, 02/01/2012 - 23:20
 « Un voyage au fond de soi » (Victor Segalen)
« Un voyage au fond de soi » (Victor Segalen)
Dans l’intimité de son espace souterrain, le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme expose, jusqu’au 5 février, les œuvres gravées de Cécile Reims. Sous la forme d’arbres, d’animaux, d’êtres tirés de la mythologie et de paysages désertiques, le cheminement de l’artiste y prend toute son ampleur et convie le spectateur à un voyage étrange et inquiétant.
Elle est graveur et utilise le burin. Elle a creusé le sillon d’une vie douloureuse à la surface d’une plaque de cuivre. Cécile Reims, d’origine juive et lituanienne, émigrée en France dans les années 30, semble avoir extirpé, copeaux après copeaux, la blessure d’avoir perdu les siens, exterminés pendant l’Holocauste. De ses propres drames, historiques et intimes, de sa rencontre avec le dessinateur et peintre Hans Bellmer, comme de sa relation avec Fred Deux, son compagnon, virtuose du dessin, l’artiste de 80 ans tire une œuvre personnelle et mélancolique, aujourd’hui couronnée du Prix Maratier. Alors que, comme un traducteur colore de sa plume les mots d'un écrivain, elle fait alterner gravures d’interprétation, tirées des dessins de ces deux hommes, et gravures de création, reviennent et s’approfondissent, tout au long de son travail, présenté selon un principe chronologique, les motifs de la vieillesse, de la disparition, des origines.
Les métamorphoses de l’humain. Ses premiers paysages, ceux de Psaumes (1952), inspirés de la Palestine et de la Judée, qu’elle a rejointe clandestinement en 1946, représentent des hommes travaillant la terre. Au réalisme biblique succède pourtant très vite un ensemble d’œuvres plus inquiétant où l’homme se confond avec la bête. Les Métamorphoses, illustration de celles d’Ovide, montrent six gravures dans lesquelles l’homme se mue d’abord en chien, puis en oiseau et en hiboux. Sur l’une d’entre elles, il est mi-homme, mi-arbre, sur une autre, il se transforme en un mur de pierre. Progressivement, l’humain disparaît, ou se métamorphose. Il est une partie de la nature, se grave dans ses profondeurs. Des dessins d’Hans Bellmer et de Fred Deux, Cécile Reims retranscrit un enchevêtrement de corps et des personnages aux formes incertaines au sein d’un même élément naturel. Devant Le Sphinx (1967) ou Le Souterrain baroque (1966), on pense volontiers à Dali et aux mondes surréalistes que l’artiste s’approprie et dans lesquels elle déploie son imaginaire et donne forme à ses angoisses. Les deux gravures s’inspirent des dessins de Bellmer – l’appropriation de Cécile Reims est donc double – et représentent un espace étrange, fermé, sombre, à l’intérieur duquel des formes humaines se confondent peu à peu avec la pierre. Leurs corps sont si striés que l’on distingue, en les observant, des fissures, à moins que ce ne soit des os, comme si l’œil de l’artiste, en gravant, allait au-delà des premières couches de chair. Lorsqu’elle travaille des œuvres de Fred Deux, Cécile Reims montre des corps qui se mêlent étroitement. Dans Le Nom imprononçable, bras, têtes, jambes se chevauchent, se superposent et interagissent alors que la gravure accentue le dessin des traits, des séparations. Au bas du tableau, les lettres en hébreu יה, signifiant la « vie », rappellent que Cécile Reims, au travers de la représentation des blessures infligées aux corps, reste à la recherche d’une forme d’élan vital, d’où ce lien très étroit entre l’homme, le végétal et l’organique. Le corporel apparaît comme un élément de la vie sous toutes ses formes, comme une lettre au sein d’un unique et essentiel alphabet. Il y a de l’humain dans les paysages, les arbres, les plantes, l’être humain « s’enracine » et devient végétal. A égalité. Cette conviction dont son travail est le reflet fonde sa proximité avec les œuvres de Bellmer et Deux, « qui transgressent, aux yeux de l’artiste, toutes les séparations entre les règnes, en un mouvement de métamorphose ». Les gravures d’interprétation et de création creusent dans une réalité irréelle, imaginaire, « qu’elle pressent et qui, explique-t-elle, à la fois double et infirme ce que [ses] yeux perçoivent. Nie les commodités des frontières. »
Lorsque ce n’est pas l’homme qui mue, c’est l’animal, celui dont l’être même est de se métamorphoser, La chenille. Sur un ensemble de planches où Cécile Reims « dissèque » la bête, la chenille est traitée comme un végétal, un élément organique dont l’intérieur évoque un grouillement cellulaire. La nature, en revanche, chez Cécile Reims, est triste et désolée, à l’image de celle représentée dans le Bestiaire de la mort et dans Histoires Naturelles (1996-1997), minérale et mélancolique, invivable pour les espèces animales qui s’y trouvent et avec lesquelles la condition humaine, manifestement, se confond.
Un monde de pierre. Les mondes que Cécile Reims grave et interprète, dans Anatomies végétales (2006), La Grande Muraille (2006), ou Loin du temps (2001) bénéficient de la précision et de la finesse du trait permises par le burin – ils sont fissurés, craquelés, cassés. Ce sont des déserts qui reviennent dans la plupart des gravures, et l’être vivant y est de plus en plus absent, sinon sous la forme la plus élémentaire, infime partie ou principe d’un tout. Loin du temps montre un paysage désertique, sec, pierreux. Une seule montagne asséchée, dont on imagine facilement que les arbres qui s’y trouvent ne possèdent ni feuilles ni hautes branches, que le sol est de roche, constitue le point de fuite du dessin. Au milieu d’un espace anonyme, éteint et sans vie, griffé et fissuré, une cime s’élève, solitaire, dont le poème de Cécile Reims qui porte le même titre se fait l’écho.
« Muette, elle clame
Qu’arrivé là, on apprend
Que jamais on arrive »
Emane de cette rencontre entre la gravure et l’écriture le désir de tracer un chemin parmi un paysage intérieur dévasté et d’une tristesse infinie. Ce chemin, c’est celui qu’au cours de l’exposition, l’on retrouve souvent. Dans La Grande Muraille, la surface est parcourue de ces fissures qui forment des dizaines de chemins de traverse irréguliers et sans fin. Ils sont la trace d’un voyage qu’on ne finit jamais, qui n’est ni droit ni sûr et dont on ignore bien s’il mène quelque part. Qu’importe sans doute, puisque seul compte le cheminement, semé de béances, mais essentiel. Il n’est jamais apaisant et toujours tourmenté.
Les mondes que Cécile Reims grave et interprète sont intérieurs, les routes qu’elle trace sont des passages vers soi, vers ses propres obsessions, ses peurs et ses meurtrissures. Devant Forteresse de paille, elles ne sont pas visibles mais la gravure est une ouverture, un petit entrebâillement vers elles. De gros blocs de chaumes pressés et des bottes de paille sont adossés les uns aux autres en une vertigineuse construction. Ici et là, quelques interstices forment des fentes ténébreuses, « des plaies fusant vers d’improbables entrailles ». Forteresse de paille est une image même de la quête de soi, du besoin d’aller au plus profond de ses blessures, et c’est sans doute pour cela que la gravure est une des plus étonnantes.
Les mondes que Cécile Reims grave et interprète sont aussi ceux qui la conduisent à ses origines ancestrales, à sa terre, aux siens. Elle est la plus grande des gravures – elle se découpe en 15 panneaux – la plus symbolique et la plus émouvante, Kaddish, d’après Fred Deux (1983-1984). Elle est, à en croire le titre, une prière, la prière des morts, la prière pour la mère disparue. Chacune des petites gravures possède, en haut, une lettre en hébreu, comme un hommage à la langue originelle. A côté de formes étranges, larvaires, végétales, s’inscrivent sur la surface de la gravure quelques objets symboliques qui rappellent la mère, son univers intime, la relation à sa fille. La gravure est un lien que l’artiste noue, celui qui justement disparaît dans le dernier panneau de Kaddish et que la gravure maintient ; deux corps, autrefois liés, sont désormais séparés, l’un regarde celui resté en bas, recroquevillé sur lui-même. La gravure est l’expression d’un inévitable enracinement malgré le passage du temps et des êtres qu’on aime, malgré la fragilité des vies ou malgré la douleur. C’est ce que Histoires Naturelles (1996-1997), série de quatre gravures, nous conte – car Cécile Reims nous raconte toujours une histoire, celle de la perte de l’être qui est un lien avec une langue, un monde, une origine ancestrale, qui nous abrite, nous entoure et nous quitte, celle de l’attachement fragile et éternel aux racines ; là, les tiges que le vent ne parvient pas à déraciner penchent encore et encore, des arbres restent attachés au sol malgré leurs branches lasses, nues, qui plient et s’inclinent (cf. illustration). De ses dessins nous sommes les réceptacles. La vieillesse, la souffrance et les disparitions déforment les corps, blessent et brisent les hommes mais nous restons, tels les arbres écorchés de Plaies d’arbres, rattachés à un sol originel, éternel, il est ce qui nous retient et qui demeure, malgré les métamorphoses humaines.
Du burin à la plume. La gravure et l’écriture de Cécile Reims se croisent et se complètent. De courts poèmes accompagnent les gravures, ils les légendent et sont une voix, ou deux, la sienne et celle de Fred Deux. Dans Calligraphies végétales (2010), la complémentarité du dessin et de l’écrit est portée par le titre : la gravure, pour Reims, n’est qu’une autre façon d’écrire. Sur ces quatre gravures, qui sont celles se rapprochant le plus de la photographie, un paysage d’automne triste, des arbres, une rivière, quelques branches mettent en présence la fragilité et la permanence de toute vie, paradoxe qui résonne dans la voix humaine du graveur.
A présent,
Mes pas ne me portent plus que jusqu’aux remparts.
Ce qui était près est devenu trop loin
Je m’accoude à la rambarde
(…)
Je sais que la rivière coule …
Que tout continue
Et continuera
Sans moi
Ce sont de petits indices qu’on lit, qui laissent charmé, émerveillé ou ému ; ils nous aident à poursuivre le chemin vers elle, et peut-être un peu vers nous.
L’œuvre de Reims nous offre la possibilité de repenser à ce que « recueillement » signifie profondément, s’emparer des voix extérieures et intérieures, les comprendre, les faire sienne et enfin mieux se saisir.
Maëva Journo