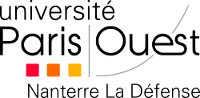A la recherche du temps perdu
 Le premier roman de l’israélienne Hanna Gonen, L’absente, sur la recherche d’une mère trop tôt disparue, nous convie à un voyage nécessaire, douloureux, cruel, et finalement apaisant.
Le premier roman de l’israélienne Hanna Gonen, L’absente, sur la recherche d’une mère trop tôt disparue, nous convie à un voyage nécessaire, douloureux, cruel, et finalement apaisant.Un jour d’hiver semblable à mille autres. Dans les allées étroites, solitaires, humides d’un cimetière parisien, Marie déambule « mécaniquement » et « pour la trentième fois » en trente ans. Tel un rituel, elle accomplit le même parcours qui la mène vers la même pierre tombale. D’elle, on ne sait encore rien, sauf qu’elle « porte le deuil depuis trente ans ». La fixité, l’emprisonnement et la volonté de tout garder, de tout retenir, même la douleur, marquent le début assez austère du premier roman d’Hanna Gonen, jeune écrivaine israélienne, influencée sans doute par Amos Oz. Si elle dit lui devoir beaucoup, si, comme lui, elle a perdu sa mère très jeune et a quitté Paris pour vivre dans un pays qui la « réchauffait », elle s’en différencie pourtant par un travail sur l’écriture et sur le personnage aussi intéressant que troublant.
À trente-neuf ans, Marie rompt ce rituel et, inversant l’itinéraire emprunté par l’absente, sa mère, des années auparavant, part. Le livre suit alors une autre voie et c’est au voyage en Israël où sa mère passa ses jeunes années que le lecteur assiste, émerveillé, ému, charmé. Hanna Gonen joue habilement avec les genres, mêlant au portrait d’une femme et d’un pays, le récit d’une enquête menée avec minutie et la forme des « mémoires ». Le lecteur ne sait pas les raisons pour lesquelles l’absente, un jour, l’a été. Marie en sait davantage, mais il y a des manques. Elle connaît mal cette femme qu’elle allait « voir » si souvent et, qu’autrefois, elle aimait tant. Pour Marie, comme pour le lecteur, ce mystère doit impérieusement être résolu. Hanna Gonen, entre autres qualités, réussit à créer cette envie, et même ce besoin, de savoir.
La construction de cet ample roman est musicale, thèmes et personnages s’entremêlent par une opération de la mémoire qui n’est pas sans rappeler Marcel Proust. C’est par bribes, au fil des personnages rencontrés, des lieux découverts, des paysages explorés, que nous apprendrons qui fut la mère de Marie et les raisons pour lesquelles, peut-être, elle est morte. Hanna Gonen n’hésite pas à casser la chronologie, à l’émailler de souvenirs intimes comme une manière de reconstruire une mémoire empêchée. Déroulant un fil d’Ariane, elle se trouve confrontée à des évènements étrangers, d’où un travail de reconstruction et d’imagination afin que les vivants répondent aux morts, les présents à l’absente. Parmi ceux-ci, quelques pépites admirables qui en disent autant sur la mère que sur une terre aimée, qui sont autant de traces que de petites douceurs délicieusement curieuses et infiniment réconfortantes – la rencontre avec un vieil homme retranché dans un kibboutz, un ancien amant rabbin passionné d’art contemporain, la gardienne d’un immeuble délabré du vieux Tel-Aviv qui n’a jamais « passé le mur de Berlin », mis les pieds dans une ville moderne qui n’est pas la sienne. Des scènes superbes se succèdent ainsi, telle l’entrevue avec la danseuse de salsa, la meilleure amie de sa mère, grâce à laquelle nous comprenons, avec Marie, pourquoi elle avait tant besoin de connaître, de pardonner et de répondre à ce paradoxe insupportable : « Toutes les mères aiment leurs enfants. C’est une loi de la nature. La sienne, une femme pourtant douce et sensible, avait mis la plus grande distance possible entre elle et sa fille. » Car la prouesse de ce premier roman est d’adopter, sans jamais perdre le lecteur, un point de vue tantôt extérieur et lointain, tantôt proche de son personnage et presque fusionnel. « Son cœur avait mis du temps pour accueillir la souffrance de sa mère, sa solitude, l’asphyxie qui l’empêchait de respirer, le cri de désespoir qu’elle poussait. Pendant longtemps elle vécut son propre drame, pas le sien. Si sa mère l’avait quitté de cette façon, sans un regard en arrière, c’était la preuve qu’elle ne l’avait jamais aimée. Quand on aime, on pardonne tout, sauf la trahison, c’est elle qui le lui avait appris. » L’émotion affleure dans ces moments de grâce où l’écriture, mouvante et fragile, touche et trouble, lorsque les douleurs de la narratrice et de l’auteur rejoignent celles de Marie. Plus elle s’en va, enquête, raconte, plus la langue s’affirme comme personnelle – Marie devient celle qui écrit, qui parvient à dire, à parler.
Beau roman d’apprentissage sur le deuil, L’absente décrit aussi un pays, s’attache aux détails et porte un regard (enfin) neuf sur Israël, ses rues, ses places, ses bords de mer, ses écoles, ses endroits où l’on vit. Elle est (aussi) une terre où l’on grandit, s’amuse et se passionne. Sans faire fi des conflits et des contradictions qui la traversent, mais sans prendre parti – ce n’est pas son but – Hanna Gonen dépeint à la perfection l’attachement aux lieux, leurs liens avec les êtres, la façon dont nous les aimons. Roman tendre et cruel sur le pardon, L’absente porte une méditation sur l’abandon. Comment accepter que les gens que nous aimons nous laissent ?, et surtout, comment, nous-même, accepter de les laisser ? en parvenant à se dire, sans colère, qu’on « n’aura pas su (leur) suffire » ?
Maëva Journo
L’absente, de Hanna Gonen, traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen, éd. Gallimard, 2010, 142 pages, 18 €