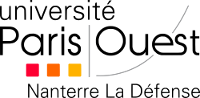janv.
16
Soumis par valentine.camus le mer, 01/16/2013 - 11:52
« Etait-ce d’un chien le cri
Ou le cri de mon corps ?
Il manque deux heures encore
Pour que Midi
Assassine le vieux rêve :
Le paysage est un refus dans sa sécheresse.
Le silence persiste. Et la mort témoigne -
Ou bien était-ce un coup de bêche
Dans l’approche du lointain ? »
Jean-Claude IZZO
Loin de tous rivages
A l’entrée du village, l’homme s’arrêta devant la première maison, cogna à la porte puis frappa à nouveau. Après un silence, il murmura :
— Mère, ouvre-moi !
Une vieille femme apparut sur le seuil. Elle recula d’un pas et l’homme entra dans le logis. L’un et l’autre se retrouvèrent dans la pièce principale faiblement éclairée par la lueur d’une lampe à huile. On voyait là un buffet où était rangée la vaisselle, une table, des chaises et un lit disposé contre un mur. S’étant éclipsée dans la pièce d’à côté qui servait de cuisine, la vieille femme revint les mains chargées d’un plateau sur lequel une assiette de soupe et un morceau de pain étaient posés. L’homme n’avait pas osé un mot de plus. Elle finit par briser le silence :
— C’est pour toi, mon fils, mange !
Sans se faire prier davantage, l’homme s’exécuta. Un bout de pain dans une main et dans l’autre la cuillère, il entama son repas. La vieille détourna la tête, le laissant avaler le bouillon. Tandis qu’il finissait, elle déroula une couverture sur le lit. L’homme attendait qu’elle le resservît. Elle lui avait donné le peu qu’il lui restait. Lui n’avait rien mangé depuis trois jours. C’était le temps qu’il lui avait fallu pour marcher jusqu’au village. Il n’avait quasiment pas dormi. Il avait traversé le fleuve à la nage. Un tronc d’arbre à la dérive, auquel il s’était agrippé de toutes ses forces, l’avait entraîné vers la rive. Il était sain et sauf, mais épuisé d’avoir lutté contre le courant. Ayant perdu ses chaussures, il s’était retrouvé pieds nus et n’avait plus que ses vêtements humides, maculés de boue et de vase.
La vieille s’absenta pendant qu’il ôtait sa chemise. Quand elle réapparut, elle la prit et lui en tendit une autre, en déclarant :
— Prends celle-là, mon fils, elle est à ta taille !
La vieille femme détourna le regard et l’homme se leva pour enfiler le vêtement propre. Elle reprit d’une voix lente :
— Mon fils, je ne peux pas te garder ici, dans cette maison.
Il acheva silencieusement de revêtir son nouvel habit. La vieille femme ramassa les restes du repas. Ici, dans cette maison, les militaires étaient venus plus d’une fois. Ils ordonnaient de préparer le meilleur des mets. A l’aube, ils repartaient mais ce n’était jamais sans menace. La prochaine fois, ils ne tolèreraient pas qu’on leur servît ce consommé sans aucune saveur. Il y manquait le goût de la viande. Il faudrait répondre à leurs exigences, sinon la vieille pourrait s’attendre au pire. Puis, ils abandonnaient les lieux au désordre qu’ils y avaient répandu et en guise d’au revoir, les coups de feu retentissaient dans le calme matinal. C’était à peine si à cette heure le coq chantait.
— Ils sauront que tu es au village, dit-elle, et ils viendront.
— Mère, laisse-moi dormir, au moins quelques heures !
— Repose-toi sur ce lit, mon fils, mais ne me demande rien d’autre !
On venait de frapper trois coups. La vieille se leva et écartant le rideau, jeta un œil par la fenêtre. Dehors, la lune luisait au-dessus du village, répandant un halo pâle et diffus. La blancheur floconneuse de l’astre lunaire s’unissait à l’obscurité. Personne dehors, se dit-elle. Les coups recommencèrent à quelques secondes d’intervalle. Elle quitta aussitôt la fenêtre pour se diriger vers la cuisine d’où le bruit venait. En passant devant le lit où l’homme était couché, elle remarqua qu’il s’était enfoui sous la couverture. Il pouvait bien dormir tranquillement et reprendre des forces. C’était la pleine lune. Mieux valait ne pas sortir ni risquer de traverser le village. Le danger, qui surgissait à tout moment désormais, s’était propagé avec les militaires depuis qu’ils avaient reconquis la région. Les habitants des masures perchées sur les hauteurs et ceux des hameaux de la plaine étaient partis. A présent, les soldats sillonnaient les routes et tout au long de la journée, les hélicoptères allaient et venaient à basse altitude. On les entendait tourbillonner, puis reprendre de la vitesse dans un bruit assourdissant et s’éloigner ensuite dans le ciel.
Les trois coups retentirent encore. On tapait au carreau. La vieille pressa le pas et tandis qu’elle ouvrait la porte prestement, une enfant d’une douzaine d’années surgit des ténèbres. La fillette portait un sac qu’elle posa à terre aussitôt qu’elle eut pénétré à l’intérieur. La vieille lui fit signe de ne faire aucun bruit, s’empara du sac et entreprit d’en vérifier le contenu : des provisions, du linge sale. Elle s’absenta et revint rapidement avec un balluchon qu’elle confia à la gamine.
— Prends cela, chuchota-t-elle, le reste sera prêt pour le mois prochain. Le linge sera lavé. Dis-leur aussi, ma fille, et que Dieu te garde, l’agneau a besoin de sa mère.
Sans plus tarder, la messagère disparut. Au même instant, réveillé par le bruit, l’homme se présenta sur le seuil de la cuisine.
— Je t’ai entendue parler, fit-il, inquiet.
— Mon fils, je t’expliquerai. Tu peux aller te recoucher !
— Mère, insista-t-il, qui était-ce ?
— Ecoute, mon fils, écoute-moi. Celui que tout le monde appelle La Colombe a été pris, mais un de ses neveux lui a succédé. Ils vont envoyer quelqu’un et vous ferez le chemin ensemble. La suite, on te l’expliquera en route.
Il eut subitement une telle migraine qu’il n’entendit plus rien. De sa vie, il n’avait tenu une arme. A présent, il le faudrait. Il irait au milieu de ces partisans qui luttaient depuis des mois, se retirant d’un endroit à l’autre, sans savoir de quoi le lendemain serait fait. La seule certitude était la menace du danger, les embuscades qui se préparaient dans le secret, les nuits à bivouaquer à la belle étoile et par tous les temps. Il serait propulsé dans les combats et les fusillades, qui se soldaient par de nombreux morts. Du jour au lendemain, l’un était fauché par une balle, l’autre succombait à ses blessures. Quels soins aurait-on prodigués ? Il n’était question chaque jour que de survivre.
— Mère, reprit-il, je n’ai plus sommeil. C’est moi qui veillerai à ta place.
Elle ne voulut rien savoir. Il insista tant et si bien qu’elle finit par obtempérer. Une fois que la vieille eut quitté la cuisine, il commença à réfléchir. La nuit lui inspirait les pires craintes. De plus, il ne s’imaginait pas dans le maquis. Ce n’était pas son histoire. Se battre, ce n’était pas de son ressort. Ce qu’il voulait, c’était passer la frontière. C’était là son but. Le moment était venu de reprendre la route. Il laisserait la vieille, et il l’allègerait du fardeau qu’il deviendrait pour elle, oui, le mieux était de partir, et au plus vite. La vieille continuerait ses affaires, et lui, son chemin. C’était la guerre, il le savait bien, et pire que la guerre, l’enfer où les hommes basculent en cascade, sans espoir d’une trêve qui enraye le chaos et les destructions : les meurtres, les viols, les villes et les campagnes passées au peigne fin par les militaires, puis livrées aux razzias des maquisards, quand ce n’étaient pas les incursions des mercenaires qui terrorisaient femmes et enfants. La guerre et pire, les tueries organisées pour ne pas dire, réglées comme du papier à musique.Ce qu’il avait décidé, c’était de fuir la guerre comme on fuit la peste. Et fuir la guerre voulait dire s’en détourner comme d’un fléau réitéré inlassablement. La guerre n’était rien d’autre que cette malédiction biblique de l’humanité à laquelle il fallait chercher à échapper. La vieille, il ne l’abandonnait pas. Elle n’avait pas besoin de lui. Qu’il tente encore sa chance, comme il l’avait toujours fait. Il trouverait bien le moyen de quitter la région, et une fois de l’autre côté, une fois passée la zone de transit, il gagnerait facilement l’International Free Nation, et il se répétait à lui-même ces trois lettres, I.F.N. Il n’avait eu aucun mal à s’enfuir du camp d’internement, en pleine nuit. Personne n’avait remarqué son absence. Aucune patrouille n’était partie à sa recherche. Il était parvenu jusqu’au Grand Pont, mais les soldats montaient la garde. Des projecteurs balayaient constamment les rives et les éclairaient comme en plein jour. De temps à autre, des coups de feu éclataient. Il suivit le bord du fleuve puis se cacha dans les fourrés. Plus tard, il aperçut une barque retournée sur la rive. Après l’avoir mise à l’eau, il comprit qu’il n’atteindrait pas l’autre côté. L’embarcation prenait l’eau. Il se résolut à plonger mais il était vain d’espérer nager. Ses vêtements l’alourdissaient et le courant l’emportait à toute vitesse, tandis qu’il s’essoufflait et que le froid l’engourdissait. Il tendit le bras au passage d’un tronc d’arbre flottant à la dérive, s’accrochant au morceau de bois qui aurait pu l’assommer s’il n’y avait pris garde.
Il venait d’entendre un bruit de moteur. Ce n’était plus le moment d’hésiter. Il ne fallait pas rester chez la vieille. Il allait tenter une sortie. En quelques secondes, il se retrouva dans la rue déserte et devina à une vingtaine de mètres devant lui un camion à l’arrêt. Sans plus réfléchir, il courut d’une traite jusqu’au véhicule. Le conducteur n’avait pas coupé le contact. Le moteur continuait à tourner. L’homme réussit à escalader l’arrière du camion et avant qu’il ne redémarrât, d’un bond il fut à l’intérieur. Ballotté comme un sac, il finit par se caler contre une caisse en bois. La bâche relevée laissait voir la route qui défilait. La lune resplendissait au milieu du ciel. C’était bon signe, on allait en direction de la frontière. Il sauterait à terre dès que le chauffeur ralentirait son allure.
Désormais, pensa-t-il, il serait un errant. Arrivant du sud ou du nord, des hommes et des femmes venaient grossir le flot continuel des populations en déshérence et sous la garde de soldats qui les surveillaient, ils se retrouvaient alors dans des baraquements de fortune. Puis, l’armée les rassemblait par dizaines avant de les faire monter dans des fourgons. Qu’auraient-ils eu à dire ? On les transportait en toute sécurité en direction du Grand Camp de Regroupement, d’où ils pourraient repartir vers la destination de leur choix. On ne pouvait espérer mieux. Femmes, enfants, vieillards, sœurs, tantes, maris, oncles, frères et cousins, les uns et les autres quêtaient la moindre nouvelle d’un proche. On évoquait les plus chanceux, ceux qui avaient rejoint la frontière. Ceux-là, on ne les avait plus revus. D’autres, prétendait-on, avaient disparu, mais on ne savait s’ils étaient parvenus de l’autre côté.
Il repensa au moment où il avait découvert les baraques alignées les unes derrière les autres, ne laissant rien présager d’autre qu’un peu plus de misère et de désolation. Puis, il se rappela le froid cinglant du petit matin où il avait vu les militaires arriver devant la maison que son frère, la femme de celui-ci et leurs enfants occupaient. On les avait fait sortir sur le pas de la porte. On mit le feu à l’habitation. Son frère et sa famille furent ensuite emmenés par les soldats. Qu’aurait-il pu faire contre la troupe armée ? Il avait échappé aux flammes en se réfugiant dans la grange. Peu après, il parvint à se cacher dans un fossé à quelques mètres de là. Tout le jour, il entendit des hélicoptères aller et venir. A la nuit tombée, il sortit de sa cachette, et tournant le dos à ce qui n’était plus qu’un tas de cendres, il s’éloigna et disparut dans l’obscurité.
Dès son arrivée au camp de transit, il les chercha et se rendit à l’évidence : ce n’était pas ici qu’il les retrouverait. Il fallait quitter l’endroit à tout prix. On lui parla des tours de garde. Celui qui tentait de s’évader n’avait d’autre choix que de saisir l’opportunité de ces quelques minutes durant lesquelles se faisait la relève. C’était le bon moment pour se faufiler rapidement entre les baraques. Sans se faire remarquer de quiconque, on pouvait se glisser sous les barbelés. Ensuite, la chance vous accompagnait.
Il venait de relever la tête quand il aperçut à nouveau la lune dans le ciel nocturne. Elle avait l’air de l’observer. Quelle sorte de présage cela annonçait-il ? Depuis des jours, il n’avait connu qu’une succession d’étapes. Où le mènerait ce périple ? Il ne tarda pas à cligner des yeux. Une somnolence contre laquelle il ne pouvait plus lutter le gagna tout entier. Puis, ce fut un rêve où il se revit enfant, en compagnie de son frère. Tous deux passaient de longues heures à pêcher au bord du fleuve. Des femmes se rendaient parfois sur la berge. Les unes allaient et venaient, déposant leurs corbeilles remplies de linge, les autres s’occupaient de le laver à grand bruit. Tout en s’affairant à leur lessive, elles s’apostrophaient et se lançaient des mots qui, rebondissant comme des balles, revenaient jusqu’aux oreilles des deux garçons. Lassés de leur occupation trop calme, ils couraient alors rejoindre le groupe des femmes et rentraient avec elles au village. Les deux frères les aidaient à porter leurs paniers de linge et se chargeaient aussi de fagots de bois. En guise de récompense, on leur donnait une assiette de gâteaux, qu’ils ramenaient fièrement à leur mère.
A l’avant-bras gauche, il ressentit une vive douleur. Il s’était blessé en passant sous les barbelés. La plaie ne saignait plus. Mais son mal se rappelait à lui. Le camion continuait à rouler. Que le chauffeur ralentît son allure ou même qu’il s’arrêtât, il sauterait dans le fossé. L’occasion se présenterait avant le lever du jour.
*
Dès qu’il l’avait aperçu, le berger s’était dirigé vers lui en se hâtant. Le chien, qui s’était mis à aboyer, l’avait devancé. L’homme gisait sur le bord de la route. Le chien tournait autour de lui en glapissant. Puis le berger arriva. Il se pencha sur le corps. L’homme était vivant, le cœur battait. Il le souleva et parvint à le prendre sur son dos. Il le ramena à la bergerie et l’installa sur un matelas posé à même le sol. Il ralluma le feu dans la cheminée, fit chauffer de l’eau et prépara du café. L’homme avait repris conscience. Ils n’échangèrent aucune parole. Le feu crépitait dans l’âtre.
L’homme finit par demander :
— Tu es de la montagne ? Moi, je viens de la petite vallée.
L’autre répondit alors :
— Je suis le gardien du troupeau.
— Les bêtes sont à toi ?
— Oui. J’en vends une partie chaque automne.
Après un silence, le berger reprit :
— Tu as été blessé ?
L’homme acquiesça. Le berger disparut un instant avant de revenir avec un morceau de tissu blanc. Sans hésiter, il entreprit de lui faire un pansement. Ses gestes étaient sûrs et habiles. Il raconta alors comment il l’avait découvert sur le bord de la route. Il l’avait porté sur son dos. Comme il pesait lourd ! C’était la pleine lune. Les bêtes étaient agitées. Des nuits comme celle-là, il ne pouvait pas dormir. Devenu loquace, le berger lui fit part de la véritable raison pour laquelle il était demeuré éveillé. Il guettait le passage du camion.
— De quel camion parles-tu ? s’inquiéta l’homme.
— Celui du ravitaillement !
L’homme n’eut plus de doute. Il se trouvait en plein maquis. Contrairement à ce qu’il s’était imaginé, il était encore loin de la frontière qu’il escomptait atteindre. Comment pouvait-il en être autrement ? Cette nuit lui parut plus longue que jamais. Quelle folie, pensa-t-il.
Le berger lui demanda :
— Tu sais conduire ?
Puis il ajouta :
— Cette nuit, il nous faut un chauffeur.
Il marqua une pause avant de reprendre :
— Tu prendras la route qui mène au col et tu descendras ensuite vers la grande vallée. De l’autre côté, quelqu’un t’attendra. Tu lui passeras le relais. Tu auras un uniforme de soldat et un laissez-passer. Le camion, les maquisards l’ont récupéré lors d’une attaque contre l’armée. Il est en parfait état de marche. Tu seras vite arrivé au poste de contrôle.
La route du col, il l’avait prise de nombreuses fois avant la guerre. Son frère et lui l’empruntaient pour gagner la grande vallée, à présent territoire passé sous le contrôle de l’I.F.N. La route basse, il la connaissait bien également. C’était la longue route qui contournait la montagne.
A présent, seul sur la route, il attendait le véhicule qui ne tarderait plus à arriver. Il l’aperçut et le vit s’arrêter à sa hauteur. Le chauffeur descendit immédiatement et lui céda sa place. Il lui remit la sacoche en cuir contenant le laissez-passer. C’est à peine si les deux hommes se saluèrent. Il fallait faire vite. Désormais, c’était à lui de prendre le volant. La réussite de l’opération lui incombait. Il fit redémarrer le véhicule, appuya sur l’accélérateur et rapidement, le camion prit de la vitesse. La route s’élargissait. L’idée de faire demi-tour s’imposa à lui. Il redescendrait au village. La nuit n’était pas finie. Il scruta un instant le ciel. La lune avait disparu derrière un voile nuageux. N’allait-elle pas réapparaître plus lumineuse qu’il ne l’avait vue durant toutes ces heures ? N’allait-elle pas continuer à luire ? L’obscurité s’éclaircirait. Il la traverserait et reprendrait espoir.
Maintenant l’homme roulait en direction de la vallée. Il revenait sur ses pas. Il retournait vers ce qu’il avait fui à la hâte. Il pensait à la vieille avec inquiétude. Que dirait-elle ?
*
— Que fais-tu là ?
— Mère, suis-moi. Je viens te chercher. Nous partons. Dépêche-toi !
— Où veux-tu que je te suive, mon fils ? Il fait encore nuit. Où veux-tu que j’aille ? C’est ici ma maison.
— Je suis revenu te chercher.
— Je suis trop vieille et trop fatiguée. Je ne peux pas partir avec toi.
— Mère, écoute-moi !
— Mon fils, c’est ainsi. Laisse-moi ici.
— Mère, je t’emmène !
— Non, mon fils, je ne viendrai pas avec toi. Pars, je t’en prie !
Il n’écouta plus un mot de ce qu’elle lui disait. Dans un même élan, il s’approcha d’elle, la prit dans ses bras et la porta jusqu’au camion. Il l’installa à l’arrière et la recouvrit d’une couverture. Puis il se dépêcha de reprendre le volant, actionna la clé de contact et mit en route le moteur. Ils quittèrent le village.
Il reprit la route en direction du col et s’arrêta en chemin. Il fallait confier la vieille femme au berger. Une fois que ce fut fait, il se sentit libéré d’un poids. Il était prêt à repartir. Il allait rattraper son retard. Le ciel s’était dégagé. Il vit à nouveau surgir la lune qui surplombait la route.
Il devait atteindre le poste frontière avant l’aube. Il n’y parvint jamais. Au lever du jour, il stoppa le véhicule. Il s’empara de la sacoche sous le siège et poussa le camion vers le bord de la route jusqu’à le faire basculer dans le ravin où il s’écrasa et prit feu. Il ne s’attarda pas. Il traversa la route et emprunta le sentier qui s’offrait devant lui. Peu après, il entama la descente vers la vallée. Il ne manquait pas de courage mais il n’aurait eu aucune chance de passer sans encombre le poste frontière. On l’aurait arrêté. On l’aurait questionné. On aurait découvert les faux papiers. Qui sait si on ne l’aurait pas abattu sur-le-champ ? Du moins, on l’aurait emprisonné. Ensuite, les interrogatoires se seraient succédé. On l’aurait torturé.
Il fit une halte au bord d’un ruisseau. Il s’approcha de l’endroit où il escomptait se reposer. Alors qu’il s’apprêtait à recueillir un peu d’eau dans le creux de sa main, il trébucha contre une pierre et tomba. Il demeura un long temps sans bouger. Puis, il réunit ce qu’il lui restait de force. Il se releva.
La lune apparaissait encore dans le ciel matinal. C’était un disque blanc et translucide. La mort l’avait approché durant toute la nuit, mais il avait triomphé d’elle. Elle pouvait bien encore le narguer. Il était debout. Il marchait. Il avançait dans la clarté du jour. La nature s’éveillait comme chaque matin. Sur les feuilles d’arbre, il voyait la rosée perler. D’autres jours viendraient encore. D’autres levers de soleil se dévoileraient dans l’immensité du ciel. Ses paupières clignaient et la lumière du jour naissant lui caressait le visage.
Le chemin déboucha sur un pré qu’il traversa, puis il arriva sur une piste caillouteuse. Il avait en tête de parvenir jusqu’à la première ferme qui se présenterait et d’y trouver refuge. De loin, il aperçut une maison. Aussitôt, il entendit le bruit d’un moteur. Ce devait être un tracteur. Il ne voulait pas qu’on le vît. S’il atteignait la ferme, il ne se hasarderait pas à demander l’hospitalité. Il fallait parvenir à se cacher le temps de reprendre des forces. Il se dissimula derrière un arbre. Le silence revint.
Alors qu’il s’approchait de la ferme, un chien se mit à aboyer. Il renonça à s’y arrêter et passa son chemin. Les aboiements cessèrent. L’homme continua à marcher. Il était à bout de force. Mais il avançait coûte que coûte. Il cheminait sur la grande route. Tenir, se disait-il, jusqu’à la prochaine borne kilométrique. Il titubait comme un homme ivre. Il était l’errant, le vagabond. Ses pas soulevaient la poussière. Le soleil était haut dans le ciel. Et lui allait son chemin.
Marcher l’aiderait, pensa-t-il, à oublier la faim et la soif. Marcher droit devant lui l’obligerait à ne pas prêter attention à la douleur de la blessure qui se ravivait. Il suffisait de mettre un pied devant l’autre et de ne plus penser à rien. Surtout, il ne fallait pas se décourager, ni se laisser affecter par aucun regret. Mais il ne put s’empêcher de repenser à la peur qui s’était emparée de lui aux abords de la ferme. Etait-ce à cause de la fatigue qu’il s’était laissé impressionner par les aboiements ? Peut-être avait-il eu tort de ne pas y aller ? On l’aurait reçu simplement. Pourquoi aurait-on refusé de lui ouvrir la porte ? On l’aurait fait entrer et sans poser aucune question, on l’aurait invité à s’asseoir. Personne n’aurait rien demandé. Personne n’aurait rien trouvé à redire à ce qu’un homme demande secours. On ne pouvait refuser de lui venir en aide, ne serait-ce que pour lui donner un morceau de pain. On ne se serait pas inquiété de connaître son identité. On lui aurait prêté assistance sans rien exiger en retour. Aurait-il su expliquer qu’il errait depuis des jours, qu’il n’avait plus ni toit ni famille ? Aurait-il su dire qu’il était obnubilé par la peur ? Il avait été forcé à s’enfuir à cause du danger et de la guerre. Il était seul, perdu. Il n’était plus qu’un mendiant. Un homme en haillons, frappé par le malheur, un homme sans nom et sans voix. Aurait-il pu articuler un mot ? Aurait-il pu raconter ce qu’il lui était arrivé ? Serait-il resté mutique ? L’air hagard, il se serait assis à la place qu’on lui aurait désignée d’un geste. Il n’aurait pas dit un mot. On lui aurait servi quelque chose à manger. On lui aurait apporté à boire. On lui aurait offert ensuite un verre d’un alcool qui l’aurait revigoré. Il se serait détendu. Dans le corps de ferme jouxtant le bâtiment principal, il aurait passé la nuit entre les bottes de foin. Il aurait trouvé le sommeil et se serait apaisé. La faim, la soif et la peur se seraient dissipées.
Il marchait sous le soleil. Ses pensées l’assaillaient et troublaient son esprit. L’épuisement le gagnait. Un engourdissement envahissait son corps. Il eut l’intuition qu’il ne résisterait plus très longtemps. Bientôt, il s’écroulerait sur le sol. Ses jambes ne le porteraient plus. Il tenta de concentrer sa pensée sur chacun de ses pas. Il ralentit sa marche.
Les aboiements du chien le hantaient. Qui sait si l’animal ne ressurgirait pas tout à coup ? S’il devait courir à ce moment-là, il en serait incapable. Céder à la fatigue était pire que d’être poursuivi par ce chien qui errait peut-être comme lui. L’idée même d’en avoir peur finit par lui sembler ridicule. Il se mit à rire et n’en fut pas surpris. C’était un fou rire qui fusait sans qu’il parvînt à le réprimer. La vie s’obstinait. Cette persistance lui parut grotesque. Il aurait aussi bien pu s’asseoir sur le bord de la route et qu’au rire les larmes viennent se mêler.
Sa vie n’était plus qu’un champ de ruines. La mort était présente. Elle allait et venait à sa guise. Elle surgissait à la tombée de la nuit. Quelquefois elle faisait irruption au petit matin. Elle s’insinuait dans chaque parcelle de l’air. On pouvait la sentir approcher. Elle laissait des traces de son passage et ne manquait pas non plus de se manifester par les signes annonciateurs. N’était-elle pas celle qu’on craignait et qu’on voulait amadouer par toutes sortes de gestes et de superstitions ? Mais les vivants ne parvenaient pas toujours à la conjurer. Elle se présentait et on ne pouvait plus l’ignorer. Elle était à vos côtés. Elle vous effleurait. Elle reculait parfois, et par ruse, faisait croire à une trêve, et par ruse encore, se dissimulait dans le plus petit recoin, comme une brindille dans l’herbe. Elle se découvrait dans les regards apeurés, l’inquiétude des hommes et des femmes. Elle leur déchirait le cœur. Elle laissait les enfants orphelins. Elle perçait dans leurs cris. Elle menait la danse. C’était bien par sa cadence folle que lui et les siens avait été entraînés tout comme tant d’autres. A présent il était terrassé.
Il s’était assis sur le bord de la route. Il luttait pour ne pas laisser faiblir sa vigilance. Il redoutait de s’effondrer. La peur dévorait ses dernières forces. Il s’abandonnait au pire et renonçait au combat. Fuyait-il une fois de plus ?
Il se ressaisit tout à coup. Un très bref instant, un regain de vigueur le gagna, mais à nouveau la lassitude le submergea. Il n’avait plus la force ni de se relever, ni de se mouvoir. Il pouvait bien rester là quelques secondes. Le temps ne comptait plus. Il était parvenu jusqu’ici et n’avait aucune raison d’aller plus loin.
Il l’attendrait. Il garderait les yeux ouverts, fixant l’air translucide de cette journée ensoleillée. Il tiendrait le temps qu’il faudrait. Ce serait là le combat à mener.
Il verrait les étourneaux s’envoler au-dessus du champ récemment moissonné. Il apercevrait le ballet des oiseaux qui allaient et venaient. Il suivrait encore du regard le nuage formé de petits points noirs fuyant dans le ciel. Il resterait attentif aux stridences de leurs pépiements. Puis, ce serait son dernier souffle.
Il trouva appui contre un arbre près duquel il s’écroula. Qu’il ne pût plus tenir les yeux grands ouverts, dieu le lui pardonnerait, il le savait. Cela le réconforta. Il ferma les paupières. Il perçut le bruit d’un véhicule. Une brise agita le feuillage. Des oisillons nichés sur l’une des branches firent entendre leurs petits cris.
*
Le tracteur roulait lentement. Un chien suivait derrière. Il aboyait de temps à autre. Il dépassait parfois le véhicule en courant. On le voyait revenir sur ses pas, et aboyant de nouveau, il repartait fureter. Le conducteur s’arrêta à hauteur de l’arbre où l’homme était étendu. Il se saisit du corps du mieux qu’il put et le hissa sur la plateforme de sa remorque. Il s’essuya le front du revers de la manche, sortit de sa poche un paquet de cigarettes et en alluma une. Transporter un mort, cela ne l’effrayait pas. Ce miséreux, on ne pouvait le laisser pourrir sous le soleil. Ce pauvre hère, on le mettrait en terre. Avant la fin du jour, on creuserait une fosse. Le conducteur écrasa son mégot sous sa botte. Il était temps de se remettre en route. Il fallait rentrer à la ferme. Il siffla et le chien accourut. L’animal sauta à l’arrière du tracteur et sans plus bouger, resta près du corps.
Les oiseaux sillonnaient le ciel, passaient au-dessus de la ferme. Peu à peu, ils se raréfièrent et disparurent au loin. Le silence s’installa. La cour de la ferme était déserte. Le jour déclinait. Le corps de l’homme sans vie était posé à même le sol. Un drap le recouvrait de la tête aux pieds. La nuit allait bientôt tomber.
Emmanuelle Rodrigues