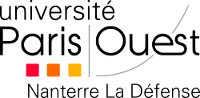Modernes solitudes

En passant de la table de mixage à celle de l’écrivain, Zoé Perrin signe avec Anamorphoses un premier roman à la fois percutant et sensible, où la musique est là pour nous faire prendre la mesure des mots.
Plus connue dans le milieu de la musique électronique où elle a su s’imposer par un son à la fois sensuel et rugueux, cette jeune artiste de trente-cinq ans fait ici la démonstration qu’elle a plus d’une corde à son arc. Nous l’avons rencontrée dans son appartement parisien pour comprendre les ressorts de cette étonnante trajectoire qu’elle décrit moins comme un changement de cap, que comme une « parenthèse à durée indéterminée » dans un parcours dont les multiples influences rendent l’inspiration difficile à décrypter. À commencer par le titre de cette étonnante curiosité littéraire.
L’histoire d’Anamorphoses débute dans les coulisses du Palais Omnisport de Bercy, à la fin du mois de juin de l’année 1989, où a lieu l’un des tout derniers concerts parisiens de Pink Floyd. C’est le hasard qui va provoquer les retrouvailles entre deux anciennes copines de fac, jadis inséparables, mais dont les trajectoires ne se seraient probablement jamais rejointes sans ce « minuscule grain de sable qui a le pouvoir de faire imploser nos vies, mais qui a aussi celui de nous révéler des ressources qu’on ne soupçonnait pas, en nous entraînant sur des chemins inconnus ». L’une vient de faire un malaise qui lui révèlera la grossesse dont elle refoulait l’existence, et la forcera à réorganiser sa vie de manière radicale. L’autre est l’infirmière de garde venue effectuer le remplacement d’une collègue dont elle apprendra le suicide le lendemain matin. Simple anecdote ou manière détournée de nous faire prendre conscience de la « barbarie ordinaire induite par un rythme de vie moderne qui nous coupe intimement de l’autre » ? En marge de cette rencontre, elles vont renouer le fil de l’amitié qui liait autrefois ces deux sœurs siamoises, et se redécouvrir à travers le regard où chacune a gardé la mémoire de ce que l’autre fut, avant de se laisser faner par une vie dans laquelle aucune ne se sent à sa place : lorsqu’elles se sont connues, elles n’avaient que vingt ans.
Chacune rêvait d’une vie exaltante, à l’exact opposé de ce modèle de réussite bourgeois que Sophie s’était juré de ne pas reproduire, ou de celui auquel Élise a cru pouvoir échapper par des capacités intellectuelles qu’elle décrivait fièrement comme le seul patrimoine que ses parents lui aient jamais légué. Ironie d’une histoire qui se retourne contre ceux qui méprisent leurs origines, ou aimantation d’un milieu dont il est difficile de s’arracher, chacune a été rattrapée par une même fatalité : de petits boulots en petits boulots, Élise a dû renoncer à ses ambitions faute de pouvoir mener ses études sans avoir à se soucier du lendemain, et en se laissant peu à peu engloutir par cette « spirale prolétarienne qui tue jusqu’à l’énergie de penser ». Sophie a épousé un homme qu’elle a cessé d’aimer depuis longtemps, mais qui finance l’interminable thèse à laquelle elle s’efforce de s’intéresser, sans réussir à se départir du sentiment d’une profonde inutilité.
Ces retrouvailles vont pousser Sophie à partir à la recherche de Mona, l’amie avec laquelle elle vécut six mois d’une amitié intense lorsqu’elle débarqua de sa Bretagne natale pour s’installer à Paris, mais qu’elle a tardé à rappeler lorsque chacune a été confrontée à l’urgence de construire sa vie. Elle va donc mener l’enquête en retournant sur les pas de leur rencontre, Villa de l’Adour, dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, où elle perdit sa trace quinze ans plus tôt. C’est Élise qui lui apprendra son décès en lui remettant le mot, accompagné d’une photo, que Mona avait laissé sur la table de son salon avant de mettre fin à ses jours : « Je n’étais pas sûre de reconnaître son écriture, mais je compris à son regard qu’elle l’avait retrouvée avant moi. Il n’y avait pas d’adresse sur l’enveloppe, juste mon prénom. En ouvrant la lettre, je sus que celle qui me souriait sur la photo me scruterait éternellement en me posant la même question : où étais-tu ? Au dos, elle avait simplement griffonné ces mots : 12/12/1988, partie sans laisser d’adresse. » Avait-elle cherché à la retrouver avec la même ardeur qu’elle, ou avait-elle simplement fait du ménage dans ses papiers avant de se donner la mort ? Sophie cherchera la réponse dans son journal intime, et revivra à travers lui les tout derniers mois de sa vie : comment la brillante publiciste sombra peu dans une dépendance à la cocaïne et aux amphétamines avant de se faire licencier de son agence lorsqu’elle ne parvint plus à maintenir le rythme imposé. Ce sera le début d’une lente descente aux enfers compliquée par la maladie dont elle apprendra l’existence le jour où Sophie décidera de retrouver sa trace : « Adénorcarcinome, un mot aux accents poétiques mais qui vous glace le sang lorsque les médecins le prononcent ». Les voix de l’écrivaine et de son personnage s’entremêlent alors sous un seul et même « je », mais sans que cette confusion entre le réel et la fiction ne laisse le pathos s’installer. Car Mona, c’est aussi le prénom de l’amie dont Zoé Perrin n’apprit la disparition qu’au tout début de l’écriture du roman, dans des circonstances similaires. Aurait-elle pu atténuer le sentiment de culpabilité lié à l’annonce de son décès si elle avait su entretenir cette amitié ? Sans doute, mais plutôt que se flageller à voix haute, l’écrivaine préfère s’interroger sur l’étrangeté du hasard qui semble gouverner à notre insu ces concours de circonstances, mais qui est peut-être une manière inconsciente de communiquer : quelle coïncidence avait poussé Sophie et Mona à vouloir retrouver, au même moment, la trace de leur alter ego, alors qu’aucune n’en avait manifesté le désir durant toutes ces années ?
Anamorphoses nous raconte ainsi comment ces deux quêtes parallèles d’un même et unique moi se frôlent parfois, manquent de se recouper à plusieurs reprises, mais n’auront pas le temps d’aboutir malgré l’amour qui porte chacune d’elles. À la course effrénée de l’une contre l’issue qu’elle pressent, s’opposent la lenteur et la discontinuité de l’autre, entrecoupée par de probables séjours à l’hôpital. Est-ce pour faire émerger en nous l’idée que l’important réside essentiellement dans la beauté de la quête, le récit s’attache à semer en permanence des indices qui nous laissent présager du dénouement. Car l’intérêt du livre réside moins dans la question de son aboutissement, que dans la manière dont l’auteure cherche à nous faire prendre la mesure de la morale qui s’en dégage : un seul « Je » traverse le livre tout en réussissant à donner la parole à ses trois héroïnes, fût-ce au prix de contorsions parfois acrobatiques. Est-ce Mona qui consignait dans son journal le regret de n’être jamais parvenue à se stabiliser affectivement, ou est-ce Élise qui découvre en lisant ces mots toute l’ironie d’avoir réussi à acheter l’hacienda où elle rêve de s’installer, quelque part en Amérique latine, mais à qui il manque l’essentiel : quelqu’un avec qui elle pourra y vivre ? Est-ce Élise qui fait le constat qu’elle ne pourra jamais avoir d’enfants, ou est-ce Sophie qui réalise qu’elle l’a décidé sans le savoir lorsqu’on lui annonce que l’avortement s’est mal passé ? L’ambigüité entretenue par le récit cherche ainsi à nous faire éprouver l’idée que leurs vies respectives ne sont que trois formes différentes d’une seule et même solitude. L’alternance des portraits matérialise ainsi le cloisonnement de ces vécus singuliers mais sans que la trame narrative ne soit pour autant qu’un prétexte pour articuler un propos plus abstrait sur la solitude, le temps, ou encore l’illusion de pouvoir maîtriser le cours des choses. L’intrigue joue ainsi tout son rôle, car si chacune de ces « robinsonnes » réalise peu à peu qu’elle est prisonnière des murs qu’elle a elle-même érigés, elle vise avant tout à nous rappeler l’adage que Time nous susurre en substance à l’oreille : memento mori.
Par son assise autobiographique, Anamorphoses se situe ainsi au croisement de l’hommage et de la confession, mais sans que son inscription contextuelle n’altère l’enthousiasme profond qui se dégage du livre. Car s’il cherche à nous mettre en garde contre les dangers d’un repli sur soi, l’obsession de la mort ressort ici avant tout d’une angoisse constructive, décrite par l’auteure comme le moteur même de sa créativité. Conçu initialement comme le premier volet d’une trilogie, c’est finalement au sein d’un même livre que Zoé Perrin a choisi de faire se rencontrer les trois héroïnes d’Anamorphoses et de décliner un motif qui s’avère paradoxalement leur unique point commun. Mais au-delà de la dynamique qu’il imprime au récit, ce revirement est l’occasion d’atteindre peut-être l’objectif premier qu’il s’était fixé, ou d’honorer la conviction profonde qui anime une auteure pour qui l’art a pour fonction de manifester le terrain universel de l’humain dans une sorte d’instantané. Une conviction, mais surtout un défi : celui d’y parvenir avec les mots sans en diluer l’effet. « C’est sans doute la musique, confie-t-elle en coulisses, qui incarne le mieux ce pouvoir car elle nous touche immédiatement. Avec les mots, il y a toujours ce retard entre l’intention et l’effet ; le sens doit passer par le détour de notre imagination, de notre conscience. Il faut de l’abandon, une disposition d’esprit. Avec la musique, c’est différent. » À l’intersection de ces trois parcours, c’est également ceux de la musicienne et de l’écrivain qui échangent en sourdine, au sein d’une écriture nourrie de la sensibilité de chacune. L’une apporte à l’écrivain une oreille attentive aux silences, un rythme et une légèreté qui donnent au roman une fraicheur et un timbre particulier. C’est aussi elle, on l’imagine, qui injecte dans les interstices du livre une atmosphère oscillant entre la nonchalance des ambiances enfumées des soundsystems et l’univers acide de la techno ou de la house. L’autre fournit en retour à la musicienne un procédé d’écriture singulier qui pourra agacer par la manière dont il donne parfois au lecteur l’impression d’être tombé comme Alice dans le terrier du lapin blanc, mais c’est précisément vers ce non-lieu que l’auteur cherche en permanence à nous conduire. À la fois énigmatique et limpide, le style alterne ainsi entre une langue prosaïque et un ton plus lyrique, qui permet d’éviter le principal écueil qu’on pouvait redouter du thème du roman dont il se dégage une morale paradoxalement optimiste : carpe diem.
Anamorphoses, Zoé Perrin, éd. Les épicuriennes, janvier 2012, 292 pages, 12,90 €.
Mariane Borie