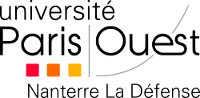Peinture de pluie et de roche.
 Tout commence avec une scène du Guépard de Visconti : Claudia Cardinale et Alain Delon se poursuivent dans un immense manoir délabré, hanté par le seul écho de leurs cris. Quoique piètre amateur de cinéma, Hans Moritz Apfeleisen fut conquis par le film, plus encore par cette scène : il tenait le décor de son nouveau roman qu’il allait encore une fois unir au cadre de ses Vosges éternelles.
Tout commence avec une scène du Guépard de Visconti : Claudia Cardinale et Alain Delon se poursuivent dans un immense manoir délabré, hanté par le seul écho de leurs cris. Quoique piètre amateur de cinéma, Hans Moritz Apfeleisen fut conquis par le film, plus encore par cette scène : il tenait le décor de son nouveau roman qu’il allait encore une fois unir au cadre de ses Vosges éternelles.
Les Vosges, ce temple de solitude et de silence, visage de roches et cheveux de pins, ne sont pas inconnues aux lecteurs d’Apfeleisen. Pays de la mère de l’auteur, elles sont présentes dans deux autres de ses romans, Gel Sombre et Le chant du Darou. A nouveau, il s’agit ici des Vosges profondes et mystérieuses, antiques montagnes désertées par la civilisation, toutes faites de calme et d’intimité, en complète opposition avec leurs cousines les Alpes, impressionnantes, intimidantes. L’action commence au cœur de ces géantes bienfaisantes qui fument la pipe les soirs de pluie : trois promeneurs, simples ramasseurs de champignons ou véritables vagabonds, sont surpris par une tempête et s’abritent dans une étrange demeure abandonnée, perdue au milieu des bois de résineux. La maison ne sera jamais extérieurement décrite et l’incongruité de sa présence au cœur des Vosges jamais constatée. Son hall, une longue pièce grise poussière ou noir charbon selon l’humeur de la lumière, devient le lieu de la rencontre qui rend possible l’intrigue. Un unique chapitre, le premier, campe un narrateur omniscient qui nous donne à voir les trois personnages sur le même plan : le professeur Aloysius, que la retraite fait grincer des dents, Jehanne, qui n’aime personne et que personne n’aime, et Octave, le poète ambitieux et incompris. Au dehors, la pluie rythme leur attente et les prédispose à l’ennui, les forçant bientôt à inspecter la maison pour passer le temps.
C’est alors une véritable chasse aux trésors qui se met en place, un univers de jeux et de contes d’enfant, car la vieille demeure inhabitée, aux allures de caverne d’Ali Baba, recèle bien des secrets. Les trois personnages découvrent bientôt que, si tous les meubles ont été emportés (sauf une chaise qu’ils se cèdent tour à tour), on a laissé aux murs une époustouflante collection de tableaux – essentiellement des portraits mais aussi des paysages et des scènes de la vie courante. C’est Jehanne, pourtant la plus taciturne, qui propose soudain pour tromper l’ennui et la pluie d’interpréter les tableaux, de comprendre leur signification, de les presser comme des citrons bien mûrs pour faire éclater leur histoire. Le narrateur omniscient est éclipsé, au profit d’un narrateur première personne, et chaque personnage prend tour à tour la parole, élaborant sa propre analyse de la situation picturale : chacun fait ses propres découvertes, en accord avec ses pensées, ses goûts, son histoire, échange avec les autres, acquiesce à leurs idées, les complète ou les rejette. L’histoire se brode ainsi, au travers de vieilles toiles décrites et comparées par les trois promeneurs en fonction de leurs envies. Tout cela sur fond sonore de la pluie qui frappe les vitres fendues, et à laquelle l’auteur laisse parfois la parole. A chaque fois que les trois personnages ont décortiqué une suite de tableaux, en les pelant comme des poires juteuses (selon l’expression de Jehanne amatrice de comparaisons alimentaires), un narrateur externe, resté au dehors dans la tempête, interrompt brièvement l’étude des tableaux, comme pour laisser le lecteur souffler et lui permettre de se reposer en contemplant la pluie qui habille les Vosges d’une brume calme et silencieuse. Puis, deux pages plus loin, les promeneurs reprennent la parole pour poursuivre leur course à la compréhension et à la description.
« J’aime décrire, » a toujours assuré H. M. Apfeleisen. La maison aux mille tableaux est bel et bien bâtie sur son amour de la description, description avant tout de ces étonnants tableaux qui peuplent la demeure. C’est une véritable farandole de peintures qui a le mérite de ne pas perdre le lecteur : en dépit de son foisonnement, cette galerie suit un schéma subtil, chaque toile répondant à la précédente. On sent là tout l’amour d’Apfeleisen pour la peinture du dixième-neuvième siècle. Les tableaux évoquent pour beaucoup des œuvres symbolistes, à l’instar de cette scène de bal qu’Octave compare implicitement à un tableau de Gustave Moreau, L’Apparition : « Une danseuse au premier plan, en dépit de sa longue robe à traîne, de ses rubans roses, de son ridicule chapeau meringue, se tordait de souffrance, le visage fripé par l’angoisse, et ses deux mains, livides, se tendaient en direction du lustre. Un passant inattentif n’y aurait vu qu’une jeune beauté perdue dans une foule bien habillée, fâchée parce que son gandin de fiancé l’avait abandonnée au cours de la danse. Moi, j’y voyais Salomé, que sa robe fuchsia ne suffisait pas à masquer, et qui défaillait sous le regard de Jean-Baptiste – car ce lustre, dont les bougies explosaient de lumière pour engloutir la scène sous un magma de cire, ne pouvait être que la tête du saint, auréolée de gloire. » D’autres tableaux renvoient encore à Moreau, comme le portrait de l’ancêtre dressant sa tête jupitérienne pour foudroyer sa progéniture lovée à ses pieds (référence à Jupiter et Sémélé), ou bien à Arnold Böcklin et sa célèbre Île des Morts, évoquée sur cette toile où la grand-mère sur ses derniers jours rejoint par voie de mer une mélancolique île bretonne. Quant au décor extérieur, il est directement inspiré des œuvres de celui qu’Apfeleisen nomme « le peintre des cathédrales naturelles », Caspar David Friedrich. Lui-même véritable tableau, le dehors devient un paysage indistinct de brume et de pin, disparaissant sous cette étonnante tempête qui tarde à se calmer.
La demeure en elle-même est toute kafkaïenne, présentée comme une succession infinie de pièces, caves, celliers, salons, chambres, greniers. Les personnages s’y perdent immédiatement, empruntant au hasard couloirs et escaliers, sans s’interroger sur l’étonnant agencement des lieux. En bon admirateur de Kafka, Apfeleisen dote son décor d’un certain irrationalisme, transformant au fil de l’histoire sa maison en une construction de plus en plus immense, à l’image de son récit à mille branches, élaboré par un personnage, corrigé par un autre, complété par le troisième – et ce pendant quatre cents pages.
Mais Apfeleisen a su éviter le malaise qu’une œuvre de Kafka produit presque inévitablement. Les personnages de l’auteur pragois se perdent pour leur malheur, à l’exemple de Joseph K., le héros du Procès, qui s’égare dans les couloirs du ministère d’une justice absurde et angoissante. Ici, rien d’aussi sombre : Aloysius, Jehanne et Octave choisissent eux-mêmes de se perdre, puisqu’ils sont vagabonds de cœur et d’esprit et qu’ils acceptent de jouer le jeu de la demeure, de la visiter de fond en comble pour deviner (ou inventer ?) ses secrets. Toute cette galerie est un prétexte pour laisser les trois personnages broder, ensemble ou séparément, rendre à la demeure son antique vitalité en réinventant son histoire.
Reste que la richesse d’images et d’histoires peut surprendre, parfois rebuter. Il faut accepter d’emblée, en s’attaquant à cette œuvre, de la relire immédiatement après l’avoir achevée, pour saisir tout son foisonnement. Pour certains lecteurs, ce sera certainement trop : trop de détails, trop de descriptions, trop de tableaux, trop de récits ; et on peut les comprendre. La maison aux mille tableaux est terriblement dense, parfois pesante, et ne peut pas se lire d’une traite. De plus, elle semble d’abord entièrement bâtie sur les élucubrations des personnages, qui ne sont jamais véritablement infirmées, ni affirmées. Et pourtant, tout en douceur, une intrigue réelle émerge – un peu tardivement, après plus de cent pages de lecture. Après des discussions plutôt stériles, Octave et Jehanne, moins rationnels que le vieux Aloysius, décident de ne s’occuper que des épaves et des grands brûlés, les tableaux qui ont pris l’eau ou ont été déchirés, ceux qui leur semblent dissimuler de plus grands secrets. Parmi ceux-là, ils découvrent un petit portrait de femme, d’une grande beauté, dont il ne manque qu’une seule chose – le visage, griffonné par une main enragée. C’est autour de cette femme mutilée que l’intrigue se noue soudainement : pourquoi son portrait a-t-il été si cruellement abîmé ? Qui est-elle réellement, elle que les personnages recherchent sur les autres tableaux ?
Le lecteur en quête de réponse aura là son content, car cette histoire-là trouve une fin – imparfaite, peut-être, toujours noyée d’un certain mystère, mais une fin tout de même. Mais cette enquête, qui pourrait tout aussi bien être reprise dans un roman policier, n’est qu’un prétexte pour permettre à l’auteur, en arrière-plan, de poser son univers à la fois déroutant et apaisant. Il désire une œuvre qui étourdisse le lecteur suffisamment attentif : hommage rendu à Kafka, mais aussi à Schnitzler (Mon héritage autrichien, selon Apfeleisen) dans l’élaboration des monologues – intérieurs ou oraux – des personnages, référence aux peintres du dix-neuvième, et surtout éloge de l’imagination. L’intimité du décor, la poésie de l’écriture, les multiples détails, tout cela nous aide à entrer dans cette œuvre atypique et à nous en imprégner – pour au final élaborer nos propres analyses de ces mystérieux tableaux.
La Maison aux cent Tableaux (Gemäldenerzählung), Hans Moritz Apfeleisen,
Traduit de l’allemand par Anne Gremillet,
427 p., L’Autre-Part, coll. Germanique (septembre 2011), 25 €.