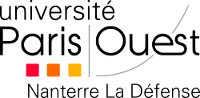Sans titre
Il existe de plus ou moins bons titres. Bons titres de bons écrivains, bons titres d’écrivains médiocres, mauvais titres tout court, trop courts, trop longs, métaphoriques ou explicites, symboliques, évocateurs ou sibyllins… Eh quoi ? Somme toute un titre n’est plaisant que si le contenu du livre est plaisant lui aussi. C’est le contenu seul qui contamine le titre pour le rendre bon ou mauvais à son tour. Si bien que parfois cet autre disparaît presque à nos yeux, perd de son importance. Ainsi, A la recherche du temps perdu aurait bien pu s’appeler Les Intermittences du cœur, titre auquel avait songé Proust, le livre n’en aurait pas été moins bon, et ce titre, par capillarité, serait devenu meilleur. Ne seraient donc « bons » que les titres des livres que l’on a aimés. Pourquoi pas ?… Ce sont eux qui s’offrent une place de choix quelque part dans notre mémoire jusqu’à ce qu’on les invoque, qu’on les cite. Pas de titre idéal sans récit excellent, pas d’histoire que l’on aime sans un titre qui marque. L’on aurait tort de croire que le titre fait tout, et que pour un bon mot ce qui suit est génial.
Or, pour mieux attirer notre attention et inciter à la lecture qui résoudra l’énigme, certains nouveaux auteurs cèdent aujourd’hui à une nouvelle mode. Celle qui consiste à donner des titres « malins » aux livres, totalement farfelus, voire absurdes. Prolifération dans les rayons de librairie de ces bizarreries parfois drôles, souvent ridicules. Les nouveaux best-sellers de la « littérature »… L’auteur, ostensiblement, prend de la distance par rapport à son œuvre. Il adopte une posture d’autodérision, ou au moins un air suffisamment détaché. Exemple : le premier titre des meilleurs ventes de roman pour le mois de juin, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi (Katherine Pancol). Dans une démarche visiblement marketing, ces titres ont au moins le mérite de retenir l’attention du potentiel lecteur, qui hésitera ou non à chercher d’abord sur la quatrième de couverture, ensuite dans le récit, une réponse à la loufoquerie dont il est le témoin forcé. Le titre est un mystère dont l’histoire est la clé. Défiant les horizons d’attente, il entretient avec le sens un rapport évolutif.
Nouvelle mode, disions-nous ? Pas si neuve que ça en vérité. La Cantatrice chauve en est un bel exemple, où Ionesco radicalement rompt le rapport entre le titre et l’œuvre. Fin de partie, chez Beckett, interroge le sens et le symbole. Pérec, maître du genre, impose les farfelus Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? et W ou le souvenir d’enfance. Cet art du décalage bouleverse le rapport traditionnel du titre et du contenu et confine parfois à la poésie. Illustré en littérature, il se retrouve aussi dans la peinture, notamment surréaliste. Magritte disait ainsi : « Mon titre n’explique pas mon tableau, comme mon tableau n’explique pas mon titre. » Il n’y a donc aucune orientation de la pensée, aucun carcan, mais une distorsion plus vive entre l’attente du lecteur et la réalité de l’œuvre. Les liens entre le titre et l’histoire se tissent et se détissent au fur et à mesure de la lecture. Comme l’entendait Umberto Eco : « Un titre doit embrouiller les idées, non les embrigader. »