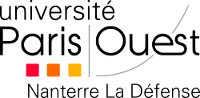Un beau ténébreux de Julien Gracq
Une bande de jeunes gens se retrouve en villégiature, le temps d’un été, dans une station balnéaire aux accents bretons. Tous – cette société que les vacances réunissent et un certain Gérard, dont le journal est livré dans la première partie du roman – résident à l’Hôtel des Vagues. Dès le début du roman, un homme vient s’ajouter aux pensionnaires, Allan, le beau ténébreux.
Alors, tout ne va plus tourner qu’autour de lui. Cette figure sans passé, séduisant hommes et femmes, ne cessera tout le long du roman d’exercer un attrait sulfureux sur chacun.
On a dit de ce roman qu’il est celui d’une fascination, et à la lecture c’est ce que l’on observe : qui est cet étrange jeune homme, venu, semble-t-il, de nulle part, avec cette aura énigmatique, et qui semble jouer ses derniers jours ? Une jeune femme tombe amoureuse. Un homme l’observe exister, ravi et inquiet. Il accorde la même attention aux menus faits et gestes d’Allan qu’à ses dangereuses extravagances.
À cet homme, le narrateur déclare : « Votre rayon invisible provoque chez les plus vulnérables une hémorragie intarissable de rêve, de vague exaltation. » Gérard parle de la jeune femme amoureuse, l’insecte prêt à se poser sur l’ampoule brûlante, peut-être de lui-même tant la formule est juste. Voilà la perversion d’un personnage que l’on ne peut connaître sans se faire mal, mais qu’une fois croisé l’on ne peut que connaître. Car Un beau ténébreux est le roman de celui qui n’a rien à perdre, celui qui « libre de tout, […] se découvre maître de tout. »
Fascination pour un homme, mais aussi pour une atmosphère. Car Un beau ténébreux se déroule dans un cadre lui-même envoûtant. Le lecteur est, page après page, pris dans l’ivresse des sables mouvants d’un songe. Dans une ambiance ouatée, est restitué un décor de lande marine battu par un vent salé. Au loin un sac et ressac d’océan retentit, décrit à la manière ténébreuse du « Nouveau Roman ». Des propriétés désertes ne sont illuminées que d’une seule fenêtre, comme un tableau de Magritte. Les personnages évoluent, d’un dîner à un bal masqué, d’un casino à la grève, dans un climat de claustration insulaire. Car même s’il n’est jamais question d’île, quelque chose de lourd plane sur ce petit groupe, pesanteur paradoxale quand on sait que son objet est le beau ténébreux, lui-même agissant avec une légèreté équivoque.
L’été finissant, cette société oisive ne peut se résoudre à quitter l’hôtel. Alors elle attend, plus ou moins consciemment, un événement. Et cet événement, ressenti dans leurs chairs par ces hommes et ces femmes, est un drame dont le pendant est, simultanément, le malheur froid de l’été qui décline. La région se vide, l’arrière-saison est aux portes de l’hôtel et chacun attend d’être en quelque sorte libéré, souhaite cette fin qui, inscrite en filigrane depuis le début de leur inaction, tarde à arriver. Septembre passe sans se mouvoir, comme si Allan était devenu le maître d’un nouvel ordre absolu, d’un rythme marginal et que cela n’était qu’à rebours que la vie après lui allait continuer, changement qui, déjà initié depuis son arrivée, ne sera effectif que lorsqu’il se décidera à perpétrer le geste auquel au fond le lecteur et les protagonistes du roman se préparent, celui de se donner la mort.
Car Un beau ténébreux est le roman d’un suicide. Il y est écrit quelque part que « du naufrage volontaire surgit fatalement la chance suprême. Ayant signé son abdication, il (Allan) s’est fait roi. » La chance suprême, est-ce l’homme qui, se faisant dieu, choisit la mort comme une opportunité dont découle la douce domination de ceux qui n’ont rien à perdre, sur le commun des mortels, ou ce temps de sursis précédent l’acte, période de jouissance amère ? Réponse inconnue comme cet homme, arrivé à l’Hôtel des Vagues comme un étranger, mort comme un marginal.