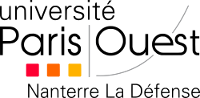Inglorious Basterds
« Il était une fois une France occupée… »
I)
Cette phrase qui débute Inglorious Basterds est extrêmement importante pour comprendre et apprécier la suite du dernier film (2009) de Quentin Tarantino. En effet, tout dans cette œuvre est fictif, excepté les personnages réels allemands (Hitler, Goebbels etc.) et anglais (Churchill). Il ne faut donc pas chercher une quelconque rigueur historique, bien au contraire, le réalisateur américain prend bien soin de se dédouaner de toutes ses velléités afin de mieux se concentrer sur sa caméra, son histoire et ses personnages. On ne peut certes point résumer Tarantino à son goût pour le gore, la violence et les dialogues piquants. Il y a derrière un vrai talent de mise en scène, de montage, de choix dans les acteurs. Beaucoup lui reprochent de trop se concentrer sur l’hommage du cinéma de genre et de ne pas s’inscrire dans l’un d’eux. Mais c’est justement parce que ce qui le caractérise le mieux, c’est son amour profond pour le 7e art. Lorsque l’on s’attaque à une de ses productions, on sait pertinemment qu’il y a derrière des milliers d’heures de visionnages et une connaissance monstrueuse du genre dont il s’apprête à faire l’apologie, souvent avec une douce mélancolie.
Comme souvent chez Tarantino, le film se découpe en plusieurs histoires qui se regroupent la plupart du temps à la fin, nous livrant une œuvre multi partîtes où chaque personnage important est étudié avec une attention toute particulière. C’est le cas dans Inglorious Basterds où le réalisateur nous narre l’aventure de Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) dont la famille a été tuée par « le chasseur de juif » Hans Landa (Christoph Waltz), et celle du Lieutenant Aldo Rain (Brad Pitt) et de ses bâtards juifs américains qui traquent les nazis en France. Tous se retrouvent plus ou moins volontairement dans une tentative d’assassinat d’Hitler et de tout son état major dans un cinéma parisien que possède justement Shosanna.
Le chapitre un se déroule dans une ferme laitière de l’Est de la France où le propriétaire cache une famille juive sous son plancher, la famille de Mélanie Laurent. Le colonel SS ainsi que quelques soldats viennent pour interroger le propriétaire et tenter de trouver la seule famille juive qui ait encore échappé à la traque de la Gestapo. S’ensuit un interrogatoire autour d’un verre de lait, un véritable face-à-face entre Hans et le fermier, qui tourne à l’avantage du redoutable SS. Avec toute la ruse et la psychologie dont il est capable, Landa parvient à faire littéralement craquer le pauvre « juste » qui ne peut plus se targuer de porter cette appellation. La confrontation est pesante, l’atmosphère moite, le visage du français, livide au fur et à mesure de l’interrogatoire, contraste avec la décontraction et la presque joie du bourreau. Cette scène que certains spectateurs ont trouvée lente, trop étirée, est selon moi magnifique de bout en bout, nous laissant haletant, pendu au verdict du pauvre fermier qui en fin de compte ne fait que protéger sa famille, mais au détriment d’une autre. Toute la complexité de la résistance, étant résumée dans cet acte.
La suite est différente, laissant plus de place à l’humour, au cynisme et à l’action, non plus psychologique (bien qu’elle soit encore présente) mais violente et totalement revendiquée. Cette impression est corroborée par les horreurs que font subir les bâtards aux nazis, du simple soldat de la Wehrmacht à l’officier SS, avec des scènes de scalpes et d’exécutions particulièrement sanglantes. L’énorme avantage avec un cinéaste comme Tarantino est qu’il ne se cache pas derrière une certaine bienséance et ose tout. La fin en est l’exemple le plus criant. Mais comme dit plus haut, il ne faut jamais oublier que ce n’est qu’un film, une histoire qui raconte l’Histoire à travers les yeux d’un homme. On ne verse pas ici dans le Il faut sauver le Soldat Ryan ou La chute, non tout est fait à des fins de divertissement, j’irai même jusqu’à dire de défoulement salvateur. Néanmoins, et contrairement à un film comme la momie 3, Tarantino n’oublie jamais de garder une certaine cohérence dans son récit, même s’il est parallèle, avec notamment un vrai travail sur les langues ; la majorité des répliques n’est pas en anglais, mais en allemand et en français. Cela permet de donner encore plus de crédit à l’œuvre et de l’ancrer un peu plus dans un espace temps qui, bien que différent du nôtre, n’en reste pas moins crédible et passionnant.
II)
Attardons-nous désormais sur les acteurs et la performance générale qu’ils livrent. On pouvait s’attendre, et à juste titre, à ce que Brad Pitt soit le fer de lance de ce film et qu’il tire un peu la couverture à lui, il n’en est rien et ce encore une fois grâce au génie du réalisateur. Tous possèdent des rôles intéressants et les interprètent avec conviction, même si je mettrais un petit bémol sur le casting francophone (excepté le fermier du chapitre un qui tient la dragée haute à Christoph Waltz) avec une Mélanie Laurent un peu trop froide bien que géniale par instant et son compagnon noir trop fade. Diane Kruger nous montre, enfin, qu’elle sait jouer, ce qui n’était pas toujours le cas dans ces précédents films. Les bâtards, pour ceux qui ont un véritable rôle, sont quant à eux jouissifs, et nous proposent une belle brochette de fous furieux. Mention spéciale à l’officier allemand Stiglitz, tueur de SS, qui dans le rôle de la brute propre à faire rire le spectateur réussit parfaitement sa mission. Mais si on ne devait retenir qu’un acteur ce serait sans doute aucun, Christoph Waltz qui joue à merveille son rôle de chasseur de juif excentrique, certes, sans pour autant être caricatural. Il est doté d’une véritable palette d’acteur, en piochant dans le côté tantôt comique, tantôt dramatique, avec une habilité et une justesse proprement bluffante. Il fait partie de ses méchants que l’on adore détester, malgré tous les méfaits atroces qui lui sont reprochés. Son prix d’interprétation masculine à Cannes est amplement mérité.
Encore une fois, on ne peut dédouaner cet interprétation du talent du réalisateur qu’est Quentin Tarantino et qui a su trouver le bon acteur pour interpréter le bon personnage. C’est d’ailleurs récurrent chez lui de mettre en lumière ce qui ne l’est pas assez. Et cela vaut aussi pour la musique de ses films qu’il prend toujours un soin particulier à dénicher, (très) souvent avec succès. L’exemple est flagrant dans Pulp Fiction où l’on découvre Urge Overkill avec « Girl you’ll be a woman soon » ainsi qu’ Edwin Collins et son « Never met a girl like you », deux bijoux du rock n’roll des années 90, sans oublier le mythique « Misirlou ». Il en va de même ici avec la (re)découverte du titre de David Bowie « Cat People (Putting out on fire) » qui prend tout son sens dans la scène, vous comprendrez pourquoi. L’autre, et agréable, surprise musicale de ce film est l’omniprésence dans la bande originale du génialissime Ennio Morricone, le compositeur italien de la BO, entre autres, de Le Bon, La Brute et Le Truand. Tarantino piochant ça et là dans les œuvres du compagnon virtuose de Sergio Leone, donnant par moment à son film des allures de western.
Si ce film apparaît dans une série d’articles dédiés aux nanars ne tient pas tant à son côté « nanar volontaire » (parce que ce n’est pas un) qu’à l’esprit de Tarantino et ses sources d’inspirations pour son travail. Ce n’est pas une parodie en soit des films de guerres ou de Western ; tout cela est plus subtil et n’appartient au final qu’à l’univers du cinéaste américain. Il y a beaucoup de kitch dans le film ; les reproductions de longs métrages allemands de propagandes sont assez désopilants, sans pour autant condamner fermement leurs auteurs. Il s’en amuse simplement, comme le fait un Edgar Wright avec les séries Z d’horreur. L’exemple le plus criant n’est autre que Brad Pitt qui sur joue volontairement, s’inscrivant dans l’archétype même du héros américain dur à cuir. Notre réalisateur alterne vraiment les gros clichés assumés, j’irai même jusqu’à dire décomplexés, avec des instants d’une puissance folle. Tout cela nous procurant un plaisir immense là où d’autres réalisateurs, moins doués, nous auraient servi une soupe aux navets : fade, insipide, et ridicule.
Vous l’aurez compris Inglorious Basterds est une véritable réussite, à condition de se laisser porter par l’inspiration de son créateur. Il ne faut jamais perdre de vue le côté fictif de l’œuvre, tout en appréciant le soin des reconstitutions et la précision du détail propre à Tarantino. Il y a certes quelques défauts, mais ils sont si infimes et l’essentiel du métrage si jouissif que l’on ne peut qu’applaudir le résultat ! Les séries B, voire Z, ne sont donc pas si inutiles que cela.