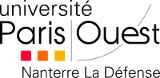Répondre au commentaire
La procédure de sauvegarde française : un tournant dans la perception des procédures collectives ? par Diane Bustamente
La faillite représente un enjeu important sur les marchés internes et sur le marché international dont elle entrave le bon fonctionnement. Certes, la faillite n’est pas une anomalie dans la conception libérale du marché, mais ses effets sur les différents acteurs de ce marché ne sont pas négligeables.
Il n’existe pas de droit international de la faillite ; par conséquent, afin d’encadrer ses effets, les États adoptent leur propre réglementation, notamment par le biais de procédures de droit interne, dites « les procédures collectives ». Grâce à celles-ci, le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas abandonnés à l’initiative individuelle de chaque créancier mais sont organisés de manière à ce que tous les créanciers puissent faire valoir leurs droits. Ainsi, les particuliers doivent être vigilants vis-à-vis de la réglementation nationale en vigueur.
Toutefois, l’Union Européenne a adopté le Règlement CE n° 1346/2000, le 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité. Celui-ci établit des normes communes concernant la compétence des juridictions nationales pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, la loi applicable et la reconnaissance mutuelle des décisions entre les États membres. De plus, il vise à dissuader le débiteur de tirer profit des règles de compétence internationale divergentes en déplaçant ses avoirs d’un pays à l’autre, afin d’améliorer sa situation juridique en profitant d’une procédure judiciaire qui lui serait plus favorable (forum shopping).
Les États ont poussé leur initiative jusqu’à l’adoption de procédures préventives, en amont de la faillite. Ils instaurent des procédures hybrides dans lesquelles le débiteur n’est pas en cessation de paiements, mais aussi des procédures de pré-insolvabilité dans lesquelles ce débiteur continue d’avoir la gestion de son entreprise. Quoiqu’il en soit, ces procédures permettent à l’entreprise menacée par la faillite d’organiser sa restructuration.
La procédure de sauvegarde est une procédure originale alliant les spécificités des procédures hybrides et celles de pré-insolvabilité. Cette procédure s’est récemment développée dans de nombreux États. La procédure de sauvegarde est une procédure interne, comme toute procédure collective. En l’espèce, nous allons nous concentrer sur la procédure de sauvegarde française.
La France fut l’un des derniers pays européens à la mettre en œuvre. La Banque Mondiale lui avait elle-même recommandé d’ajouter au droit des faillites une procédure inspirée du Chapter 11 du Bankruptcy Code américain dans son rapport « Doing Business » de 2004. La procédure de sauvegarde existe donc dans notre législation depuis la loi du 26 juillet 2005, dite « de sauvegarde des entreprises », entrée en vigueur le 1er janvier 2006. De plus, la procédure de sauvegarde française est désormais soumise à la législation européenne sur l’insolvabilité depuis 2006. C’est une procédure préventive, présentant l’originalité d’être ouverte à la demande du débiteur dont l’entreprise n’est pas encore en situation de cessation des paiements.
Malgré le taux de réussite de la nouvelle procédure (en comparaison avec celle du redressement judiciaire qui se terminait en liquidation dans 7 cas sur 10 avant 2008) et de son utilisation par des entreprises emblématiques (telles qu’Eurotunnel ou Libération), elle ne représentait qu’un peu plus de 1% des procédures collectives ouvertes. Le coût de la procédure, le ressenti d’échec par l’entreprise, la possibilité d’éviction du dirigeant et l’étroitesse de la « fenêtre de tir » qui ne permettait le déclenchement de la procédure de sauvegarde qu’en cas de difficultés de nature à mener à la cessation des paiements ont été les principales raisons de son échec lors de ses premières années.
Ainsi, la Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) est venue assouplir cette procédure en vue de la rendre plus attractive aux yeux des débiteurs.
Enfin, une loi du 22 octobre 2010 vient compléter le dispositif en créant une catégorie spécifique de sauvegarde, dite sauvegarde financière accélérée.
La procédure de sauvegarde témoigne d’une évolution dans la conception des procédures collectives, non anticipée par le Règlement européen de 2000. Elle se trouve en un juste milieu entre les procédures amiables de restructuration de l’entreprise (mandat ad hoc et procédure de conciliation) et les procédures d’urgence (procédure de redressement judiciaire et liquidation) (I). Cependant, du fait de sa nature et de son objet elle ne s’imbrique ni suffisamment ni efficacement dans la procédure d’insolvabilité européenne ; ce pourquoi la Commission a proposé une réforme du Règlement en vue de s’adapter aux nouveaux enjeux européens (II).
I/ La procédure de sauvegarde en droit interne français : une procédure préventive juridique originale
Il existait déjà des procédures de négociation amiable, avec deux systèmes de traitement conventionnel des difficultés des entreprises : le mandat ad hoc et la conciliation.
Le législateur a voulu ajouter à travers la procédure de sauvegarde un système plus contraignant pour les créanciers. La procédure de sauvegarde étend les prérogatives du débiteur, en lui permettant un gel du passif.
Le point commun de ces procédures est l’état financier de l’entreprise, qui n’est pas en cessation des paiements. Dès que l’entreprise est en cessation des paiements depuis au moins 45 jours, la procédure de redressement judiciaire, ou si la situation est irrémédiable la procédure de liquidation, est ouverte au détriment des procédures de négociation amiable.
La procédure de sauvegarde a été ajoutée dans la liste des procédures collectives par le législateur, après une prise de conscience de l’efficacité de cette restructuration de l’entreprise organisée en amont de cette limite de cessation des paiements, favorable à l’économie nationale. Un chef d’entreprise choisit en fonction de ses difficultés le meilleur procédé pour arriver à un assainissement de la situation de l’entreprise.
L’instauration d’une procédure préventive : le choix entre les différents outils en vue de la restructuration de l’entreprise
Le législateur veut faciliter une action anticipée du chef d’entreprise en lui conférant certains avantages et statuts. Désormais, la fenêtre de tir de la procédure de sauvegarde est élargie. Elle autorise l’ouverture de la procédure par le débiteur à la seule condition de justifier de « difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », telles que la disparition d’un fournisseur essentiel, la perte prévisible d’un marché ou encore l’impossibilité de rembourser un prêt in fine. Par conséquent, le débiteur ne doit plus être de facto dans une situation précaire. De plus, le dirigeant voit sa position protégée au sein de l’entreprise. En effet, la procédure de sauvegarde lui confère une véritable possibilité de traiter les difficultés sans devoir renoncer à la direction de l’entreprise et sans courir le risque de voir les cautions personnelles, bien souvent consenties par lui-même ou sa famille, actionnées.
La procédure de sauvegarde est souvent mise en retrait des autres modalités de restructurations telles que le mandat ad hoc et la conciliation ; le premier étant le plus populaire et le deuxième connaissant une hausse depuis l’instauration de la procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA), dont elle est le prérequis. Dans le mandat ad hoc, autant que dans la procédure de conciliation, le mandataire essaie de trouver un accord entre le débiteur et ses créanciers en vue d’assainir sa situation, et est tenu à l’obligation de confidentialité (article L611-15 du Code de commerce). Le mandat ad hoc est très prisé, étant moins contraignant que la conciliation et la sauvegarde. Il est vrai qu’il parvient plus facilement à un accord avec un taux de réussite d’environ 70%, mais il doit surtout sa popularité à sa confidentialité. Cependant, ces procédures n’appartiennent pas exclusivement au droit des procédures collectives. Dès lors, l’Union Européenne ne les reconnaît pas dans son règlement sur l’insolvabilité des entreprises, ce qui entrave leur bon fonctionnement sur le marché européen.
Les délais pour parvenir à un accord entre le débiteur et les créanciers, prévus par la législation, jouent un rôle important dans le choix de ces procédures. Effectivement, lorsque l’entreprise est face à une situation de cessation de paiements, la procédure de redressement judiciaire est automatiquement ouverte, voire même celle de la procédure de liquidation lorsqu’aucun redressement ne paraît possible. Ainsi, le débiteur analyse la situation actuelle de son entreprise et son évolution future, ce qui va lui permettre d’agir en conséquence dans les délais impartis. Dans le mandat ad hoc, le mandataire n’est pas tenu à un délai fixe. Le conciliateur, lui, ne doit pas être désigné pour une période excédant 4 mois ; période qui peut être prorogée d’un mois à la demande du débiteur. Enfin, la procédure de sauvegarde est limitée à une période d’observation de 18 mois maximum.
La procédure de conciliation pourrait connaître un succès croissant grâce à la SFA, mettant en place le « prepack » à la française, dont elle est la passerelle. La SFA est une arme susceptible de faciliter les négociations et l’établissement d’un plan de sauvegarde entre le débiteur et ses principaux créanciers, dits créanciers financiers, ce qui est utile notamment lorsqu’une minorité de créancier fait opposition à un accord.
Ainsi, ni le mandat ad hoc ni la procédure de conciliation ne sont des procédures collectives, bien qu’elles soient des procédures hybrides et de pré-insolvabilité. De ce fait, elles sont encore, pour le moment, hors du champ d’application du règlement de 2000. Les débiteurs doivent en tenir compte dans leur plan de restructuration, surtout quand leur entreprise appartient à un groupe de sociétés.
Les spécificités de la procédure de sauvegarde : un débiteur mis au cœur de la procédure collective
La particularité de la procédure de sauvegarde est d’autoriser le recours à une procédure judiciaire permettant « d’imposer, et non de négocier un gel et réétalement automatique du passif, alors que l’entreprise dispose toujours de la trésorerie lui permettant de payer ses dettes exigibles et n’est donc pas en état de cessation de ses paiements ». Cet avantage va lui permettre de constituer des ressources financières qu’elle affectera à sa restructuration. Le débiteur gère l’entreprise comme il l’entend, sous réserve des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
La première spécificité remarquable de la procédure de sauvegarde par rapport aux autres procédures collectives est son ouverture, qui est faite à la demande du débiteur.
La seconde spécificité concerne l’état des comptes de l’entreprise, puisque sa trésorerie lui permet toujours de payer ses dettes exigibles. Cependant, le chef d’entreprise se retrouve face à des « difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ».
Le déroulement de la procédure de sauvegarde est pratiquement similaire à celui d’une procédure de redressement judiciaire. Ainsi, le jugement d’ouverture emporte dans un premier temps l’interdiction de payer les dettes antérieures, puis dans un second temps la désignation d’un mandataire, chargé d’établir l’état du passif, et éventuellement d’un administrateur. La nomination d’un administrateur judiciaire est obligatoire pour les entreprises ayant au moins 20 salariés ou réalisant un chiffre d’affaire au moins égal à trois millions d’euros. Retenons que la présence d’un administrateur est une condition pour l’application du règlement de 2000, problème sur lequel il conviendra de revenir ultérieurement. L’administrateur n’a que deux missions, lesquelles sont la préparation du plan de sauvegarde et l’autorisation des contrats en cours. Le débiteur ne perd pas son rôle de gestionnaire. De plus, l’administrateur est tenu de faire les actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise, tels que procéder à un acte interruptif de prescription, et de faire les actes nécessaires à la conservation des capacités de production : renouveler un contrat d’entretien ou embaucher du personnel.
La procédure de sauvegarde donne des avantages non négligeables, par comparaison à la procédure de redressement judiciaire, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. Ainsi, le débiteur peut lui-même effectuer l’inventaire de ses biens lui permettant une réduction des frais de procédure. De plus, la procédure de sauvegarde ne peut jamais donner lieu à une cession totale de l’entreprise. La cession partielle est envisageable en vue de la restructuration de l’entreprise. De même, les parts sociales ou les actions restent librement cessibles. L’objectif de retour à l’équilibre de l’entreprise lui confère la possibilité de résilier certains contrats commerciaux ou de travail, si la rupture est nécessaire à la sauvegarde du débiteur, et si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. En outre, le débiteur n’est pas menacé par le principe d’inapplicabilité des nullités de la période suspecte qui est appliqué dans les autres procédures collectives. En ce qui concerne les dispositions ayant un effet sur les créances d’autrui, le principe d’inopposabilité aux garants des créances non déclarées pendant l’exécution du plan s’applique. D’un point de vue concret, ces créanciers ne seront pas remboursés dans la majorité des cas, car tout autre créancier est privilégié quant au remboursement de la dette. Les cautions du dirigeant sont gelées pendant la période d’observation mais aussi pendant celle du plan de sauvegarde, qui ne peut excéder dix ans. Enfin, les garants bénéficient de l’arrêt du cours de l’intérêt (article 622-28) qui sont les intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tout intérêt de retard et majoration, à moins qu’il ne s’agisse de contrats de prêts, ou d’un contrat assorti de paiements différés conclu pour une durée égale ou supérieure à un an. Ainsi, ces avantages, qui seront développés dans la seconde partie, accentuent les risques du forum shopping vers la France, au détriment des créanciers.
De là se pose la question de l’abus, justifiée par la tentation pour le dirigeant de profiter des avantages de la procédure de sauvegarde. Les conditions d’ouverture de la procédure sont appréciées au jour du jugement d’ouverture. La jurisprudence rappelle la finalité première de la procédure de sauvegarde qui est de sauver l’entreprise. En effet, la décision Cœur de défense du 8 mars 2011 dénonce la tentative frauduleuse du débiteur d’ouvrir une procédure de sauvegarde en vue d’obtenir la renégociation des dettes pour le bénéfice des actionnaires.
Par conséquent, il est aisé de juger de l’objet ainsi que de la finalité de la procédure collective dite procédure de sauvegarde, adoptée en France comme dans beaucoup d’autres nations.
D’une part, la procédure de sauvegarde offre au débiteur un cadre légal contraignant pour la restructuration de son entreprise. Le nombre de procédures de sauvegarde est en progression, avec 1498 jugements d’ouverture prononcés en 2012, soit plus du double qu’en 2008 en vertu de l’étude Deloitte/Altares. Cependant, sa part reste encore limitée. On compte seulement une ouverture de sauvegarde pour douze procédures de redressement judiciaire. En effet, la perte de confidentialité liée à cette procédure pousse les sociétés à en retarder le traitement, quitte à supporter le risque d’entrer dans une procédure d’urgence. La peur des dirigeants de mettre à jour une mauvaise gestion de leur entreprise n’est pas l’unique cause de son ouverture limitée. L’absence d’anticipation des difficultés par les dirigeants y joue aussi un rôle important.
D’autre part, elle met le débiteur au centre de la procédure collective puisqu’il conserve ses pouvoirs de gestion. Ces explications mènent au constat que cette procédure est mal imbriquée dans le droit européen, dès lors qu’elle est inscrite en tant que procédure d’ « insolvabilité » d’un État membre.
Partie II : L’imbrication de la procédure de sauvegarde dans le droit d’insolvabilité européen
L’Union Européenne veille au bon fonctionnement du marché intérieur. Or, l’absence d’harmonisation entravait l’objectif du marché intérieur, notamment par le développement du phénomène de l’élection de juridiction, dit forum shopping. Il était nécessaire d’établir une coopération entre les différents États membres, au sens de l’article 65 du Traité sur l’Union Européenne. L’adoption du règlement CE n° 1346/2000 établit, selon le principe d’universalité, un droit matériel en ce qui concerne la compétence des juridictions, le droit applicable à la procédure d’insolvabilité et la reconnaissance mutuelle des jugements de procédure entre les États membres. Le règlement s’applique aux procédures collectives « fondées sur l’insolvabilité » du débiteur qui entraînent son dessaisissement partiel ou total, ainsi que la désignation d’un « syndic ». Le syndic est la personne ou l’organe qui a pour fonction d’administrer, voire de liquider les biens, ou de surveiller la gestion des affaires du débiteur. Le règlement exclut de son application les entreprises d’assurance, établissements de crédit et entreprises d’investissement impliquant la détention de fonds ou valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif.
Il convient de relever tout de suite l’étroitesse de la fenêtre de tir, de par le terme « insolvabilité », insinuant que le débiteur soit en situation de cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas dans la procédure de sauvegarde. Le terme est donc inadéquat. Toutefois, cette procédure de pré-insolvabilité a quand même été ajoutée à la liste des procédures d’insolvabilité dudit règlement, en son Annexe A, avec la dernière modification du 27 avril 2006.
Le fonctionnement et l’harmonisation classiques des procédures d’insolvabilité au sein de l’Union Européenne : une remise en cause de la procédure de sauvegarde
Le Règlement donne droit à deux types de procédures d’insolvabilité, que sont la procédure principale et la procédure secondaire.
La procédure principale est celle qui a lieu dans l’État où le débiteur a ses centres d’intérêts principaux. La notion de « centres d’intérêts principaux » dépend de son interprétation par les juridictions étatiques. Par conséquent, le débiteur aurait la possibilité de choisir la juridiction compétente en modifiant la localisation de ses centres d’intérêts principaux dans un pays où la législation lui sera plus favorable. Le créancier pourrait se prêter au même jeu, en démontrant une autre localisation qui serait à son avantage à lui. De ce fait, la question du forum shopping n’est pas résolue. Ainsi, le règlement européen qui avait pour objectif de résoudre ce problème ne pourrait atteindre efficacement ses objectifs tant que les juridictions européennes n’auront pas apportées de précision sur l’interprétation de ces dispositions juridiques. En effet, la définition des « centres d’intérêts principaux » ne doit pas être laissée au libre arbitre des États, puisque c’est cela qui a été à l’origine des préoccupations liées au forum shopping.
La procédure secondaire peut être ouverte à l’endroit où le débiteur a son établissement. Il faut entendre par « établissement » le lieu d’opération où le débiteur exerce une activité économique avec des moyens humains et des biens. Cette procédure est soumise à la procédure principale et ne peut être qu’une procédure de liquidation. Il existe deux exceptions permettant son ouverture avant la procédure principale : d’une part, si aucune procédure d’insolvabilité ne peut être ouverte dans l’État membre où le débiteur a ses centres d’intérêts principaux ; d’autre part, si un créancier a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège dans l’État concerné, ou s’il en tire sa créance, la demande. Dans le cadre de cette procédure, seuls les biens du débiteur situés dans l’État membre sont concernés.
Il peut dès lors être souligné un problème qui risque d’être rencontré par un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde dans un État et d’une procédure de liquidation dans un autre. La liquidation qui est mise en œuvre va contrecarrer la réglementation de la procédure de sauvegarde, non seulement en augmentant le passif du débiteur, mais également en empêchant au débiteur la restructuration de son entreprise. En effet, même si la procédure secondaire de liquidation est limitée aux biens du débiteur sur le territoire, la saisine de ses biens peut entraver l’objectif de la procédure de sauvegarde. En effet, l’actif du débiteur sera réduit et sa responsabilité sera engagée, or la procédure de sauvegarde interdit ou interrompt toute action en justice de la part des créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure.
La loi applicable à la procédure d’insolvabilité est celle de l’État membre où cette dernière est ouverte. Le droit interne décide donc par exemple du sort des biens du débiteur après l’ouverture de la procédure, des droits des créanciers, de la production, vérification et admission des créances, et des effets sur les contrats en cours. Les créanciers doivent être vigilants concernant le respect du délai qui leur est imparti en vue de la déclaration de leurs créances, et des conséquences de cet oubli, d’autant plus qu’il n’y a pas de règles de publication obligatoire dans les autres États membres où un créancier résiderait. En France, les créances doivent être déclarées dans les deux mois suivant la publication au BODAAC du jugement d’ouverture. La sanction du non dépôt est l’inopposabilité de la créance au débiteur, comme au garant, dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Le principe d’inopposabilité s’impose pendant l’exécution et après l’exécution du plan par le débiteur, pour lui-même. Il se trouvera donc libéré du passif qui n’a pas été déclaré. Il y a un manque de sécurité juridique du créancier et du débiteur à combler ; c’est ce que va tenter de faire la Commission dans sa proposition de révision.
Enfin, la nécessaire présence d’un syndic, qui en l’espèce est l’administrateur, exclut les procédures de sauvegarde qui ne portent pas l’obligation pour le débiteur d’être assisté ou surveillé par un administrateur, tel que vu dans la première partie. En France, ce champ d’application exclut les petites entreprises (TPE). Les TPE représentent non seulement 2,5 millions d’entreprises en France, mais ce sont aussi les entreprises les plus touchées par la faillite. La proposition de la Commission en vue de la révision du règlement de 2000, souhaite axer la procédure d’insolvabilité européenne sur la survie des PME et TPE.
L’évolution du droit européens de l’insolvabilité européen : vers une prise en compte de la procédure de sauvegarde
Pour finir, la Commission est chargée de présenter tous les 5 ans, à partir du 1er juin 2012, au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, un rapport relatif à l’application de ce règlement, accompagné ou non d’une proposition visant à l’adapter. Elle a adopté une proposition le 1er décembre 2012 en révision de ce règlement, après une large consultation européenne. Elle propose cinq mesures principales.
Tout d’abord, il est proposé d’élargir son champ d’application afin d’y inclure les procédures hybrides et celles de pré-insolvabilité. Dans le premier cas la direction existante serait maintenue. Les procédures de pré-insolvabilité prévoit de leur côté la restructuration d’une entreprise en difficulté en phase de pré-insolvabilité. Une évaluation a conclu que quinze États membres disposent de ce type de procédures. Pour la France, ce sont le mandat ad hoc, la procédure de conciliation et la sauvegarde financière accélérée ; concernant le Royaume-Uni, c’est le système des concordats. En effet, ces procédures ont été adoptées dans de nombreux pays, en vue d’accroître les chances de réussite de la restructuration. L'ouverture d’une procédure d’insolvabilité soumise au Règlement européen, qui ne reconnait pas les effets de ces procédures, entache leur réussite. Ainsi, l’ouverture d’une procédure de conciliation d’une entreprise va être supplantée par une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire européen ouverte dans le même État. La procédure de sauvegarde est aussi affectée pour les différentes raisons citées ci-dessus.
La proposition clarifie ensuite les règles de compétence et améliore le cadre procédural pour la détermination de la compétence. Elle clarifie donc la notion de « centres d’intérêts principaux ». De plus, elle prévoit une gestion plus efficace des procédures secondaires, en supprimant la condition exigeant qu’elles soient des procédures de liquidation, et en étendant les exigences de coopération aux juridictions compétentes. Ainsi, les juridictions pourront refuser l’ouverture d’une procédure lorsqu’elle n’est pas nécessaire à la protection des intérêts des créanciers locaux. Une procédure de liquidation pourra être mise de côté en vue de permettre à une procédure de sauvegarde d’aboutir à un plan de sauvegarde. La procédure de sauvegarde est dans l’intérêt des créanciers locaux si leur créance ne leur est pas inopposable, à cause d’un défaut d’information.
Le manque d’information est précisément ce que les législateurs souhaitent éviter par la mise en œuvre d’une obligation de publicité nationale. C’est pourquoi la proposition prévoit aussi une obligation de publicité des procédures et la mise en place d’un registre électronique accessible à tous pour la production des créances. De plus, elle prévoit l’interconnexion des registres nationaux d’insolvabilité sur lequel le bon fonctionnement des procédures transfrontières repose. Par conséquent, le débiteur ne pourra pas chercher à récupérer sa créance, qui lui est rendue inopposable dans les conditions prévues au sein de la règlementation de la procédure de sauvegarde, à cause de sa négligence.
Enfin, aucune règle ne concernait les groupes multinationaux d’entreprises, alors qu’un grand nombre de cas d’insolvabilité concerne ces groupes. La Commission propose une coopération et une communication entre les juridictions et les syndics des différentes procédures principales. De plus, elle permet aux syndics d’exiger la suspension des autres procédures liées et de proposer un plan de redressement ou de sauvegarde, pour les membres du groupe faisant l’objet ou non d’une procédure de cessation de paiements.
Ainsi, la procédure de sauvegarde est un instrument qu’il ne faut pas sous-estimer puisqu’elle permet, dès lors qu’elle est utilisée efficacement et que le débiteur agit à temps, non seulement d’éviter l’urgence des autres procédures collectives, mais aussi de restructurer l’entreprise. La restructuration est assurée par un des mesures législatives contraignantes qui encadrent la procédure. Son statut et ses avantages ne sont pas négligeables. La question d’une procédure de négociation ou de sauvegarde se pose dès les premières difficultés rencontrées par l’entreprise. Le débiteur devra prendre en compte la situation de l’entreprise afin d’analyser quel outil serait le plus utile et efficace au regard de la situation actuelle. La prévention de la faillite d’une entreprise est mise au premier plan.
Le droit de la faillite influence l’économie, c’est pourquoi les procédures de pré-insolvabilité ou hybrides sont mises en place, offrant un panel de possibilités aux chefs d’entreprise. L’Union Européenne les prend en compte dans sa proposition qui attend l’adoption finale par le Conseil et le Parlement courant 2014. La proposition, si elle était adoptée, améliorerait l’efficacité du cadre européen, liée aux priorités politiques actuelles de l’Union Européenne visant à favoriser la reprise économique, à assurer une croissance durable, à augmenter le taux d’investissement et à préserver l’emploi, telles que définies dans la stratégie Europe 2020. Elle contribuerait au « développement harmonieux et à la survie des entreprises », comme le prévoit l’initiative en faveur des PME et TPE « Small Business Act ».
La Commission Européenne a adopté des recommandations à Bruxelles le 12 mars 2014, a new approach to business failure and insolvency. Elle reconnaît qu’il est nécessaire de donner une seconde chance à l’entrepreneur, en vue de la restructuration de son affaire : « it is necessary to encourage greater coherence between the national insolvency frameworks in order to reduce divergences and inefficiencies which hamper the early restructuring of viable companies in financial difficulties and the possibility of a second chance for honest entrepreneurs, and thereby to lower the cost of restructuring for both debtors and creditors. Greater coherence and increased efficiency in those national insolvency rules would maximise the returns to all types of creditors and investors and encourage cross-border investment. Greater coherence would also facilitate the restructuring of groups of companies irrespective of where the members of the group are located in the Union ». De plus, la commission précise en son considérant (16) que, d’une part, cet encadrement légal devrait permettre aux débiteurs d’agir pour anticiper une cessation des paiements ; et que, d’autre part, la Commission prévient tout abus de la règlementation, en précisant que le débiteur devra être dans une situation financière telle qu’il lui sera difficile de ne pas aller vers une situation de cessation des paiements, sans une restructuration efficace de son entreprise. La Commission donne ici la condition originale pour l’ouverture de la procédure de sauvegarde française. N’oublions pas que cette condition première a été remplacée par une condition plus large avec la loi de modernisation de l’économie de 2008, autorisant le débiteur à ouvrir une procédure de sauvegarde dès lors qu’il est face à des « difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». La condition première restreignait trop le champ d’application de la procédure de sauvegarde, notamment en limitant le champ de prévision et d’action du débiteur. De ce fait, la Commission limite la fenêtre de tir de la procédure de sauvegarde, tout en souhaitant en assurer sa primauté sur les procédures d’insolvabilité proprement dites. Ceci démontre un paradoxe dans son objectif d’universalisation de la procédure de sauvegarde. Toutefois, le texte n’a toujours pas été adopté, et il fera peut-être l’objet d’un changement, notamment en vue d’assurer un élargissement des possibilités d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages et articles de presse :
Alain Leinhard, Delmas Procédures collectives, édition Dalloz 2014
Didier Prrachia, Procédures d'insolvabilités: point sur le règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000
Europa, vu le 26 janvier 2014,
European Commision, On a new approach to business failure and insolvency, Bruxelles, le 12 mars 2014, p. 3-4.
Etude Deloitte/Altares, Augmentation de défaillances en France à fin 2012 : les entreprises vont devoir accélérer leur mesures d’adaptation, le 21 mars 2013
Fabienne Jault-Seseke et David Robine, Procédure collective ouverte à l'étranger : l'application par le juge français de la loi étrangère à l'action révocatoire, p. 62-67
Fédération des Très Petites Entreprises, vu le 15 mars 2014,
http://www.ftpe-france.fr/71_p_37233/notation-europe.html
Jean-François Puget, La sauvegarde des entreprises, Les Echos, 26/07/2012
Laurent Le Loup, Procédure d’insolvabilité en Europe : nouvelle proposition, les Echos, 16/04/2013
Proposition du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilités : http://www.senat.fr/ue/pac/E7974.html
Rapport de la Commission au Parlement Européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, fait à Strasbourg le 12/12/2012, relatif à l’application du règlement (CE) n° 1346/2000
Règlement CE 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif aux procédures de solvabilité
Site des Greffes des Tribunaux de commerces : http://www.greffes.com/fr/statistiques/jugements-d-ouverture-de-procedure-collective, vu le 26 janvier 2014.
Sophie Laurence Roy Clémondot, Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive auprès des entreprises, Portail des PME, le 7 mars 2013.
Arrêts :
CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000
Com. 5 févr. 2002 (deux arrêts), n° 98-22.683 et n° 98-22.682, D. 2002. AJ 957
Affaire C-116/11 Brank Handlowy et Ryszard Adamiak c/ Christianapol sp Zoo, 2 mai 2012
Code de commerce : Livre VI des difficultés des entreprises
Mandat ad hoc : article L611-3
Procédure de sauvegarde : article L620-1 à L628-7
Redressement judiciaire : L631-1 à L631-22