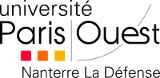Les redevances en matière de télécommunications et leur l'impact sur la concurrence : Les conséquences de l'arrêt de la CJUE du 12 juillet 2012, par Gabriela Rodriguez Arguijo et fadwa El Abdouli (avril 2014)
L’Organisation Mondiale du Commerce définit les télécommunications comme les services, publics ou privés, qui impliquent la transmission de bout en bout d’informations fournies par un client et les services ajoutant une « valeur » aux informations fournies par ce dernier en améliorant leur forme ou leur contenu[1].
Dans un contexte de globalisation tel que le nôtre et avec l’accroissement des échanges internationaux, il est nécessaire d’investir dans le sens du progrès technologique. En effet, les systèmes de télécommunications représentent aujourd’hui une passerelle indispensable entre les secteurs économiques, les marchés et les différentes zones géographiques.
L’Union Européenne a rapidement saisi les enjeux très importants de la matière et l’impact de son expansion toujours plus grande. Les télécommunications sont placées depuis quelques décennies au cœur même de l’économie et de la société de l’information. Émerge donc une nécessité, à défaut de l’harmoniser totalement, d’encadrer ce secteur afin d’éviter toute dérive de la part des entreprises cherchant à s’imposer sur le marché et également d’en permettre un développement optimal. L’Union Européenne a donc cherché à mettre en place un cadre favorable aux services de l’information.
Le corollaire de cette expansion est la mise en concurrence, de façon saine, des entreprises en ce sens que l’accès au marché des télécommunications ne doit pas être entravé. L’accès à de nouveaux opérateurs doit être permis, voire favorisé. Pour ce faire, il est nécessaire d’encourager la compétitivité des entreprises afin, d’une part, de favoriser l’innovation (ce qui est essentiel avec la globalisation croissante) et, d’autre part, afin d’ouvrir la porte à un plus grand choix d’offres et donc des prix réduits, profitant ainsi aux utilisateurs.
Dès les années 1980, Bruxelles se lance dans un projet d’harmonisation afin de créer un « continent connecté[2] » et prévenir toute restriction à la libéralisation des télécommunications.
La marche vers l’harmonisation, la libéralisation et la concurrence dans le domaine des télécommunications est lente. Des dispositions éparses sont adoptées jusqu’à la fin des années 1990, période qui voit alors l’adoption d’un cadre juridique plus cohérent à travers diverses directives[3] (notamment la directive 97/13/CE qui nous intéressera plus tard).
Une véritable refonte des réglementations préexistantes et encore trop peu consistantes intervient ensuite en 2002 avec l’adoption du Paquet Telecom. Ce Paquet Telecom comprend cinq directives posant un cadre juridique harmonisé en vue de favoriser la concurrence dudit secteur au travers de réglementations spécifiques.
Il est donc clair que l’Union Européenne cherche ici à allier concurrence et développement en délimitant un cadre juridique pertinent. Or, la concurrence implique nécessairement la rentabilité de l’entreprise. C’est ici qu’il faut ajouter une fonction à la réglementation européenne en la matière : cette dernière va, outre prévenir toutes pratiques anticoncurrentielles, également encadrer les pratiques voire dérives étatiques. Les États ont le pouvoir d’imposer des charges afin d’exploiter les réseaux de télécommunications aux entreprises. Or, ces charges vont avoir un impact plus ou moins important sur la viabilité de l’entreprise et donc, sur sa compétitivité. Par ce biais, les États peuvent donc avoir une influence considérable sur la concurrence.
En principe, ces problèmes sont réglés préalablement par les directives adoptées (notamment la directive « Autorisation », 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). Toutefois, dans la pratique, cela peut engendrer des complications.
Dans l'arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) analyse si les Etats membres de l’Union Européenne sont autorisés à imposer le paiement d'une redevance aux opérateurs qui exploitent des réseaux de télécommunications sans être titulaires des installations correspondantes, sur la base de l'article 13 de la directive « autorisation ».
Cet arrêt soulève des enjeux dans deux domaines : celui de la concurrence dans le secteur des télécommunications et celui de l'établissement par les Etats membres de charges financières (redevances) pesant sur les entreprises de ce secteur. À la lecture de cet arrêt, ces deux enjeux peuvent apparaître comme un antagonisme.
En prenant en considération les objectifs recherchés par la directive « autorisation », la CJUE a fait émerger des questions sur l'impact de certaines redevances sur la concurrence dans le domaine des télécommunications.
En ce sens, cet arrêt présente de l'intérêt pour les entreprises de télécommunications, car sa solution permettra d'alléger la charge financière qu'elles devaient supporter au sein des Etats membres. Mais en outre, elle peut représenter une porte ouverte à de nouvelles controverses : Les entreprises cherchant à maximiser leurs profits par tout moyen pourront être tentées d’effectuer des montages leur permettant d’échapper à toutes charges financières, même légitimes.
C’est pourquoi il convient d’analyser dans une première partie le conflit entre l'établissement de certaines charges pécuniaires aux entreprises de télécommunications et la concurrence dans ce secteur et, dans une seconde partie, la stimulation de la concurrence et la suppression de charges financières sur les opérateurs de télécommunications.
PARTIE I. Le conflit entre l'établissement de certaines redevances et la concurrence dans le marché des télécommunications
L'affaire commentée en l’espèce a mis en évidence l’existence d'un enjeu relatif à la conciliation de deux aspects : le processus de libéralisation du secteur des télécommunications instauré dans l'Union Européenne et la question de l'intérêt public au sein des Etats membres, y compris le pouvoir d'établir des charges fiscales et financières ainsi que de gérer l'utilisation de leur domaine public.
En l'occurrence, s'agissant de redevances instituées par des entités infra-étatiques espagnoles, une partie de la doctrine considère l'interprétation de la CJUE comme étant en quelque sorte contraire au respect du principe d'autonomie locale prévu dans les Traités de l'Union Européenne[4].
C'est ainsi que l’analyse de cette affaire implique l'examen de deux questions : d'une part, les charges financières et fiscales pesant sur le secteur des télécommunications (Section 1) et, d'autre part, les restrictions qui découlent du cadre réglementaire européen en vigueur, représenté par un ensemble de directives régulatrices du secteur (Section 2).
Section 1. Un secteur présentant un intérêt particulier pour les Etats membres : Un ensemble de charges disparate pesant sur les entreprises de télécommunications
L'importance du secteur des télécommunications dans l'économie des Etats s'est accrue pendant les dernières années (Paragraphe 1).
S'agissant d'un secteur directement lié à l'innovation et à l'investissement international, il est rapidement devenu une source d'obtention de recettes pour les Etats (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La nécessaire libéralisation du secteur des télécommunications
Les télécommunications, c’est-à-dire la transmission d’information à distance réunit l’internet, la téléphonie (mobile) et les systèmes de transmission numérique à haut débit.
La commercialisation de ces services en pleine expansion mène à une confrontation entre la recherche de profits de la part des entreprises du secteur (en maximisant les coûts) et la demande, croissante avec le développement technologique, des contribuables.
En ce sens, et comme pour toute activité commerciale, l’objectif concurrentiel et le besoin de compétitivité jouent donc un rôle très important dans la stratégie de développement des entreprises.
Or, cet objectif doit se concilier avec l’idée de concurrence prônée par l’Union Européenne, à savoir une concurrence libre, qui profite tant aux consommateurs qu’aux entreprises.
A l’heure de la mondialisation et de l’accroissement des flux commerciaux internationaux, les télécommunications représentent, plus que jamais, un enjeu crucial qu’il est nécessaire d’encadrer pour éviter toute dérive anticoncurrentielle au détriment, tant des opérateurs, que des utilisateurs.
L’Union Européenne a un intérêt stratégique et économique à permettre la libéralisation du secteur des télécommunications[5]. Traditionnellement apanage des États et des entreprises à la recherche de compétitivité, Bruxelles a rapidement compris l’importance d’un encadrement du secteur et de la promotion d’un accès fiable et rapide à toutes les composantes des télécommunications[6].
Les intérêts en présence (les entreprises qui souhaitent maximiser leurs profits et les particuliers qui souhaitent un accès fonctionnel, rapide et à moindre coût aux services proposés) peuvent, à certains égards, s’opposer dans la pratique. Afin de permettre aux entreprises d’accroître leur compétitivité et aux particuliers de disposer d’une utilisation optimale des ressources, il est nécessaire de mettre en place un cadre concurrentiel sain. Or, cela peut être contré par des pratiques à tendances oligopolistiques des entreprises : à la recherche de parts de marché de plus en plus importantes, elles n’hésitent pas à entraver la concurrence.
Les « entraves » à la concurrence peuvent prendre différentes formes : elles peuvent exister entre entreprises (notamment via des pratiques anti-concurrentielles) mais les politiques étatiques peuvent également avoir un impact sur celle-ci : c’est tout l’objet de la question posée par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 12 juillet 2012. Cet arrêt fait suite à une demande d’interprétation d’une disposition d’une des directives faisant partie du cadre d’harmonisation du secteur des télécommunications, en matière de charges et redevances pesant sur les entreprises. Les États Membres conservent une certaine marge de manœuvre en la matière, qui peut rapidement se révéler être attentatoire à la concurrence pour les sociétés.
La question de la viabilité économique des entreprises de télécommunications se pose alors, ainsi que la remise en question de certaines charges, parfois trop lourdes pesant sur ces dernières.
Paragraphe 2 : Des impôts et des redevances spécifiques pesant sur le secteur des télécommunications.
Outre les impôts applicables à tous les agents économiques, tels l'impôt sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises de télécommunications supportent un ensemble de charges financières et fiscales spécifiques à ce secteur dans plusieurs pays.
Ces charges, étant de nature très variable[7], correspondent en majorité à l'ensemble des relations juridiques que ces entreprises doivent établir avec les autorités des Etats à l'intérieur desquelles elles envisagent de développer leurs activités. En effet, lorsque les entreprises de télécommunications obtiennent une concession pour l'utilisation de radiofréquences, la relation juridique établie entre l'entreprise et l'Etat concerné implique le paiement de certaines charges pécuniaires.
Parmi cet éventail de charges, on trouve la redevance imposée pour l'utilisation de l'espace hertzien, qui présente une importance fondamentale[8]. Cette redevance est établie afin de procurer une exploitation optimale de l'espace hertzien, considéré comme étant un bien rare. Elle est généralement fondée sur la considération selon laquelle les titulaires de l'utilisation de radiofréquences réalisent des bénéfices économiques à partir de celle-ci, tout en empêchant que d'autres opérateurs utilisent et exploitent cette ressource.
Mais, de la même façon, les entreprises de télécommunications doivent payer des redevances ayant pour objet de couvrir les frais des activités des autorités nationales compétentes en matière de délivrance, de gestion, de contrôle et de mise en oeuvre du régime d'autorisations générales pour la fourniture de services de télécommunications[9]. Cette redevance est en vigueur dans plusieurs États de l'Union Européenne[10].
Par ailleurs, on trouve d'autres types de redevances payables en contrepartie de l'utilisation privative de certains biens du domaine public, par exemple, le sol et le sous-sol[11]. Cette utilisation privative du sol ou du sous-sol est réalisée par les entreprises de télécommunications afin d'y établir des installations ou des infrastructures[12]. Ces redevances, généralement de type local, représentent une source importante d'obtention de recettes pour le budget des entités locales[13].
Il est possible de constater que cet ensemble de charges pesant sur les entreprises de télécommunications sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur leur capacité financière et donc, d'investissement.
Section 2. Un cadre européen délimitant l'établissement des charges pesant sur les entreprises de télécommunications
Les télécommunications sont aujourd’hui au cœur même de l’économie.
L’Union Européenne l’a bien compris et, très rapidement, a mis en place un cadre réglementaire promoteur de concurrence (Paragraphe 1). L’une des questions cruciales posée par la délimitation du cadre européen est celle de l’établissement de charges pécuniaires pesant sur les entreprises de télécommunications : outre la viabilité de l’entreprise, elles influent particulièrement sur sa compétitivité et sur son égal accès au marché (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un cadre européen favorisant la concurrence du secteur des télécommunications
L’expansion croissante des télécommunications depuis deux décennies a poussé l’Union Européenne à délimiter les contours de ce secteur ainsi que les enjeux qu’il soulève. Dès les années 1980, des programmes de recherches ont donc été lancés avec pour but une coopération européenne en matière scientifique et technologique.
En matière de télécommunications, le premier pas est franchi en 1984 avec le programme stratégique européen de recherche et de développement relatif aux technologies de l’information (appelé programme Esprit[14]). La deuxième étape est la publication en 1987 d’un livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements de télécommunications par la Commission Européenne[15].
Puis, la volonté d’harmoniser les politiques de télécommunications au sein de l’Union s’intensifie dans les années 1990 et ce, autour de 4 axes principaux : « la création d'un marché unique des équipements et des services des télécommunications; la libéralisation des services de télécommunication; le développement technologique du secteur, aidé par la recherche européenne; et le développement équilibré des régions de l'Union à l'aide des réseaux transeuropéens de télécommunication.[16] ».
Le but de l’Union est évidemment d’encadrer le développement des télécommunications de façon à promouvoir au maximum la concurrence, le tout profitant à la fois aux consommateurs, aux entreprises et à l’économie européenne dans sa globalité.
Autrefois domaine réservé des entreprises aux pratiques quelque peu oligopolistique, Bruxelles décide alors d’accompagner l’expansion du secteur des télécommunications, en délivrant une réglementation plus restrictive mais favorisant les avancées technologiques et l’entrée de nouveaux arrivants sur le marché[17].
Les avancées technologiques se multipliant à grande vitesse, il n’est pas aisé de faire concorder tous les intérêts en présence, surtout à la vue des disparités de politiques concurrentielle des États. D’où la nécessité d’harmoniser purement et simplement le secteur.
L’une des étapes cruciales de l’harmonisation du secteur des télécommunications intervient en 2002, lors de l’adoption de cinq directives, plus connues sous le nom de Paquet Telecom (directive Cadre, directive Autorisation, directive Accès, directive Services Universels et enfin la directive Vie privée et communication électronique). Il s’agit de la refonte du cadre réglementaire du secteur, visant tous les aspects des télécommunications et permettant en principe une concurrence plus saine.
En matière de charges et redevances particulièrement, l’Union Européenne a procédé à une harmonisation totale, en ce sens que la Cour de Justice de l’Union Européenne a affirmé dans l’arrêt Vodafone España qui nous concerne en l’espèce qu’un État Membre ne peut donc imposer d’autres charges ou redevances que celles mentionnées dans les textes européens.
Il semble donc ici, selon l’interprétation jurisprudentielle des textes, que la marge de manœuvre des États est limitée. Or, il faut garder à l’esprit que la promotion d’une concurrence saine est l’objectif premier du paquet télécom.
Il s’agit donc de proscrire toute manœuvre d’un État qui, volontairement ou involontairement, viserait à freiner la concurrence et ainsi, la possibilité des utilisateurs d’avoir accès à des services compétitifs de façon équitable.
Paragraphe 2 : Les directives 97/13/CE et 2002/20 CE et l'établissement de charges pécuniaires au secteur des télécommunications
Les directives de l'Union Européenne en matière de télécommunications contiennent des dispositions qui tendent à restreindre l'établissement de charges pécuniaires pesant sur les opérateurs de télécommunications, afin d'éviter que celles-ci puissent entraver le libre accès au marché.
En principe, les directives de l'Union Européenne en matière de télécommunications offrent la possibilité, pour les Etats membres, d'établir des redevances qui visent le financement des activités des autorités nationales régulatrices du secteur ainsi que des redevances ayant pour finalité de garantir une utilisation optimale de biens rares par les opérateurs de télécommunications, tel l'espace hertzien.
Dans ce contexte, la directive 97/13 a signalé, dans l'article 11, les taxes et les redevances qui pourraient être applicables aux licences individuelles. En ce qui concerne les redevances demandées pour le financement des activités des autorités nationales compétentes en matière de télécommunications, la directive 97/13, dans l'article 11.1, a signalé les charges pécuniaires qui pourraient être imposées au sujet des procédures d'octroi des autorisations. Ces charges pécuniaires, appelées « taxes » dans le texte en français, doivent avoir « (…) pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences individuelles applicables (...) »[18]. À ce sujet, la CJUE a signalé que « Le cadre commun que la directive 97/13 vise à mettre en place serait privé d’effet utile si les États membres étaient libres de déterminer les charges fiscales que doivent supporter les entreprises du secteur. Ainsi, les États membres ne peuvent percevoir d’autres taxes ou redevances au titre des procédures d’autorisation que celles prévues par cette directive »[19].
L'article 12 de la Directive 2002/20/CE a repris le contenu de l'article 11.1 de la Directive 97/13. Cet article porte sur les « taxes administratives » qui couvrent les coûts occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale. À l'occasion de l'interprétation de la portée de cet article, la CJUE a précisé que celle-ci se trouve dans la procédure d'autorisation générale permettant d'accéder au marché des services de communications électroniques. De ce fait, les Etats membres peuvent établir des impositions et charges pécuniaires diverses, pourvu que celles-ci ne soient pas liées à la procédure d'autorisation générale[20].
D'autre part, l'article 11.2 de cette directive, a établi que « (…) dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource. »[21].
L'article 13 de la Directive de 2002, dispose que les Etats membres ont la possibilité d'établir trois redevances : Celle due pour le droit d'utilisation des fréquences radioélectriques, celle due pour l'utilisation de numéros et celle ayant trait aux droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés[22]. Ainsi, ces redevances ont trait à « trois cas spécifiques », qui sont liés, chacun, à l'octroi d'un droit précis[23].
De cette manière, on constate que les directives de l'Union Européenne restreignent les charges pécuniaires pouvant être demandées aux opérateurs du secteur des télécommunications. Cependant, le pouvoir d'imposer appartenant aux Etats reste intact, étant donné que ceux-ci peuvent établir des impositions qui ne correspondent pas aux faits précisés par ces directives : la procédure d'autorisation générale (taxes administratives) et l'utilisation optimale de bien rares (des redevances pour l'utilisation de radiofréquences et de numéros et des redevances pour le droit de mettre en place des ressources sur ou sous de biens publics).
L'arrêt du 12 juillet 2012 porte sur ces dernières, à savoir les redevances imposées par les municipalités espagnoles et leur conformité avec les termes de l'article 13 de la Directive 2002/20/CE.
Les entreprises Vodafone España et France Telecom España ont argumenté que, selon le texte de l'article 13 de la Directive « Autorisation », l'établissement de redevances serait limité à la mise en place de ressources, c'est-à-dire, à l'installation de ces ressources, et non pas à la seule utilisation de ces installations. En ce sens, les entreprises de télécommunications ont contesté les redevances demandées par les municipalités espagnoles, en signalant qu'elles ne réalisent pas elles-mêmes une utilisation privative du domaine public car les activités de téléphonie portable utilisent les réseaux d'autres entreprises pour l'interconnexion. Dans cette perspective, les entreprises qui utilisent les installations appartenant à d'autres opérateurs ne pourraient pas être considérées comme étant les sujets passifs de la redevance pour utilisation privative du domaine public.
PARTIE II. La stimulation de la concurrence et la suppression de charges financières sur les opérateurs de télécommunications
L’Union Européenne dont l’un des objectifs principaux demeure la réalisation et le bon fonctionnement d’un marché sans frontières intérieures doit veiller à ce que les entités situées sur le territoire de l’un de ses États Membres bénéficient d’un traitement équitable. En matière de télécommunications, il s’agit de permettre l’égale opportunité des agents économiques, afin donc de permettre l’entrée sur le marché de nouveaux arrivants, stimulant ainsi la concurrence et développant une offre plus intéressante pour les utilisateurs, limitée par le fait que les télécommunications se basent sur l’utilisation de ce que l’on appelle des ressources rares (Section 1).
C'est ainsi que l'arrêt de la CJUE du 12 juillet 2012, a eu comme conséquence la suppression de certaines charges financières établies par un Etat membre qui étaient non conformes au Droit Européen, dans le sens où elles pouvaient entraver l'accès au marché de télécommunications (Section 2).
Section 1. Un traitement équitable des différents agents économiques et la stimulation de la concurrence
L’analyse de l’arrêt qui nous intéresse en l’espèce repose essentiellement sur les dispositions de l’article 13 de la directive autorisation[24]. Cet article dispose que « Les États membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").[25] ».
Il convient de dégager plusieurs points fondamentaux de ces quelques lignes. La directive accorde une certaine marge de manœuvre aux États dans l’imposition de charges pécuniaires reposant sur les entreprises de télécommunications. Mais avec cette compétence vient une responsabilité : celle de vérifier que ces charges respectent des critères objectivement délimités par le droit européen.
La CJUE a réalisé ainsi une interprétation minutieuse de l'article 13 de la directive « autorisation », qui a reposé sur l'objectif de libéralisation du secteur des télécommunications (Paragraphe 1) et la recherche d'une utilisation optimale de ressources rares (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L’interprétation de l’article 13 de la directive « autorisation » dans l’arrêt de la CJUE du 12 juillet 2012
Le domaine public local représente un bien rare découlant du fait que son utilisation nécessite une gestion particulière. D'après la doctrine, il s'agit d'une ressource limitée qui remplit plusieurs fonctions à la fois. Cela se traduit par une concurrence entre les différents types d’utilisations du même bien, chaque utilisation étant réalisée en vertu d'un statut juridique différent. Cette concurrence crée des conflits entre ces diverses utilisations, ce qui justifie l'établissement de mesures relatives à l'urbanisme ou bien, aux pouvoirs de police sur le domaine public[26].
Les opérateurs de télécommunications qui utilisent les installations ne réalisent pas l'utilisation privative du domaine public local. Considérer que ceux-ci utilisent de même le domaine public, impliquerait demander le paiement d'une redevance à deux sujets passifs, pour l'utilisation simultanée d'un même bien.
L'interprétation de la CJUE s’est fondée sur la notion de « ressources » et d’ « installation ». D'après les conclusions de l'Avocate Générale dans cette affaire[27], ces deux termes feraient allusion aux infrastructures qui permettent la réalisation des communications électroniques. En ce sens, ces termes désigneraient les « installations matérielles nécessaires à la transmission et à la réception d’informations à distance. »[28]. Celles-ci seraient placées dans le domaine public local des municipalités. En conséquence, la CJUE a estimé que seul le titulaire du droit de mettre en place ces infrastructures, qui est le propriétaire de ces ressources installées sur le domaine public local, pourrait être assujetti au paiement de la redevance[29].
Cette première partie de l'analyse porte, ainsi, sur la question de la mise en place des ressources. En effet, l'article 13 de la Directive 2002/20/CE fait allusion à la mise en place d'installations nécessaires pour les activités de télécommunications. Cette mise en place implique une occupation de biens du domaine public qui réduit leur disponibilité et, par conséquent, la possibilité d'être utilisés par d'autres entreprises. En ce sens, ces « droits de passage », octroyés à des opérateurs de télécommunications pour qu'ils mettent en place des installations, doivent être gérés de manière optimale.
Nous voyons ainsi que ce premier argumentaire porte exclusivement sur la question de la mise en place des installations, qui mène à celle de l'occupation privative du domaine public et à la détermination du sujet passif de la redevance.
Cet argument a permis d’enchainer ensuite sur la question de la concurrence dans le secteur.
Paragraphe 2 : L'enjeu de l'utilisation des ressources rares
La CJUE a signalé que l'article 13 de la Directive 2002/20/CE devrait être interprété de manière harmonieuse avec les objectifs énoncés à l’article 8 de la directive « cadre » des télécommunications[30]. Cet article prévoit que les autorités nationales doivent assurer que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des télécommunications.
D'après l'arrêt de la CJUE du 12 juillet 2012, l'objectif de l'article 8 de la Directive-cadre est assuré lorsqu'il existe une égalité de chances entre les opérateurs économiques.
En ce sens, cette égalité d'opportunités ne serait pas assurée lorsque les utilisateurs d'installations de télécommunications supporteraient une double charge financière. Ainsi, l'Avocate Générale explique que « (…) l’égalité des chances n’est pas assurée lorsque les entreprises propriétaires de ressources utilisées pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques peuvent récupérer la redevance payée pour les droits de les mettre en place sur le prix négocié avec les opérateurs qui utilisent ces ressources si, comme cela est le cas dans la procédure au principal, ces opérateurs doivent aussi payer aux municipalités une redevance pour cette utilisation. Dans ces conditions, la concurrence est faussée parce que l’utilisateur des ressources supporte une double charge financière. Cela pourrait dissuader les opérateurs d’entrer sur le marché et conduire à une augmentation des prix pour les consommateurs. »[31].
Ce critère, qui cherche à éviter une double imposition de charges pécuniaires aux entreprises de télécommunications, se trouve en conflit avec la législation et la jurisprudence interne de l'Espagne. En effet, la jurisprudence du Tribunal Suprême de ce dernier avait défini le concept de « l'exploitation spéciale » du domaine public, comme étant « Une utilisation au profit d'une personne, qui n'implique pas nécessairement l'occupation effective et l'exclusion de l'utilisation du bien de domaine public par d'autres personnes »[32].
Section 2. La conséquence de la suppression de certaines charges financières non conformes au Droit Européen pesant sur les entreprises de télécommunications
La solution de l’arrêt Vodafone España, même si elle interprète et clarifie l’une des disposition de la directive « autorisation », comporte tout de même des risques en ce sens qu’elle place la concurrence comme objectif primordial à atteindre, ce qui peut inspirer des comportements abusifs aux entreprises (Paragraphe 1). En outre, elle ouvre la porte à de possibles contestations de redevances et ainsi, une probable cascade de litiges (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Un risque pour la concurrence
La décision de la CJUE a ainsi privilégié la question de la concurrence dans le secteur. L'Avocate Générale a mentionné dans ses conclusions « la nécessité pour les États membres d’encourager le partage des ressources et des biens fonciers[33].
En ce sens, ces préoccupations, et la stimulation de la concurrence pourraient être en quelque sorte faussées lorsque des entreprises utilisatrices d'une installation de télécommunications et les entreprises propriétaires de ces installations (et donc, titulaires du « droit de passage » respectif) appartiennent à un même groupe. C'est ainsi le cas des filiales et des sociétés mères, qui possèdent des personnalités juridiques distinctes. Or, ces mêmes entreprises peuvent être tentées d’opérer des montages juridiques et fiscaux afin d’échapper à l’imposition de certaines charges ou encore en faussant la concurrence en accordant le droit d’utiliser leurs installations presque exclusivement à leurs filiales et/ou succursales, accaparant ainsi les installations. Cela peut créer des abus de position dominante, au détriment d’entreprises souhaitant entrer ou se développer sur le marché des télécommunications.
En outre, cela va à l’encontre des règles fondamentales de protection de la concurrence mises en place au sein de l’Union Européenne.
Dans ces cas, le but recherché, c'est-à-dire, la stimulation de la concurrence et le partage des ressources de télécommunications, pourrait être faussé[34].
Or, la concurrence est essentielle dans ce secteur afin d’offrir un service de qualité aux utilisateurs et favoriser un marché sain. Ainsi, malgré les « protections » mises en place par l’Union Européenne via des règlementations restrictives, l’arrêt du 12 juillet 2012 risque de donner des idées à certaines entreprises qui voudraient contester certaines charges qu’elles ont, jusqu'à présent, supportées. Animées par leur volonté vénale, les entreprises pourraient donc tenter, malgré de potentielles sanctions, de corrompre l’équilibre concurrentiel de ce secteur.
Paragraphe 2. Une jurisprudence pouvant entraîner une cascade de nouveaux litiges.
L'interprétation de la CJUE a eu comme effet que le Tribunal Suprême Espagnol ait annulé dans les sentences du 10 et du 15 octobre 2012, les arrêtés municipaux de Santa Amalia, de Tudela et de Torremayor[35]. Le Tribunal a proclamé que les arrêtés municipaux qui établissaient le paiement de ces redevances étaient nuls.
L'une des conséquences de l'interprétation de la CJUE au sujet de ces redevances, consiste en l'ouverture d’une possibilité de contester des redevances analogues établies par des arrêtés municipaux en Espagne. La doctrine signale qu'au moins 1300 municipalités ont établi ce genre de redevances[36]. De ce fait, les municipalités devront retirer ces redevances ou modifier les termes des arrêtés qui les établissent[37].
Or, les choses risquent de ne pas se passer aussi facilement car la suppression de cette charge constitue une perte d’argent du point de vue des Etats membres.
En outre, les contestations des entreprises seront à la fois une perte d’argent mais également de temps avec des procédures longues et coûteuses.
Les autorités infra-étatiques pourraient même, on peut l’imaginer, invoquer le fait que ces charges représentent une source d’argent nécessaire à l’intérêt public[38].
En principe, l’arrêt du 12 juillet 2012 doit faire jurisprudence puisqu’il interprète une disposition de droit préexistante. Malheureusement, ça n’empêchera probablement pas les entreprises de tenter l’ouverture de nouveaux litiges, ayant pour but de déclarer la nullité d'autres charges établies par les Etats membres, susceptibles d'être perçues comme étant contraires au Droit de l'Union Européenne.
Si une telle nullité est déclarée, des intérêts essentiels des Etats membres pourraient être affectés. C'est ainsi que des questions comme l'autonomie financière des collectivités locales et la protection de l'intérêt public pourraient être touchées.
Conclusion
Il ressort de l’arrêt du 12 juillet 2012 que la problématique des charges pécuniaires pesant sur les entreprises de télécommunications et celle de la concurrence entre entreprises sont intrinsèquement liées, puisque la première a nécessairement un impact de taille sur la seconde en déteminant si une entreprise est rentable ou non et si les charges pesant sur elle ont pour conséquence de diminuer sa compétitivité ou son accès au marché.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a toutefois bien saisi l’enjeu de cette compétitivité : permettre une concurrence plus saine, une meilleure satisfaction des utilisateurs via un choix d’offres plus élevé et ainsi, un impact bénéfique sur l’économie européenne en général.
La question de l’interprétation de l’article 13 de la directive « Autorisation» en l’espèce et plus généralement, l’impact de la compétitivité des entreprises en matière de télécommunications est donc d’intérêt général. L’Union Européenne l’a bien compris et continue son chemin vers la libéralisation totale du secteur des télécommunications.
A l’heure actuelle, l’initiative la plus récente date de 2013 et est une proposition de la Commission[39] pour un marché unique des télécommunications prévoyant des dispositions censées placer l’Europe au rang de numéro un mondial en matière numérique (dispositions telles que la simplification des mesures administratives pour les opérateurs, octroi de nouveaux droits, etc).
La marche longue et laborieuse vers l’harmonisation du secteur des télécommunications est donc, a priori, sur le point de se terminer.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
CHINCHILLA MARIN, Carmen (Coord)., Telecomunicaciones. Estudios sobre dominio público y propiedad privada, Marcial Pons, Madrid, 2000, 407pp.
LAGO MONTERO, José María et GUERVÓS MAILLO, María de los Ángeles, Tasas locales: Cuantía, Marcial Pons, Madrid, 2004,182pp.
MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit administratif des biens. Cours, Thèmes de réflexion, Commentaires d'arrêts avec corrigés, 7ème édition, Montchrestien, Paris, 2012, 722pp.
MOUSSIS, Nicholas, Accès à l’Union Européenne : droit, économie, politiques, Rixensart, 19ème édition, 2011.
PEZ, Thomas, Le domaine public hertzien. Attribution et exploitation des fréquences radioélectriques, LGDJ, Paris, 2011, 209pp.
RUIZ GARIJO, Mercedes, Problemas actuales de las tasas, Première édition, éditorial Lex Nova, Valladolid, 2002, 335 pp.
Articles
ARMENGOL I FERRER, Ferrán, « Liberalización de las telecomunicaciones y autonomía locala propósito de la jurisprudencia sobre tasas locales y telefonía móvil (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11, Vodafone España y France Telecom España) ». Disponible en : http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1121570.
CAVA VALENCIANO, Almudena, MARTINEZ DE LA RIVA, Santiago Peiro, « La telefonía móvil y la tasa por ocupación o aprovechamiento del dominio público local», Tributos Locales, numéro 100, abril-mayo 2011, pp. 31-49.
CHINCHILLA MARIN, Carmen, « El régimen juridico de las telecomunicaciones : Del servicio publico y la gestion en monopolio al servicio de interés general prestado en régimen de competencia », en FERNANDEZ RUIZ, Jorge, Derecho administrativo. Memoria del Congreso Internacional de culturas y sistemas juridicos comparados, IIJ-UNAM, México, 2005, pp. 175-196.
GUERVOS MAILLO, María Angeles, « Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12-VII-2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11y C-58/11 (Vodafone España, S.A./Ayuntamiento de Santa Amalia y Ayuntamiento de Tudela y France Telecom Espana, S.A./ Ayuntamiento de Torremayor) (DOUE 2012/C 287/13, de 22-IX-2012) », Reseñas de Jurisprudencia (Julio-diciembre 2012), Ars Iuris Salmanticensis, volume I, junio 2013, pp. 247-249.
PAREJO ALFONSO, Luciano, « Algunas reflexiones sobre la naturaleza y el alcance del derecho a la ocupación del dominio público local por redes públicas de telecomunicaciones », en FERNANDEZ RUIZ, Jorge, Derecho administrativo. Memoria del Congreso Internacional de culturas y sistemas juridicos comparados, IIJ-UNAM, México, 2005, pp. 209-253.
Rapports
COMMISSION EUROPÉENNE, Communication de la Commission au Parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions sur le marché unique des télécommunications, COM(2013) 634, 11 octobre 2013.
COMMISSION EUROPÉENNE, Livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements de télécommunications, COM(87) 290, juin 1987.
CONSEIL D'ETAT, Redevances pour service rendu et pour l'occupation du domaine public, La Documentation Française, Paris, 2002, 104pp.
OCDE, A review of market openness and trade in Telecommunications, OCDE Digital Economy Papers, No. 43, OCDE Publishing, 22pp.
OCDE, Competition in telecommunications, OCDE Publishing, Paris, 1996.
OCDE, Local telecommunication competition : Developments and policy issues, OCDE Publishing, Paris, 1996, 58pp.
UNION EUROPEENNE, The institutional framework for the regulation of telecommunications and the application of the EC competition rules, Office for official publications of the European communities, Luxembourg, 1996, 217pp.
UNION EUROPEENNE, Guide de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne dans le domaine des télécommunications, Office des publications de l'Union Européenne, Luxembourg, 2010, 255pp.
Directives de l'Union Européenne
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »).
Directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.
Directive 2002/20/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »).
Jurisprudence de l'Union Européenne
CJUE, Vodafone Malta Ltd et Mobisle Communications Ltd c. Avukat Generali et autres, Affaire C-71/12, 27 juin 2013.
CJUE, Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA c. État Belge, Affaire C-375/11, 21 mars 2013.
CJUE, Arrêt dans les affaires jointes C-55/11, C-57/11 et C-58/11, Vodafone España SA / Ayuntamiento de Santa Amalia et Ayuntamiento de Tudela. France Telecom España SA / Ayuntamiento de Torremayor, 12 juillet 2012.
Conclusions de l'Avocat Général, Mme. Eleanor Sharpston, présentées le 22 mars 2012. Vodafone España SA c. Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), et France Telecom España c. Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11).
CJUE, Telefónica de España SA c. Administración del Estado, Affaire C-284/10, 21 juillet 2011.
CJUE, Telefónica Móviles España SA c. Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Affaire C‑85/10, 10 mars 2011.
Autres :
BARROSO JOSÉ MANUEL, Discours sur l’état de l’Union, 2013.
COMMISSION EUROPÉENNE, Proposition de la Commission sur le marché unique des télécommunications : un grand pas en avant, IP/13/828, Bruxelles, 11 septembre 2013, disponible sur : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-828_fr.htm
JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Programme Esprit, 85/C 238/03, 19 septembre 1985, disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1985:238:0003...
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, définition des télécommunications
de base et des services à valeur ajoutée, disponible sur :
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/telecom_f/telecom_coverage_f.htm
Site de la Commission Européenne pour le Digital Agenda – Europe 2020, disponible sur : http://ec.europa.eu/digital-agenda/
[1] ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, Définition des télécommunications de base et des services à valeur ajoutée. http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/telecom_f/telecom_coverage_f.htm.
[2] JOSÉ MANUEL BARROSO, Discours sur l’état de l’Union, 2013.
[3] OCDE, Competition in telecommunications, OCDE Publishing, Paris, 1996. pp. 61-64.
[4] ARMENGOL I FERRER, Ferrán, « Liberalización de las telecomunicaciones y autonomía local a propósito de la jurisprudencia sobre tasas locales y telefonía móvil (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11, Vodafone España y France Telecom España) ». Disponible en : http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1121570.
[5] COMMISSION EUROPÉENNE, Communication de la Commission au Parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions sur le marché unique des télécommunications, COM(2013) 634, 11 octobre 2013.
[6] UNION EUROPEENNE, The institutional framework for the regulation of telecommunications and the application of the EC competition rules, Office for official publications of the European communities, Luxembourg, 1996, pp. 61-71.
[7] Par exemple, en France, la contribution au fonds de réaménagement du spectre pose des controverses. CONSEIL D'ETAT, Redevances pour service rendu et pour l'occupation du domaine public, La Documentation Française, Paris, 2002, p. 61.
[8] CJUE, Telefónica Móviles España SA c. Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Affaire C‑85/10, 10 mars 2011. OCDE, Local telecommunication competition : Developments and policy issues, OCDE Publishing, Paris, 1996, p. 53.
[9] La CJUE s'est déjà prononcée sur ces redevances : Arrêt de la CJUE du 21 juillet 2011, Affaire C-284/10, Telefónica de España SA c. Administración del Estado. CJUE, Vodafone Malta Ltd et Mobisle Communications Ltd c. Avukat Generali et autres, Affaire C-71/12, 27 juin 2013.
[10] En Espagne : Real Decreto 1750/1998, de 31 de julio, por el que se regulan las tasas establecidas en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. En France : Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques. Sur les problématiques que posent ces redevances en France, voir : PEZ, Thomas, Le domaine public hertzien. Attribution et exploitation des fréquences radioélectriques, LGDJ, Paris, 2011, p. 137.
[11] Voir à ce sujet : MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit administratif des biens. Cours, Thèmes de réflexion, Commentaires d'arrêts avec corrigés, 7ème édition, Montchrestien, Paris, 2012, 722pp.
[12] Voir le cas particulier de l'Espagne à ce sujet : CHINCHILLA MARIN, « El derecho a la ocupación del dominio público y de la propiedad privada necesarios para el establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones », en CHINCHILLA MARIN, Carmen (Coord)., Telecomunicaciones. Estudios sobre dominio publico y propiedad privada, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 119-125.
[13] Ceci est particulièrement vrai dans le cas des municipalités espagnoles. ARMENGOL I FERRER, Ferrán, Op. Cit. Disponible sur : http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1121570.
[14] JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Programme Esprit, 85/C 238/03, 19 septembre 1985, disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1985:238:0003:0003:FR:PDF
[15] COMMISSION EUROPÉENNE, Livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements de télécommunications, COM(87) 290, juin 1987.
[16] MOUSSIS, Nicholas, Accès à l’Union Européenne : droit, économie, politiques, Rixensart, 19ème édition, 2011, disponible sur :
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/17/03/06/index.tkl?lang=fr&s=1&e=10.
[17] OCDE, A review of market openness and trade in Telecommunications, OCDE Digital Economy Papers, No. 43, OCDE Publishing, pp. 7-11.
[18] « Article 11. Taxes et redevances applicables aux licences individuelles.
1. Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles. ». Article 11.1 de la Directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.
[19] Arrêts du 18 juillet 2006, Nuova società di telecomunicazioni, Affaire C-339/04. Arrêt du 21 juillet 2011, Affaire C-284/10, Telefónica de España SA c. Administración del Estado.
[20] « L’article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les opérateurs offrant des services de téléphonie mobile sont redevables d’un droit dit d’«accise» correspondant à un pourcentage des paiements qu’ils perçoivent auprès des utilisateurs de ces services, à condition que le fait générateur de celui-ci ne soit pas lié à la procédure d’autorisation générale permettant d’accéder au marché des services de communications électroniques, mais soit lié à l’utilisation des services de téléphonie mobile fournis par les opérateurs, et qu’il soit supporté en définitive par l’utilisateur de ces services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. » CJUE, Vodafone Malta Ltd et Mobisle Communications Ltd c. Avukat Generali et autres, Affaire C-71/12, 27 juin 2013.
[21] Article 11.2 de la Directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.
[22] « Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’) ». Article 13 de la Directive 2002/20/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»).
[23] Point 48 des Conclusions de l'Avocat Général, Mme. Eleanor Sharpston, présentées le 22 mars 2012. Vodafone España SA c. Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), et France Telecom España c. Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11).
[24] Directive relative à l’autorisation de réseaux et de communications électroniques dite directive « autorisation », 2002/20/CE, 7 mars 2002.
[25] Ibid., article 13.
[26] PAREJO ALFONSO, L. “Algunas reflexiones sobre la naturaleza y el alcance del dominio público local por redes de telecomunicaciones” en QUADRA-SALCEDO, T. Aspectos jurídicos de las telecomunicaciones, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003, p. 200-202. Cité par ARMENGOL I FERRER, Ferrán, Op.Cit.
[27] Point 52 des Conclusions de l'Avocat Général, Mme. Eleanor Sharpston, présentées le 22 mars 2012. Vodafone España SA c. Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), et France Telecom España c. Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11).
[28] Ibidem.
[29] Il faut signaler que la doctrine espagnole a signalé, à plusieurs reprises, l'importance de déterminer de manière précise le sujet passif des redevances. RUIZ GARIJO, Mercedes, Problemas actuales de las tasas, Première édition, éditorial Lex Nova, Valladolid, 2002, 335 pp. LAGO MONTERO, José María et GUERVÓS MAILLO, María de los Ángeles, Tasas locales: Cuantía, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 24.
[30] Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.
[31] Point 63 des Conclusions de l'Avocat Général, Mme. Eleanor Sharpston, présentées le 22 mars 2012. Vodafone España SA c. Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), et France Telecom España c. Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11).
[32] CAVA VALENCIANO, Almudena, MARTINEZ DE LA RIVA, Santiago Peiro, « La telefonía móvil y la tasa por ocupación o aprovechamiento del dominio público local», Tributos Locales, numéro 100, abril-mayo 2011, p. 49.
[33] Article 12, Paragraphe 1, de la Directive « cadre ». Point 64 des Conclusions de l'Avocat Général, Mme. Eleanor Sharpston, présentées le 22 mars 2012. Vodafone España SA c. Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), et France Telecom España c. Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11). Ce partage d'infrastructures est encouragé par la législation espagnole en matière de télécommunications. CHINCHILLA MARIN, Carmen, « El régimen juridico de las telecomunicaciones : Del servicio publico y la gestion en monopolio al servicio de interés general prestado en régimen de competencia », en FERNANDEZ RUIZ, Jorge, Derecho administrativo. Memoria del Congreso Internacional de culturas y sistemas juridicos comparados, IIJ-UNAM, México, 2005, p. 195.
[34] Point 64 des Conclusions de l'Avocat Général, Mme. Eleanor Sharpston, présentées le 22 mars 2012. Vodafone España SA c. Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), et France Telecom España c. Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11).
[35] Affaire 1085/2010 du Tribunal Suprême Espagnol. ARMENGOL I FERRER, Ferrán, Op.Cit. Disponible sur : http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1121570.
[36] GUERVOS MAILLO, María Angeles, « Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12-VII-2012, asuntos acumulados C-55/11, C-57/11y C-58/11 (Vodafone España, S.A./Ayuntamiento de Santa Amalia y Ayuntamiento de Tudela y France Telecom Espana, S.A./ Ayuntamiento de Torremayor) (DOUE 2012/C 287/13, de 22-IX-2012) », Reseñas de Jurisprudencia (Julio-diciembre 2012), Ars Iuris Salmanticensis, volume I, junio 2013, p. 248.
[37] Ibid., p. 249.
[38] En Espagne, la doctrine juridique signale la controverse actuelle entre le processus de libéralisation du secteur des télécommunications et les compétences des autorités locales. PAREJO ALFONSO, Luciano, « Algunas reflexiones sobre la naturaleza y el alcance del derecho a la ocupación del dominio público local por redes públicas de telecomunicaciones », en FERNANDEZ RUIZ, Jorge, Derecho administrativo. Memoria del Congreso Internacional de culturas y sistemas juridicos comparados, IIJ-UNAM, México, 2005, pp. 209-214.
[39] COMMISSION EUROPÉENNE, Communiqué de presse - Proposition de la Commission sur le marché unique des télécommunications : un grand pas en avant, IP/13/828, Bruxelles, 11 septembre 2013.