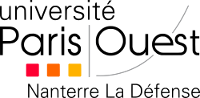"Les Chaises" dâEugène Ionesco mis en scène par Luc Bondy au ThÊâtre des Amandiers

Il est des jours qui se teintent parfois dâune tristesse infinie. Chaque chose que lâon regarde, que lâon ĂŠcoute, que lâon touche, que lâon sent ; toute la matière sensible ; verse dans lâesprit un ocĂŠan de larmes sans que lâon sache en expliquer la raison. La logique elle-mĂŞme â habituellement rassurante â ne peut ĂŠchapper Ă lâimmense absurditĂŠ de cette tristesse. Nous sommes dans lâindicible ; et dĂťt-on ĂŠcrire Ă ce propos une encyclopĂŠdie â une Ĺuvre sans fin â rien dans lâexpression de ce langage ne pourrait ĂŠtancher lâinfime sensation originelle qui se perdrait alors dans la mythologie de nos propres souvenirs.
Je pense quâil est essentiel, si je veux ĂŠcrire sur quelque chose, de ne pas oublier que cette chose existera dans le texte â Ă la lecture dâautrui qui sâen fera des images â seulement par la mĂŠdiation de ma propre conscience. Munch peignait les paysages de son pays dans leur plus grande vĂŠritĂŠ : câĂŠtait celle quâil sentait, lâintĂŠrieur de sa vision ; ainsi je considère son art comme du rĂŠalisme absolu, car lâexpression du peintre se nourrit de ses propres sensations, et lâĹuvre, Ă son achèvement, nâest pas une copie du rĂŠel ; câest du rĂŠel ; une crĂŠation absolue, comme si lâartiste avait produit du sens, ou rĂŠalisĂŠ lâIdĂŠe Ă la manière dâun dieu. La pensĂŠe est subjective par essence ; toute idĂŠe nâexiste quâen lâHomme. Mais je mâexpliquerai Ă ce propos une autre fois, car je rĂŠalise que je mâĂŠgare dès le dĂŠbut de cet article sans mĂŞme en avoir introduit le sujetâŚ
Au thÊâtre de lâAmandier, jâai vu Les Chaises dâEugène Ionesco, mis en scène par Luc Bondy. CâĂŠtait il y a quelques jours, et je me rappelle que ce soir-lĂ fut lâachèvement dâune journĂŠe teintĂŠe de cette grande tristesse ; il serait donc fallacieux de ne pas prĂŠvenir le lecteur que lâauteur de cet article a vu la pièce dans certaines conditions contingentes qui ont jouĂŠ nĂŠcessairement sur son avis, sa vision et sa propre critique ; mais il sâefforcera tout de mĂŞme de paraĂŽtre le plus distant possible de ces conditions, car au fond â et heureusement â le lecteur sâintĂŠresse toujours plus au texte quâĂ son auteur.
Dire ce qui nous a gĂŞnĂŠ dans la reprĂŠsentation dâune pièce de lâAbsurde, câest en quelque sorte lâencenser. Je le ferai donc, puis je tenterai dâexposer ses particularitĂŠs principales. Il est toujours difficile de parler de quelque chose au-delĂ de ce que nous en avons entendu a priori ; et mĂŞme si les idĂŠes communes ont une part de vĂŠritĂŠ, elles mâembarrassent, car â par exemple â ce que le thÊâtre veut nous faire vivre ne se satisfait jamais dâidĂŠes reçues. Je pourrais, dans cet article, après avoir vĂŠritablement vĂŠcu quelque chose de puissamment personnel, ĂŠcrire sur cette pièce de lâAbsurde les gĂŠnĂŠralitĂŠs que lâon sait (et qui se trouvent dans le premier livre scolaire de littĂŠrature), mais je ne voudrais pas me contenter de ce que jâai appris dans mes cours de français, je voudrais aller plus loin et exprimer ici â dans cet espace qui se rĂŠtrĂŠcit Ă vue dâĹil â les idĂŠes fugitives du rĂŞve, comme si la pièce avait ĂŠtĂŠ un songe dont il me faudrait Ă prĂŠsent narrer les images avant quâelles ne sâeffacent, soufflĂŠes par les durables idĂŠes du quotidien. Comme Ă lâenvolĂŠe dâun rĂŞve, la clĂ´ture dâune reprĂŠsentation me dÊçoit toujours ; non par la pièce en soi mais par la rĂŠalitĂŠ qui la suit, se rĂŠveille une fois la salle quittĂŠe. Les Chaises est ce quâon peut nommer un rĂŞve très ĂŠtrange que lâon hĂŠsite Ă qualifier de cauchemar et dont on lui refuse lâidylle dâun beau rĂŞve. La mise en scène qui prend beaucoup de libertĂŠs tout en restant fidèle dâune certaine manière au texte et Ă lâunivers de la pièce joue sur cette hĂŠsitation. La gĂŞne sâinstalle dès le dĂŠbut et nâen finit plus de planer Ă chaque ĂŠchange, ou chaque parole prononcĂŠe par les deux uniques personnages sur la scène (au passage les deux jeunes acteurs, dans le rĂ´le des deux vieux, mus par une technique impressionnante, semblent sous nos yeux sâĂŠclater comme des fous, câest un plaisir et une torture sublime de les voir imiter Ă la perfection toutes les mimiques de leurs arrières grands-parents, de la mĂŞme manière quâun petit enfant sur les genoux de ceux-ci les remarque dâun Ĺil craintif et amusĂŠ). Une dernière chose Ă propos de la mise en scène : si le cinĂŠma a puisĂŠ Ă ses dĂŠbuts les règles dâor du thÊâtre, Ă prĂŠsent la situation semble renversĂŠe. On voit de plus en plus de mises en scènes thÊâtrales utiliser des effets de lumières, de dĂŠcors, de rythmes ou quelques jeux dâacteurs qui relèvent typiquement de la mise en scène cinĂŠmatographique. Ainsi, au commencement de la reprĂŠsentation de la pièce dâIonesco, nous sommes tĂŠmoins dâun jeu de lumière surprenant qui imite en quelque sorte le fondu cinĂŠmatographique et qui accentue le caractère dramatique de la scène. Lâemploi systĂŠmatique de la musique sur le plateau oĂš est posĂŠe, sur lâescabeau, une petite radio (qui nâest absolument pas dans le texte dâIonesco qui ne parle que dâescabeau), est sans doute lĂ pour provoquer chez le spectateur, certainement plus habituĂŠ aux salles obscures oĂš la musique est malgrĂŠ tout très prĂŠsente, une attention plus complaisante. Faut-il blâmer le metteur en scène dâuser de ces facilitĂŠs ? Je ne sais pas, quoi quâil en soit le rĂŠsultat est efficace : on est captivĂŠ. Enfin je ne veux pas rĂŠvĂŠler le choix le plus osĂŠ de Luc Bondy, mais je fus extrĂŞmement ĂŠtonnĂŠ dâavoir Ă la fin de la reprĂŠsentation â et de plus dans un thÊâtre â une fantastique vision lynchienne. Après cela jâai dâailleurs rĂŠalisĂŠ combien le cinĂŠma de David Lynch pouvait ĂŞtre une digne suite du thÊâtre de lâAbsurde, et combien une mise en scène dâIonesco pouvait ĂŠgalement sâinspirer de lâunivers envoĂťtant du rĂŠalisateur que je qualifierai de fascinateur.
*
Enfin, pour achever cet article voici une très petite rĂŠflexion sur le rire dans le thÊâtre de lâAbsurde, dâaprès mon expĂŠrience de lâautre soir.
Face aux situations insensĂŠes dont nous sommes tĂŠmoins dans la reprĂŠsentation de lâAbsurde, le rire est tout dâabord une dĂŠfense, une arme contre lâirrationnel, puis comme on ne peut rire ĂŠternellement il se change en sourire figĂŠ que lâon oublie sur notre visage oĂš lâon le laisse traĂŽner par distraction. Soudain, notre conscience se rĂŠveille, soutenue par le simple bon sens, elle nous dit : ÂŤ mais regarde donc ce que tu vois ! Ton sourire est dĂŠplacĂŠ ! Âť et dans une transition brutale â parce que nous lâavons dĂŠcidĂŠ â le sourire sâefface entièrement du visage pour laisser place au sĂŠrieux qui semblerait ĂŞtre la rĂŠaction la plus appropriĂŠe Ă ce que nous voyons (mais que voyons-nous prĂŠcisĂŠment ?), puis quand le sens se perd Ă nouveau dans un autre gouffre aberrant, on rit pour se protĂŠger, se retenir de ne pas y tomber. Le thÊâtre de lâAbsurde, câest comme les lumières vertes, bleues ou rouges qui apparaissent devant nos yeux les paupières fermĂŠes après avoir fixĂŠ longtemps une forte lumière ; elles sâĂŠchappent toujours de notre vision mais si lâon dĂŠcide de ne plus y prĂŞter attention elles surgissent devant nos yeux fermĂŠs, entre les paupières et le monde, comme si elles demandaient sans cesse notre attention, mais sâen ĂŠchappaient continuellement. En quelques mots, encore une fois, câest lâhĂŠsitation continuelle, la fuite de lâHomme et lâimplacable prĂŠsence en lui-mĂŞme de sa propre absurditĂŠ. Quâest ce qui est absurde ? De ne pouvoir fuir ? La fuite elle-mĂŞme ? Ou bien la question ? Mais tous ceux qui connaissent Ionesco ou le thÊâtre de lâAbsurde le savent dĂŠjĂ ; en vĂŠritĂŠ lâhumanitĂŠ entière lâexpĂŠrimente sans cesse. (Mais il faut chercher quoi⌠faute de le trouverâŚ).
JĂŠrĂ´me Flipo, L1 HumanitĂŠs
Les Chaises dâEugène Ionesco
Au ThÊâtre Nanterre-Amandiers jusquâau 23 octobre 2010