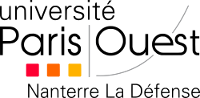Répondre au commentaire
Fight Club, ou l’apogée de la schizophrénie
‘‘Première règle du Fight Club : on ne parle pas du Fight Club’’.
Toutes mes excuses, monsieur Durden ! Sacrilège ultime, que de parler ici du film de 1999 réalisé par David Fincher, adapté du roman de Chuck Palahniuk publié en 1996.
Le réalisateur de Seven retrouve ici son interprète Brad Pitt, qui livre sans doute sa meilleure performance à ce jour. Il épaule avec talent Edward Norton, qu’il n’éclipse que dans l’exacte mesure où son personnage le fait. Helena Bonham Carter, alias Marla, s’immisce avec nonchalance, clope au bec, dans ce duo qui n’en est pas un : elle nous captive, nous intrigue par son apparente ambiguïté vis-à-vis des deux hommes. Le ‘trio’ amoureux est ici traité avec une grande subtilité, et se résout de lui-même, de manière fort astucieuse.
L’humour très marqué du film contraste avec le thème sérieux de l’intrigue : le héros est perdu, désillusionné par la vie, cherche un moyen d’y faire face, à défaut de se reprendre en main… Son remède : la violence. Pourtant celle-ci est abordée avec humour, presque avec dérision, qui est installée dès la première scène de combat dans le parking (« -Frappe-moi. –Quoi ? –Allez, frappe-moi !»), et reste tout au long du film. Les combats au sein du Fight Club se déroulent dans la bonne humeur générale, Le personnage de Brad Pitt se fait démolir le portrait en riant à gorge déployée, les membres du club tentent d’engager des combats avec des inconnus dans la rue, qui fuient de manière ridicule, notre héros se bat contre lui-même pour faire accuser son patron… On rit bien, et pourtant c’est bel et bien de la violence que l’on nous montre, à l’état pur. Elle est donc efficacement évacuée chez le spectateur, de la même manière qu’elle évacue les problèmes du héros, ou du moins lui offre un refuge contre cette société consumériste et violente à sa manière.
La caméra de Fincher est mise au service de la narration très particulière de Palahniuk, les prises de vue sont époustouflantes, chaque image a un sens, une utilité. Ce réalisateur dit « visuel » ne faillit pas à sa réputation. Sa caméra tantôt tremblante, tantôt naviguant avec fluidité entre deux cadres, devient comme un personnage à part entière. Elle retranscrit avec habileté le dédoublement de personnalité du personnage, qui s’exprimait dans le roman par des courts paragraphes ou phrases intercalés avec le récit, pour perdre le lecteur. Cet effet est moindre dans le film, mais il aurait sans doute nui à la compréhension générale de l’intrigue.
David Fincher est donc pardonné, d’autant qu’il fait par ailleurs tout à fait preuve de fidélité à l’égard de l’œuvre originale, à quelques détails près. Si le héros n’a qu’une blessure par balle au visage au lieu de deux à la fin, c’est peut-être par souci de réalisme esthétique : comment faire paraître un visage humain lorsque la mâchoire n’est plus retenue par aucune joue ? Cela aurait pu devenir gênant, et ternir la photographie impeccable du réalisateur. La fin diffère également en ce qui concerne le sort du protagoniste : au lieu de le laisser entre la vie et la mort, en compagnie de Dieu, Fincher lui laisse la vie sauve, et lui offre même un feu d’artifice romantique en compagnie de Marla. Une alternative plus classique, qui ‘‘fait film’’, mais à laquelle on croit cependant sans difficulté.
Fight Club est un film à revoir absolument. On pourrait dire cela de n’importe quel film que l’on apprécie, bien sur, mais il s’agit ici de complètement redécouvrir le film, en voir un presque différent la seconde fois. Ce film se renouvelle de lui-même, se regarde différemment à chaque fois, avec un regard toujours nouveau, comme si c’était finalement nous, les schizophrènes…
Laura Vandenhede