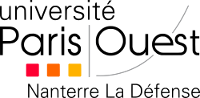janv.
18
Soumis par jerome.flipo le mar, 01/18/2011 - 00:28
Blanchot ou l’expérience de l’Infini.
Maurice Blanchot (1907-2003) fut romancier et critique. Sa vie fut entièrement vouée à la littérature et au silence qui lui est propre.
A l’origine j’ai pensé, puis j’eus l’idée de penser. Alors je me suis mis à écrire.
Le sujet n’existe pas ; le langage s’exprime lui-même et la pensée se fond dans l’inutilité de son expression. Je ne pense plus, j’écris.
Ca ne pense plus, ça écrit.
L’écriture n’est plus diffuse, elle s’impose à la réalité, fige la mouvance intérieure de mes images : elle glace ma conscience qui n’a pu soutenir d’avantage le bouillonnement intense des idées sans forme.
Ecrire, c’est être sans cesse à la recherche d’une forme qui n’existe nulle part – ni dans le temps, ni dans l’espace. Ecrire, c’est se débattre avec l’intangible.
Qu’est-ce l’écriture qui se demande ce qu’elle est ? Qu’est-ce l’écriture qui n’a plus de pensées humaines, et qui s’engendre de ce qui la dépasse ? Enfin, je me soumets à l’écriture comme un souffle de vent sur mon visage : il ne faut pas avoir peur d’ouvrir les yeux et craindre la naissance des larmes.
Première image. Mélancolie. Naissance d’un poème. Solitude. La pensée dépasse le langage qui ne représente rien, mais produit le sens qui l’engendre et l’engendre et l’engendre et l’engendre encore à l’infini…
Blanchot a levé le voile qui pesait sur l’écriture. Il l’a levé du moins dans ma conscience, et qu’en sais-je des autres ?
L’écriture se veut l’outil d’une pensée discursive ou poétique – mais que se passe t-il si l’écriture ne devient plus le moyen mais l’objet de sa propre existence ? L’écriture, chez Blanchot – du moins dans ses romans – atteint en l’Homme une transcendance mystique et le dépasse infiniment ; les images qui surgissent de ses phrases ne peuvent avoir aucune représentation humaine – il y a seulement l’indéfini ou l’ineffable poétique qui aurait la capacité de sentir un ailleurs au-delà des symboles, au-delà même des sens. Cette écriture n’appartient à personne ; elle surgit d’une pensée et, comme le vent, ne peut être saisie ; comme le vent elle ne peut qu’être sentie – alors le frisson est l’authentique passion dont le lecteur peut jouir. La lecture est cette brise qui rend toute pensée sensible au monde qui lui est propre : l’Idéal, hors du temps et de l’espace, et dont les lois ne suivent pas celles d’un monde réalisé mais celles de l’irréalité et – toujours – de l’intangible (de l’Idéal). J’ai découvert dans un texte de Walter Benjamin – Sur le programme de la philosophie qui vient – qu’il était possible de concevoir l’expérience ou la jouissance de ce qui n’est pas – matériellement sensible et virtuellement possible – par exemple de Dieu – et essentiellement par la connaissance ; le frisson de la Foi en est le témoignage éclatant ; l’Homme en vérité possède, en sa puissance d’imaginer et de concevoir – découvert dans le langage – la capacité infinie de dépasser les propres frontières de sa représentation (par les sens et la raison) de ce monde. Ainsi le croyant peut sentir la présence de Dieu bien qu’elle soit absente de la matière sensible : toute absence du monde devient présence dans l’esprit – la pensée ou l’idéal est un univers de présence absolue – penser à ce qui n’est pas, revient à faire du je-ne-sais-quoi une évidence essentielle. Le néant est une idée ; il est alors déjà quelque chose dans l’esprit. Le monde de l’Homme est un monde d’idées ; il est enfin possible de sentir – de par leurs seules évocations – l’intangible, l’absence ou l’absolu ; de réveiller en soi la jouissance ou l’expérience de ce qui n’est pas immédiatement réel.
Lire Blanchot, lire Thomas l’Obscur – que l’on ne finit jamais, livre interminable qui se métamorphose toujours, car un instant de lecture est un instant de vie, et le devenir est en perpétuelle mouvance – lire ces lignes, suivre le cours de pensées infinies comme un fleuve qui n’a pas de fin, s’abandonner au Temps, la Nuit, l’Eternité et comprendre enfin que la vie est ailleurs. Phrase en suspens. Le monde ne s’explique pas, il se ressent ; le langage ici n’a d’autre ambition que d’effleurer vos pensées, béatitude absolue du lecteur qui contemple, dans les mots et leurs enchaînements illimités, l’onde paisible de son Etre. Le poème est en vous. Blanchot, médium ouvrant les portes qui donnent sur vous-mêmes. Sans le lecteur, le langage est cet amas muet de mots stériles, le langage n’existe que pour nous, que par nous, que dans nous ; et le monde qu’il engendre est notre intimité : l’intimité de l’Homme. Nous ne sommes pas réalisés. L’être humain est un être d’images, de représentations ; aucun miroir ne reflète ce qui se meut au-delà du visage : aucun miroir ne reflète les pensées. Il nous suffit de comprendre quelque chose pour que cette chose soit impossible en réalité. Un monde est créé par la fiction du langage, ce monde est le nôtre, où nous vivons, où nous agissons, où nous pensons. L’écriture de Blanchot a conscience de produire son propre univers, et joue avec le lecteur, la pensée du lecteur jusqu’à sa plus profonde intimité. Jeu de métamorphoses et de mises en abyme sans fin. « Thomas s’assit et regarda la mer. » Cette première phrase ne se lit pas, elle se contemple : les signes qui la composent sont pour l’esprit comme des choses ; comme si la mer, ces traits sur le néant d’une feuille, étaient véritablement cette surface liquide à l’horizon infini. Le mot est une idée, l’idée est une forme sensible. « Puis, une vague plus forte l’ayant touché, il descendit à son tour sur la pente de sable et glissa au milieu des remous qui le submergèrent aussitôt. » Lorsque je lis, ma conscience contemple ce monde qui s’érige par le langage et s’y engouffre, s’y enveloppe comme dans une mer. Blanchot savait tout cela : il savait par exemple que lire dans Le Château : « Le chef du bureau a téléphoné. » transforme le rapport du lecteur avec les mots et la réalité, rapport essentiellement autre que si, par exemple, c’était un employé qui lisait cette phrase sur un papier laissé par une secrétaire (mais il faut noter que cette situation même n’est véritablement réalisée qu’en présence d’elle-même ; autrement, dans le processus de la réminiscence, elle aura perdu toute réalité). Lire ou contempler un monde à l’intérieur de sa pensée permet le jeu et le désespoir des images. Lire, c’est penser ce que l’on nous prête à penser : être pris dans un mouvement qui, ne nous appartenant pas à l’origine, devient le nôtre, mouvement de nos images et de nos pensées. « De là vient que la littérature puisse constituer une expérience qui, illusoire ou non, apparaît comme un moyen de découverte et un effort, non pour exprimer ce que l’on sait, mais pour éprouver ce que l’on ne sait pas. » (Blanchot, Le langage de la fiction).
Lire Thomas l’obscur est une expérience totale. Hermann Broch, dans l’un de ses méconnus essais philosophiques, définit l’œuvre d’art comme appartenant à la matière universelle au même titre qu’un océan, qu’une brise – car avant toute chose l’art s’adresse à nos sens – Thomas l’obscur est une étendue sans lieu de matière idéalisée : les mots affluent en nous comme une eau-de-vie caressante ou revêche ; l’ivresse est infinie.
L’ivresse est infinie.
Tout principe est aboli. Il est dorénavant permis d’écrire une proposition et son contraire : un monde absolu n’exclut rien, et l’exclusion même y est possible, et la mort peut y mourir. « Tout ce qu’Anne aimait encore, le silence et la solitude, s’appelait la nuit. Tout ce qu’Anne détestait, le silence et la solitude, s’appelait aussi la nuit. Nuit absolue où il n’y avait plus de termes contradictoires, où ceux qui souffraient étaient heureux, où le blanc trouvait avec le noir une substance commune. »
Une autre fois je parlerai de Mallarmé qui fut le premier à s’abolir de Tout pour chercher l’Infini. L’Espérance du Poète surpassera la mort. Thomas l’obscur est une expérience de la mort, une jouissance du néant, la plus vraie de la littérature.
Et je n’ai pas de mot pour décrire le frisson infini qui m’emporte sans cesse à la lecture du livre.
“Do I dare
Disturb the universe? ”
T.S. Eliot. The Love Song of J. Alfred Prufrock
Bibliographie :
Walter Benjamin, Sur le programme de la philosophie qui vient ; Œuvres I p. 188 ; Folio essais, Gallimard ; 2000
Hermann Broch, Des unités syntaxiques et cognitives ; Logique d’un monde en ruine, six essais philosophiques ; Editions de l’éclat ; 2005.
Maurice Blanchot, Le langage de la fiction ; La part du feu, p. 83 ; Gallimard, 1949.
Maurice Blanchot, Thomas L’Obscur ; L’imaginaire Gallimard ; 1950.
Jérôme Flipo, L1 Humanités