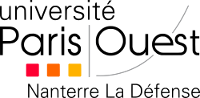CAMUS & LE MONDE ARABE

L’article a été écrit à l’issue de la conférence d’Agnès Spiquel, professeur à l’Université de Valenciennes et présidente de la Société des Etudes Camusiennes, le 12 décembre 2010 à la médiathèque de Rueil-Malmaison sur « Camus et le monde arabe »
Osons. Oui, osons prendre du recul sur ce débat polémique voire explosif et incontestablement politique qu’est l’identité nationale. Osons l’aborder sous un autre angle. Albert Camus, écrivain du siècle passé, fut toute sa vie à la croisée de deux cultures et a souffert, comme tant d’autres, de devoir choisir. Son expérience de vie, sa position et ses œuvres en sont riches d’enseignement.
Descendant des premiers émigrants français au Maghreb, Camus mène la vie d’un « petit blanc ». Son attachement à la terre d’Algérie est viscéral. Le souvenir du soleil d’Alger est ambivalent : pesant, il rappelle la condition misérable de sa famille qui paraît pourtant naturelle dans le quartier populaire où il habite avec sa mère sourde et illettrée ; mais lumineux, le soleil nourrit une enfance heureuse dans son pays natal, rythmée de parties de football et de baignades. Ces moments de bonheur simple sont le pain quotidien d’un peuple qui doit survivre à la pauvreté dont on ne se défait pas ; Camus y tient, ils ont bercé son enfance. Il leur consacre une place privilégiée dans ses œuvres. Le « bain de l’amitié » de Rieux et Tarrou, seul instant de répit face au fléau de la peste prend alors tout son sens : c’est Camus lui-même qui s’exprime à travers ses personnages. Tout au long de sa vie, loin d’Alger, Camus est en exil.
Son amour pour sa terre le pousse à prendre très rapidement position quant à la situation coloniale de la France, et ce bien avant la guerre d’indépendance.
Est-il possible dans une situation comme celle de ces années noires d’envisager une troisième solution, qui valorise chacune des positions dans un esprit pacifique ? Camus est souvent mal compris pour le parti qu’il a pris et pour lequel il s’implique avec conviction. En 1956, il lance son « Appel à la trêve civile » espérant faire entendre son plaidoyer pacifique pour une solution bannissant les crimes, le terrorisme de masse, les attentats et la fausse justice de l’armée française et du FLN. Il veut une solution équitable pour chacun. Le fédéralisme des communautés pourrait, selon lui, permettre au peuple arabe d’exprimer pleinement sa personnalité et aux pieds noirs de demeurer sur la terre qui leur est chère. Peu entendent, dans cette salle de l’Atlas, le véritable cri d’amour et de douleur d’un Camus déchiré, qui appelle à un cessez-le-feu, mais nombreux crient « A mort Camus », lui reprochant de ne pas lutter pour l’Algérie française ou pour l’indépendance. Malgré son engagement dans le journalisme pour la cause algérienne, dans Le Soir républicain ou dans Alger républicain, il est condamné à l’exil. Il a voulu comme Rieux, comme Cherea, comme Kaliayev, se révolter contre l’absurdité de l’histoire qui semblait s’écrire devant ses yeux, et que rien ne pouvait arrêter, pas même la détresse d’un amoureux de la vie, d’un passionné de sa terre.
Dans ces œuvres, Camus est fasciné par ce peuple attirant et contrasté et par cette terre à laquelle il consacre le plus beau de son lyrisme. Conscient d’une cohabitation entre deux cultures, il rend compte de leur différence et de leurs contacts qui, bien que discrets dans ces écrits, existent. Meursault dans l’Etranger, observe avec minutie et fascination la communication silencieuse qui s’établit dans le parloir de la prison entre les arabes et qui contraste sévèrement avec les cris des européens. De même, la scène du café dans l’Envers et l’endroit témoigne à la fois d’une distance entre le patron arabe et le client européen et d’un respect silencieux mutuel, nécessaire pour ne pas contrarier le « bruit du monde ». Les exemples sont encore nombreux, comme celui de L’hôte où un instituteur français débarquant en Algérie et un arabe vivent une proximité humaine, ou celui de La femme adultère qui, bien que percevant une « inquiétante étrangeté » face à la différence, se laisse prendre dans le filet de la liberté berbère où son acte d’amour est une fusion avec la nuit et le cosmos.
Mais celui qui est à retenir, celui qui incarne la passion algérienne de Camus, c’est le récit de sa naissance dans son roman inachevé : Le Premier homme. Sa mère, son père et son frère sont emmenés en carriole par un arabe (qui ne porte toujours pas de nom) à vingt kilomètres de la gare où ils se trouvent. Sa mère ne va pas tarder à accoucher, elle a mal, il pleut dehors, mais tous les quatre sont abrités sous la même capote. La mère, rassurée par l’arabe, est sereine, et « avec [lui elle n’a] pas peur ». La scène pourrait être interprétée comme une réécriture de la nativité : c’est un havre de paix créé par une complicité entre l’arabe et les deux parents, prêts à accueillir celui qui toute sa vie, s’engagera pour retrouver cette harmonie originelle entre les deux peuples qu’il aime.
Constance Morlet / L1 humanités