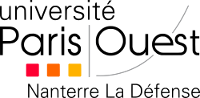Il faut se représenter un homme assis à son bureau, une pile de périodiques sur le coin gauche de la table, une pile de littérature classique et de philosophie sur le coin droit. L'homme écrit une œuvre infinie, et dans l'air s'entrelacent puis s'estompent les volutes grises d'un cigare. Il s'agit de Philippe Muray, un écrivain encore peu connu malgré les lectures de ses textes que le comédien Fabrice Luchini donna deux ans après sa mort, en 2008, au théâtre de l'Atelier.
Car pour appréhender Muray sans s'en faire une idée trop sommaire, il faut le lire et le relire, ne pas s'arrêter aux premiers ressentis, mais les dépasser, persévérer, essayer de comprendre un système complexe qu'il ne résuma jamais, mais étendit tout au long de chroniques qu'il écrivit au fur et à mesure des événements, ou plutôt des non-événements, en décryptant la réalité médiatique, seule réalité à l'existence effective selon lui. Ainsi fit-il une description cohérente de l'époque, une proposition d'analyse, qu'il coucha sur des milliers de pages rassemblées sous le titre Essais aux Belles Lettres, et divisées en trois parties : L'Empire du Bien (1991), Après l'Histoire (1999, 2000) et Exorcismes Spirituels (1997, 1998, 2002). Il signa aussi des ouvrages de critiques littéraires (Céline, 1981 ; Le XIXe siècle à travers les âges, 1984) ainsi que plusieurs romans (Chant pluriel, 1973 ; On ferme, 1997 ; Désaccord parfait, 2000…) et un recueil de poèmes (Minimum respect, 2003), mais je m'appuyerai surtout sur son activité d'essayiste afin de tracer les grandes lignes de son explication du monde actuel.
Nous sommes à la fin des années 1980 lorsque Muray commence ses premières chroniques ; elles aboutiront donc à la publication de L'Empire du Bien puis d'Après l'Histoire. L'Union soviétique se désagrège peu à peu pour laisser place, dans la société occidentale, au règne sans partage du modèle de la démocratie libérale. Au delà de l'opinion du philosophe Francis Fukuyama lorsqu'il développe sa thèse de la fin de l'Histoire, Muray voit dans ce consensus l'instauration d'un nouveau totalitarisme : l'Empire du Bien, qui vise à l'éradication totale du Mal, phénomène qui romprait alors l'équilibre traditionnel transmis par les grandes religions. Il met en évidence l'émergence d'une nouvelle doxa moderniste, qui consisterait à accueillir les nouveautés sociales, culturelles, technologiques, l'évolution des mœurs, toujours favorablement justement parce qu'elles innovent – et il est vrai que la formule : « le nouveau doit s'expliquer, l'ancien doit être défendu » de Paul Valéry dans ses Regards sur le monde actuel fait sourire, tant c'est le contraire qu'on proclame désormais -. Il serait donc interdit d'aller à l'encontre de cette doxa, de se montrer individuellement farouche à celle-ci, sous peine d'une exclusion, notamment médiatique.
Une des manifestations de la modernité résiderait dans une propension particulière qu'auraient les contemporains pour les grands rassemblements, les moments de liesse collective que Muray appelle les fêtes, détournées ainsi de leur sens originel. La fête, aujourd'hui, ne serait plus un court et précieux moment d'invertion des valeurs, de renversement temporaire et presque miraculeux, mais l'activité quotidienne à laquelle il faudrait se soumettre. Elle serait en quelque sorte l'arme de l'Empire du Bien, son moyen d'étouffer toute contestation, d'intégrer sa propre critique. L'innocence, le retour à un état précédant le péché originel, finaliserait ce phénomène - et peut-être peut-on penser ici à Milan Kundera qui, dans Le livre du rire et de l'oubli, remarque la même tendance dans le communisme –. Pour y échapper, il ne resterait qu'à vivre en ermite, ou à prendre une énorme distance qui, en ce qui concerne Muray, lui aurait été permise par la rédaction régulière de ses Exorcismes spirituels.
Loin d'élaborer une philosophie à la façon cartésienne, son propos tient principalement dans une réfléxion esthétique. Le style est plus diffus, on pourrait dire plus imprécis. Son système, que je me suis efforcé artificiellement de synthétiser ici, prend forme au fur et à mesure de l'écriture. Il le pressent plus qu'il ne le pense, et donc utilise de multiples tournures pour le caractériser, reformulant sans cesse pour atteindre le fond, l'illustre par nombre d'exemples, et se réfère aux jugements d'auteurs reconnus pour incorporer leurs idées. Les personnages, les lieux, les événements : tout est tiré de la réalité et s'assemble peu à peu. A la manière de Balzac, il tisse une comédie humaine de son temps, d'une écriture riche, débordante, qui n'arrête pas de composer des variations d'un même thème, qui fait souvent rire, non pas du rire de l'acquiescement, mais du rire des diables dont parle Kundera, celui du face à face avec le non-sens, le rire intelligent, pas le rire infantile. Il traite divers thèmes, des concepts qu'il invente, et propose pour les définir de nombreux néologismes, tels que la fête généralisée déjà mentionnée plus haut (« festivisation » et « Homo festivus »), le besoin de toujours légiférer davantage (« l'envie du pénal »), la fausse contestation de ceux qui en réalité suivent le mouvement (« les mutins de Panurge »), et les artistes faussement subversifs (« les artistocrates »).
Il bâtit en somme une immense satire, tirée de faits réels, tellement caricaturés et poussés à l'absurde qu'ils en deviennent presque merveilleux, comme un miroir hyperbolique de la société qu'il exècre, seul, à son bureau du 6e arrondissement, par les fenêtres duquel il voit passer au loin les rando-rollers et les gay prides, noircissant des pages en fumant son cigare.
N. B. : la bibliographie de Philippe Muray est consultable sur http://www.philippe-muray.com