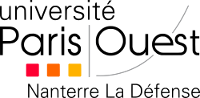janv.
25
Soumis par jerome.flipo le mar, 01/25/2011 - 21:09
« Words, words, words… »
Shakespeare, Hamlet.
Le Roman Fou n’est pas l’œuvre d’un fou, loin de là ; il s’agit de l’expérience d’un jeune et malheureux lointain inconnu dans la littérature.
Le désespoir est ce qui pousse l’Homme dans son accomplissement. Ecrire est un acte qui se refuse lui-même, et qui refuse ainsi la réalisation de l’œuvre ; l’achèvement du tout se brise à l’infini dans l’éternelle appétence du langage. Celui qui se demande en écrivant, par curiosité essentielle, le principe de son écriture, creuse jusqu’au fond de la terre les fondements de Babel, et provoque lui-même l’effondrement de l’édifice qu’il a élevé de son propre langage et de sa pensée. La chute ne vient pas d’en haut, mais d’en bas : des plus profonds soubassements de la pensée humaine. La transcendance de la littérature au sein d’elle-même – ce qu’une critique canadienne a voulu en partie théoriser un jour sous le terme de métafiction – entraîne indéniablement la ruine sublime, l’apocalypse immense des images. La pensée humaine a perdu ses mirages et se produit alors comme un spectre dans un désert ; un aveugle invisible. La question n’est pas : qu’est-ce que la littérature ? Mais que devient la littérature ? Métamorphoses, la littérature se meut dans la pensée humaine qui, peu à peu, semble se perdre à l’intérieur de la totalité qu’elle veut représenter. Rien n’est total. Tout est infini. Qu’écrire de plus ?
Celui qui voulut écrire Le Roman Fou ne le devient – fou – que dans la littérature. Hors d’elle, il n’est rien, ne représente rien. Ce roman existe malgré lui dans une affluence remarquable d’incohérences propres à toute création prématurée. Le Roman Fou semble avoir voulu de lui-même s’extraire d’une pensée qui n’était pas encore formée à l’œuvre, qui n’avait pas le développement et la maturation nécessaire pour s’affirmer elle-même et soutenir la création littéraire au sein du langage universel des hommes.
Néanmoins, à la lecture de ce roman on peut distinguer dans son inachèvement dissimulé un certain caractère infini qui aurait le pouvoir de porter le seul lecteur qui saurait s’enlacer de ces lignes, prendre corps avec elles, et qui saurait s’abolir de la lecture pour atteindre les idées du corpus de par ses propres sensations. En réalité il ne peut s’agir ici que de l’écrivain lui-même qui aurait écrit ce livre seulement pour lui, tout en faisant paraître de par une certaine attention littéraire dans la construction des phrases une immense ambition qui ne saurait être que feinte au plus profond de l’auteur. Rien n’est certitude.
Mais qui est-il, cet écrivain sans nom qui délivre à lui-même et à autrui cet amas muet de mots stériles sans paraître vouloir les comprendre ? Il n’est rien, mais il devient quelque chose dans son œuvre ; une chose sans forme, sans existence, mais qui demeure dans l’inexistence comme un fantôme qui ne peut rien sentir dans l’espace intersidéral. Il se demande s’il est lui-même quelque chose. Sa demande est l’œuvre même qui s’écrit au fur et à mesure qu’elle se perd ; vêtement de laine qui disparaît progressivement dans la continuité du fil. « Tout meurt et pourtant rien ne s’achève ». Que restera t-il de l’Univers lorsque tout s’effacera ? L’infini, sans doute. La mort.
Le texte en lui-même est sans doute d’une médiocrité sans nom, mais il faut tenter de le comprendre non dans sa réalisation, mais dans son idéal ; en vérité, l’importance n’est pas ce que l’on peut lire, mais ce que l’on peut penser ; or la pensée s’élève du langage comme des vapeurs blanches de cheminées morbides. L’écrivain n’est pas responsable des idées qui surgissent de par son écriture ; elles sont infinies. Dans Le Roman Fou, elles semblent n’appartenir à personne ; il n’y a pas d’illumination divine, d’inspirations quelconques ; il y a seulement le hasard qui se découvre dans la réalisation des formes. Surprise de la réalité. L’auteur n’a pas plus de pouvoir dans son roman que dans ses rêves. Le roman existe au-delà de l’Homme, quelque part dans l’horizon de son âme ; il existe pour ce qui nous dépasse à l’intérieur de nous-mêmes.
Il n’y a pas d’autre histoire que celle du roman. Le dormeur s'est confondu au rêve.
Le lecteur est l’étranger qui cherche à s’introduire dans l’espace qui le rejette. Sa pensée n’a pas de lieu hors d’elle-même ; il cherche un moment à comprendre ce que l’autre pensée à voulu signifier, mais il abandonne vite, et se réfugie à temps entre les murs de paille de sa demeure. Le vent dans ce roman est si fou qu’il menace de détruire sans cesse la petite propriété que le lecteur s’est construit entre les lignes ; il lui faut alors se battre avec les éléments du texte qui semble chercher inlassablement à rejeter cette présence étrangère de ses terres. Le sens est chaotique, pervers et cruel. Il semble que la douleur de l’écrivain à l’œuvre, venant sans doute de la douleur de l’homme à vivre, se soit immiscée dans l’écriture de telle manière que la lecture en devienne aussi douloureuse. En vérité, la douleur est celle de l’âme qui ne peut se comprendre et comprendre le monde.
Ainsi, pourquoi lire ce texte ? Pourquoi le lecteur privilégié, vivant dans une société si confortable, où l’agréable a chassé le beau, et plus encore le sublime, voudrait lire un tel roman, s’introduire en un monde où les idées torturent la raison et tourmentent le bon sens ? Le mal est devenu par inversion des mœurs la douleur même, et non plus ce qui la provoque. On ne pense plus au-delà des formes ; on se contente de cet il y a sans se transcender soi-même vers l’inconnu qui demeure dans l’âme. Le Roman Fou semble être le Mal pour celui qui ne veut pas souffrir, car la douleur dans le roman que l’on voudrait seulement contempler dans le plus confortable des fauteuils, dépasse les images et atteint la pensée même du lecteur. La douleur n’est plus représentation mais s’en retourne à son essence : la sensation. Ainsi, la douleur retrouvée, l’Homme peut accomplir sa grandeur d’âme. La douleur chasse le superficiel. La douleur n’est pas le renoncement, la résignation ; c’est la force du vivant, en un sens, le sublime abandon dans sa révolte infinie. Laisser le confort total, l’agréable sans limite à la médiocrité, c’est faire le premier pas vers la splendeur de l’Homme. Je pense que l’essence même de l’Homme, que l’on oublie par peur et que l’on évite par indifférence, est d’être masochiste ; c’est-à-dire non dans le sens qui fut perverti par la frustration des hommes, mais dans son sens authentique : naître dans la douleur, grandir par elle, et mourir en l’oubliant.
Et le plaisir reste immense.
« Il se peut que dans sa « robe de flamme », le martyr contemple la face de Dieu, mais pour celui qui entasse les fagots ou les dispose pour le bûcher, toute la scène n’est rien de plus que ne l’est pour le boucher le massacre d’un bœuf, ou, pour celui qui fauche l’herbe du pré, la chute d’une fleur. Les grandes passions sont pour les êtres doués de grandeur d’âme et les grands événements ne peuvent être vus que par ceux qui sont à leur niveau. […] Le vice suprême est d’être superficiel. »
Oscar Wilde. De profundis. Bibliothèque cosmopolite STOCK, 1990. Traduit de l’anglais par Léo Lack en 1975.
Jérôme Flipo
Photographie de Jérôme Flipo
Le Roman Fou. Alex Lagraine. Edition E.M.D. Tombouctou. 1894.