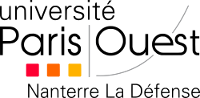Écrivain aux 1000 visages, Romain Gary n'a de cesse de multiplier les masques. De père inconnu, de nombreuses fois déraciné, il connaît de nombreuses crises de l 'identité , contre lesquelles il tente de se servir de l'écriture comme remède. La toute-puissance de l'écrivain lui permet d'apaiser les fissures de son moi fissuré ; elle est également le seul recours contre l'immuabilité de l'identité. Après une longue et brillante carrière, les journalistes en parlent comme d'un romancier à bout de souffle, dont l’œuvre est au point mort ; mais il est en réalité en train de fomenter la plus improbable des escroqueries littéraires. Retour sur son ultime masque, et sur le roman par lequel Gary atteint le niveau ultime de l'affabulation.
La naissance du golem Ajar
Au tournant de sa carrière d’auteur, Gary ressent un besoin de renouveau : il désire se délivrer d’une image médiatique qui lui colle à la peau, pouvoir retrouver sa « virginité littéraire ». Lassé de l'hostilité des critiques, de son image de gaullien qui lui colle à la peau, il veut retrouver la maîtrise de son destin d'écrivain. Il décide donc de s'octroyer une « seconde naissance » ; ainsi, peut-être les lecteurs le liront peut-être sans préjugés aucuns. A couvert, il pourra enfin laisser courir sa plume en toute liberté. Las de n'être que lui-même, il manigance la naissance d'un golem, dont le matériau est l'encre et le papier. Romain Gary, de son vrai nom Roman Kacew, avait choisi pour patronyme le mot « brûle », en russe ; pour sa nouvelle personnalité littéraire, il choisit dans la même langue le mot « braise » : Ajar. Lorsqu’il le crée, en 1974, Gary n’en est pas à son coup d’essai : il a déjà sorti plusieurs livres sous différents pseudonymes, et même fomenté une fausse piste, en orchestrant la divulgation d’un autre de ses pseudos, Shatan Bogat, afin d’endormir les soupçons du monde littéraire. Démasqué, Gary, espiègle, affirmera à ce propos dans une interview qu’il est quasiment impossible de cacher quelque chose aux parisiens. A ce moment là, le premier roman signé Ajar est déjà dans les librairies. Shatan Bogat aura donc servi de diversion, sacrifié à un dessein supérieur, un projet démiurge fou : l'invention à la fois d'une œuvre et de son auteur. Et cet auteur, dont il faudra bien un jour prouver l'existence, c'est Paul Pavlowich, le petit-neveu de Gary, qui en assumera le rôle. Même l’éditeur, Gallimard, ignorera jusqu’au bout le subterfuge. Gary emploie un intermédiaire pour la signature du contrat au nom d’Émile Ajar. Son premier roman, Gros-Câlin, une étrange histoire de tendresse entre un petit fonctionnaire parisien et son python, éveille rapidement l’enthousiasme du public. Le héros se prend de fascination pour la mue du reptile, qui essaye courageusement de changer de peau. Gary suggérera ainsi sa présence tout au long de l’œuvre d’Ajar, s'adressant des clins-d'oeil à lui-même.La rumeur pressent de grands noms de la littérature, tels Queneau ou Aragon, derrière le modeste Gros-Câlin, tandis que Gary se délecte de voir le Tout-Paris se perdre en spéculations sur l’identité d'Ajar, sa créature. Dans un second livre, La vie devant soi, il raconte du point de vue du petit Momo les méandres de la vie d’orphelin, et son amour pour la vieille madame Rosa, l’ancienne prostituée qui l’a recueilli. Le roman obtient le Goncourt 1975: la faute est consommée. Le prix suscite un fort engouement médiatique ; les journalistes spécialisés soupçonnent le canular. Gary doit absolument disculper son avatar littéraire, car la découverte du subterfuge signifierait pour lui la disgrâce : en effet, il a déjà obtenu le prix Goncourt en 1946, pour Les racines du Ciel, et le prix n’est attribuable qu’une seule fois par auteur. Il se retire afin de mettre au point, fébrilement, l’arme ultime qui permettra de sauver Ajar : Pseudo. Ce roman injustement méconnu, machiavélique, pseudo-autobiographique, consacre l’incarnation d’Ajar en la personne du petit cousin de Romain, Paul Pavlowich.
Pseudo, le roman de l’incarnation.
La machination atteint à travers ce récit relativement court son apothéose. Il prend pour cadre principal une clinique psychiatrique danoise, en alternance avec des périodes de liberté. Dans cette œuvre qui a la puissance d’un cri d’angoisse, Gary, la plume acerbe et délirante, présente un Émile Ajar névrosé, affabulateur, paranoïaque. Il use de tous ses talents pour retracer le délire perpétuel du protagoniste, toujours en virtuose de l’humour. Le roman s’ouvre sur l’annonce de ce qui sera l’angoisse principale et récurrente de Paul, la cause de sa folie : « Il n’y a pas de commencement. » C’est afin de lutter contre le déterminisme de l’hérédité, l’angoisse d’avoir été engendré, qu’il crée la « défense Ajar ». Avide d’unicité, « d’authenticité », il se lance dans une recherche désespérée de « l’aucun rapport. Et, afin de se fuir, il dénigre tout signe d’appartenance. Il est fasciné par l’inconnu, et s’y réfugie en apprenant des dialectes lointains et improbables, comme le swahili ou le hongro-finnois, ou en se laissant aller à des fantasmes d’une autre identité : « Alors je deviens un python, une souris blanche, un chien, n'importe quoi pour prouver que je n'ai aucun rapport. D'où internement et thérapeutique, en vue de normalisation. Je persévère, je saute ailleurs, je me débine. Cendrier, coupe-papier, objet inanimé. N'importe quoi de non-coupable. Vous appelez ça folie, vous ? Pas moi. J'appelle ça légitime défense. » C’est donc l’autre qui est fou, et l’imagination est l’asile de celui qui veut échapper à lui-même ; elle permet d’échapper à la responsabilité et à l’appartenance, car « la réalité, il n’y a pas plus effrayant comme hallucination. » Le réel est une erreur, un ennemi contre lequel il faut se battre. Et le réel est en effet plus que maltraité, dans ce roman à prétention autobiographique.
Gary s’y rit de tous, notamment en avouant sa machination : « Finissons-en avec cette question de « canular » : oui, j’en suis un, comme tant de journaux et de chaînes de radio l’ont deviné. » Mais un aveu si explicite est tellement improbable qu’il passe inaperçu au milieu d’un récit où le lecteur se perd dans les circonvolutions de la névrose du narrateur. Notons que si l’auteur emprunte une base d’éléments autobiographiques à Paul pour forger le héros complexe de « leur » roman, ses névroses relèvent de la mise en scène autour d’Ajar et sont purement fictives. Les courts épisodes de liberté du protagoniste se soldent à chaque fois par un retour à la clinique psychiatrique de Copenhague. Il y reçoit des visites, notamment de «Tonton Macoute », l'avatar de Romain Gary. Ajar a acquis la certitude qu’il a couché avec sa mère, voire serait son géniteur. S’il est peu probable que Gary ait eu des relations sexuelles avec sa cousine, le thème de la recherche d’une figure paternelle n’est pas anodin. En effet, la question de la quête du père est récurrente chez Gary, abandonné en bas âge par le sien ; il eût pu s’agir d’un indice véritable pour qui aurait soupçonné la paternité réelle de l’œuvre. Mais tous les critiques littéraires, enthousiastes, se laissent une fois encore séduire par le style auquel Ajar a donné naissance, sans soupçonner que lui et Gary ne sont qu’une seule et même personne, ce qui est la preuve de la virtuosité de cet auteur polymorphe : il a réussi à créer un style et une syntaxe particuliers, indépendamment de son œuvre propre. Gary réussit l’exploit de mener de front deux œuvres distinctes, aux styles tranchés. Le public se charge d’attester le mythe. Son petit-neveu, pendant ce temps, assume son rôle lors d'interviews, prend confiance en son personnage. Mystérieux, un peu sauvage, il correspond à ce que le public attend d'un auteur réputé marginal. Des années plus tard, dans le roman où il révèle toute l'histoire, il confessera que « les gens voyaient ce qu’ils voulaient voir ».
La liberté retrouvée
Dans cette œuvre, Gary se permet tout : libéré du carcan de son nom d’auteur reconnu, il atteint une véritable désinhibition littéraire. Par le biais de Paul, écrivain lui aussi, il formule une réflexion sur la création artistique et ses méandres. L’écriture seule permet d’évacuer la folie, en la couchant sur papier elle disparaît peu à peu, à l’image du python qui accompagne Paul dans sa folie, et se dématérialise à mesure qu'il écrit Gros-Câlin. Gary lui-même est également présent dans le livre. Il s'y rebaptise Tonton Macoute, terme qui désigne la milice du dictateur haïtien Duvalier, et par extension un personnage folklorique qui, quand il est nommé, est sensé effrayer les enfants. Dans Vie et mort d’Emile Ajar, confession publiée à titre posthume, Gary dira à propos de Pseudo : « Je m’y étais fourré tel qu’on m’a inventé et que toutes les
critiques m’avaient donc reconnu dans le personnage de Tonton Macoute, il n’est venu à l’idée d’aucun qu’au lieu de Paul Pavlowich inventant Romain Gary, c’était Romain Gary inventant Paul Pavlowich.» Il se décrit comme un accro à l’écriture, qui va se faire désintoxiquer dans la même clinique danoise où est soigné Paul. Son portrait, sévère, en fait un manipulateur, à tel point que madame Gallimard, l’éditrice de Gary et de son avatar, hésitera à publier le texte tel quel. Elle l’appellera avant la parution du livre afin de lui demander son autorisation. Le récit brouille donc les pistes, se bouleverse et se contredit, change constamment les noms des personnages : Paul est appelé tantôt par son vrai nom, tantôt Alex, Rodolphe ou Fernand, sa femme Annie, Alyette… La langue de Pseudo , souvent maltraitée, y est savamment déstructurée. Gary, abrité derrière son pseudonyme, s’autorise toutes les digressions, tous les abus. Par la voix d’Ajar, il se rit même des critiques qui avaient soupçonné un ouvrage collectif : oui, c’est exact, Ajar est collectif, il est même l’héritage de générations et générations d’additionnés, d’où la recherche enragée de l’authentique, de l'auto-engendrement salutaire.
On peut comprendre cet étrange récit comme une évasion littéraire, dont le pseudo est le moyen, car il garantit l’absence de toute filiation. C'est avant tout le roman où il lâche tout, l'expression d'une profonde détresse, que Gary tourne en dérision une fois de plus. Cependant, il marque le point de non retour du déchirement du moi qui tortura Gary depuis son enfance. Il fit de son œuvre un « manifeste contre l'identité immuable » (Guy Amsellem, Romain Gary – Les métamorphoses de l'identité), où la souffrance et les troubles psychiques participent largement de la création, mais Ajar fut la métamorphose de trop : dépassé par cette création de lui-même par lui-même, le poids de cette double existence finit par peser sur sa santé mentale. Il se donna la mort en 1980, épuisé par les dépressions nerveuses, recourant au suicide comme à l'ultime moyen de sortir de soi.